 Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Vous êtes maître de conférences à l'Université de Nice : qu'y enseignez-vous et sur quoi portent vos recherches ?
Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Vous êtes maître de conférences à l'Université de Nice : qu'y enseignez-vous et sur quoi portent vos recherches ?
Dans le jargon des sciences sociales, je suis effectivement ce qu’on appelle un « politiste ». C’est le terme que mes collègues ont pris l’habitude d’utiliser pour se distinguer des « politologues » qui ont colonisé les scènes médiatiques. Pour reprendre une image également employée fréquemment, c’est le même type de distinction que celle qui peut être faite entre astronomes et astrologues. D’un côté, il y a des fondements scientifiques ; de l’autre, ils sont nettement plus difficiles à trouver. Mes enseignements portent principalement sur cette branche de la science politique qui s’appelle l’« analyse des politiques publiques » ou la « sociologie de l’action publique ». En gros, il s’agit d’aider à comprendre les processus qui participent à l’élaboration des interventions publiques. Comment les problèmes sont-ils construits ? Pourquoi certaines propositions de solutions sont-elles privilégiées plutôt que d’autres ? Comment s’organisent les espaces de discussion, de négociation et de décision ? Comment interpréter les repositionnements des institutions publiques et de leur travail ? Autant de dimensions qui, entre parenthèses, ne sont d’ailleurs guère abordées par la science-fiction, qui pénètre rarement la machinerie profonde de l’État.
Mes recherches ont d’abord porté sur les politiques environnementales et leur évolution, sous l’effet notamment du poids croissant des logiques et considérations économiques. Elles ont glissé ensuite vers l’étude des effets de la montée de la problématique du « développement durable », notamment pour analyser comment ce type de conception contribuait à transformer les activités de gouvernement. Toute cette réflexion visait plutôt les sphères institutionnelles et leurs repositionnements.
J’ai déplacé plus récemment mon regard vers ce que j’ai appelé (faute de mieux pour l’instant) la « transition écologique par le bas », ce qui m’amène par exemple à m’intéresser à l’intégration des énergies alternatives et, plus largement, à toutes ces expérimentations qui pourraient paraître anecdotiques, mais qui tentent de proposer des alternatives au modèle dominant, voire qui se développent parfois en faisant le pari d’ignorer volontairement les structures établies.
Sous la forme au départ d’une espèce de récréation intellectuelle, un autre axe de réflexion a aussi consisté à essayer d’introduire la science-fiction en science politique, ce qui m’a d’ailleurs un peu coûté dans la manière dont a été perçu mon travail de recherche. J’ai voulu montrer, ou confirmer, que les œuvres du genre peuvent être également utiles à la réflexion politique, notamment pour des enjeux à peine émergents. D’où, il y a quelques années, un premier article intitulé « Ce que la science-fiction pourrait apporter à la pensée politique », qui était en quelque sorte la première pièce à vocation programmatique et qui visait aussi, de manière sous-jacente, à sortir des considérations dédaigneuses vis-à-vis du genre. Mais, dans les milieux académiques français, il y a encore du chemin à faire avant que la science-fiction soit vraiment admise en dehors du seul domaine des études littéraires. Peut-être que le type d’approche que j’essaye de pousser y contribuera.
Pour en arriver à ma modeste participation à ce recueil, il était logique que la connexion se fasse un jour entre ces champs de recherche, et j’avais d’ailleurs des demandes pour cela, mais, comme souvent, la difficulté est de trouver le temps pour s’y mettre. Je suis ravi que ce soit finalement sous la forme de cette postface. D’autant que j’ai apprécié les nouvelles, que j’ai eu la chance de lire presque en avant-première.
Quel lecteur de science-fiction êtes-vous ?
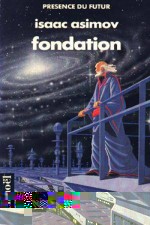 Un lecteur assez ancien maintenant, qui, comme beaucoup, a commencé à explorer cette littérature à l’adolescence. En l’occurrence, avec des auteurs déjà presque classiques à l’époque : Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Silverberg. J’ai dévoré les romans de la série Fondation. J’ai accompagné en imagination Bilbo le Hobbit. J’ai voyagé avec la Collection « L'âge des étoiles » de Robert Laffont.
Un lecteur assez ancien maintenant, qui, comme beaucoup, a commencé à explorer cette littérature à l’adolescence. En l’occurrence, avec des auteurs déjà presque classiques à l’époque : Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Silverberg. J’ai dévoré les romans de la série Fondation. J’ai accompagné en imagination Bilbo le Hobbit. J’ai voyagé avec la Collection « L'âge des étoiles » de Robert Laffont.
Et puis au fur et à mesure, les lectures se sont élargies, au fil de ce que j’ai pu trouver dans les bibliothèques. Progressivement, sous l’effet probablement de ma fréquentation croissante des sciences sociales, j’ai eu tendance à m’orienter vers une science-fiction ayant davantage un contenu en idées, ou en tout cas pouvant être perçue comme tel. D’où un intérêt pour le courant cyberpunk, pour des auteurs comme Philip K. Dick (et j’aurais presque envie de rajouter : évidemment !), Greg Bear, Norman Spinrad, Neal Stephenson, plus récemment Cory Doctorow.
Outre votre postface à Sept secondes pour devenir un aigle, vous êtes également intervenus sur ActuSF au sujet du cycle de la Culture d’Iain M. Banks.
Je me suis effectivement beaucoup intéressé à la partie de l’œuvre d’Iain M. Banks concernant la Culture, dont je me suis servi pour un exercice expérimental de théorie politique. Je trouvais intéressant l’idée de pousser loin l’hypothèse d’une place croissante des machines dans la vie sociale, en tirant cette hypothèse hors du registre dystopique très souvent présent dans l’imaginaire. À quoi ressemblerait un régime politique ouvert, plutôt libertaire, qui aurait fait le choix de déléguer un large champ d’activités à des intelligences artificielles ? Sur quelles bases pourrait fonctionner cette « anarchie assistée par ordinateur » ? Ce qui rejoint d’autres questions qui me travaillent actuellement sur les effets potentiellement politiques de la phase d’automatisation massive qui semble maintenant enclenchée. Que devient l’idée de travail, qui a fini par devenir centrale dans le modèle social et économique dominant, s’il est de plus en plus confié à des automates ou des robots ? C’est potentiellement un bouleversement économique, mais aussi politique. Que choisit-on (si choix délibéré il y a) de déléguer collectivement aux machines ?

Dans la postface, vous revenez souvent sur le terme d'anthropocène. Quelle est son origine ?
Les scientifiques ont utilisé différents noms pour qualifier les ères géologiques. L’anthropocène serait la plus récente, celle dans laquelle l’espèce humaine serait entrée du fait de sa propre intervention dans la multiplicité des processus qui participent à l’évolution de la planète. Autrement dit, l’activité humaine se serait développée au point de devenir une force qu’on peut qualifier de « géologique », tant ses effets sont puissants.
Derrière le qualificatif, c’est une manière de désigner un enjeu central du monde vers lequel nous avançons : la manière dont l’espèce humaine traite son habitat global et la possibilité justement de maintenir des conditions d’habitabilité. C’est aussi une manière de dire que la planète dans son ensemble est entrée dans le champ des responsabilités collectives (même si toutes ne sont pas égales) et que toute une série d’actes ne pourront désormais plus être faits sans penser à leurs conséquences, écologiques spécialement.
De ce point de vue, l’idée sous-jacente de la postface, en écho aux nouvelles du recueil, était de dire qu’il va devenir difficile de faire de la science-fiction, au moins pour celle qui prétend se situer dans un futur terrestre, sans tenir compte de ces paramètres. La manière dont se construisent les imaginaires est importante, et compte tenu de sa présence croissante, bien au-delà de la littérature, la science-fiction pourrait devenir un des espaces centraux où va être représenté l’avenir écologique de la planète. Dans tout cela, il y a une part de politique, et loin d’être négligeable.

Pensez-vous qu’il soit possible d’écrire une telle science-fiction sur un mode optimiste ? Les romans que vous citez dans votre postface n’imaginent pas un avenir radieux. Pour reprendre le titre de l’une de vos conférences, y a-t-il en SF une alternative au pessimisme ?
 Par réaction devant la montée d’un imaginaire catastrophiste (qui peut au demeurant trouver des justifications, mais qui devient aussi lassant à force d’être répétitif), mes réflexions les plus récentes ont en effet essayé de retrouver des versions davantage porteuses d’espérance, d’autres lignes de fuite pour reprendre un langage plus philosophique. Dans ce qui devrait déboucher sur un article plutôt universitaire, je reconstruis différentes figures à partir desquelles on peut commencer à réarticuler des assemblages de propositions : par exemple ce que j’ai appelé la « sécession arcadienne » chez Ernest Callenbach, ou la « frugalité autogérée » chez Ursula Le Guin, ou encore « l’abstention technologique » chez Michel Jeury. Il s’agit de montrer qu’un imaginaire comme celui de la science-fiction peut être un appui pour décloisonner et élargir le champ des possibles.
Par réaction devant la montée d’un imaginaire catastrophiste (qui peut au demeurant trouver des justifications, mais qui devient aussi lassant à force d’être répétitif), mes réflexions les plus récentes ont en effet essayé de retrouver des versions davantage porteuses d’espérance, d’autres lignes de fuite pour reprendre un langage plus philosophique. Dans ce qui devrait déboucher sur un article plutôt universitaire, je reconstruis différentes figures à partir desquelles on peut commencer à réarticuler des assemblages de propositions : par exemple ce que j’ai appelé la « sécession arcadienne » chez Ernest Callenbach, ou la « frugalité autogérée » chez Ursula Le Guin, ou encore « l’abstention technologique » chez Michel Jeury. Il s’agit de montrer qu’un imaginaire comme celui de la science-fiction peut être un appui pour décloisonner et élargir le champ des possibles.
En matière d’écologie, la science-fiction peut-elle prêcher à d’autres que des convertis ? A-t-elle capacité à s’extirper du dédain dans lequel elle est parfois tenue ?
Pas facile. A fortiori avec les clichés que tend à véhiculer et reproduire le cinéma hollywoodien. Mais, en littérature, il y a beaucoup de productions de qualité à faire valoir. Internet permet plus facilement de les promouvoir, de les discuter. Ce que je vois aussi se développer de manière intéressante dans le monde anglophone, ce sont des chercheurs en sciences sociales qui s’inspirent de ce registre pour construire des hypothèses et travailler sur des scénarios. Ou qui proposent de réinterpréter ce début de siècle sous la forme de l’histoire d’un tournant (n’ayant pas été saisi à sa juste mesure, en l’occurrence), narrée à partir d’une position future. Cette espèce de science-fiction importée dans la pratique des sciences sociales me semble une façon un peu neuve et intellectuellement stimulante pour enclencher des analyses de l’époque.

On reproche parfois à la science-fiction d’être rattrapée par le présent et de ne plus rien avoir à offrir en termes de prospective. Estimez-vous que cette littérature puisse continuer à être pertinente face à l’avenir ?
Je pense, et c’est ce qui m’intéresse, qu’elle peut permettre de continuer à construire des expériences de pensée. L’exercice peut être stimulant sur des enjeux qui se dessinent et qui sont marqués par l’incertitude, avec une part dans le présent donc et une autre pouvant se tourner vers des horizons largement ouverts. Il est vrai qu’un tel travail peut être plus difficile, parce qu’il oblige à un gros effort de documentation sur des évolutions technoscientifiques complexes à saisir. Mais pour le lecteur, cela peut aboutir au genre de petit plaisir qui se produit lorsqu’on se dit : « Tiens, en effet, je n’avais pas pensé à ces implications ». Voilà pourquoi, parfois, j’aimerais bien aussi qu’il y ait un peu plus de prise de risques sur des enjeux que j’ai l’impression de voir peu traités, comme la biomédecine. On pourrait me répondre que cela fait au moins une raison de s’y mettre soi-même. Mais, en plus du temps à trouver, ce serait un autre type d’écriture…
*
• Le blog de Yannick Rumpala ;
• la postface à Sept secondes pour devenir un aigle ;
• l'article Penser les espérances écologiques avec la science-fiction.


 Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Vous êtes maître de conférences à l'Université de Nice : qu'y enseignez-vous et sur quoi portent vos recherches ?
Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Vous êtes maître de conférences à l'Université de Nice : qu'y enseignez-vous et sur quoi portent vos recherches ?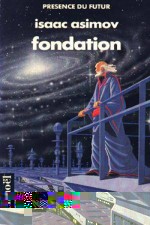 Un lecteur assez ancien maintenant, qui, comme beaucoup, a commencé à explorer cette littérature à l’adolescence. En l’occurrence, avec des auteurs déjà presque classiques à l’époque : Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Silverberg. J’ai dévoré les romans de la série Fondation. J’ai accompagné en imagination Bilbo le Hobbit. J’ai voyagé avec la Collection « L'âge des étoiles » de Robert Laffont.
Un lecteur assez ancien maintenant, qui, comme beaucoup, a commencé à explorer cette littérature à l’adolescence. En l’occurrence, avec des auteurs déjà presque classiques à l’époque : Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Silverberg. J’ai dévoré les romans de la série Fondation. J’ai accompagné en imagination Bilbo le Hobbit. J’ai voyagé avec la Collection « L'âge des étoiles » de Robert Laffont.

 Par réaction devant la montée d’un imaginaire catastrophiste (qui peut au demeurant trouver des justifications, mais qui devient aussi lassant à force d’être répétitif), mes réflexions les plus récentes ont en effet essayé de retrouver des versions davantage porteuses d’espérance, d’autres lignes de fuite pour reprendre un langage plus philosophique. Dans ce qui devrait déboucher sur un article plutôt universitaire, je reconstruis différentes figures à partir desquelles on peut commencer à réarticuler des assemblages de propositions : par exemple ce que j’ai appelé la « sécession arcadienne » chez Ernest Callenbach, ou la « frugalité autogérée » chez Ursula Le Guin, ou encore « l’abstention technologique » chez Michel Jeury. Il s’agit de montrer qu’un imaginaire comme celui de la science-fiction peut être un appui pour décloisonner et élargir le champ des possibles.
Par réaction devant la montée d’un imaginaire catastrophiste (qui peut au demeurant trouver des justifications, mais qui devient aussi lassant à force d’être répétitif), mes réflexions les plus récentes ont en effet essayé de retrouver des versions davantage porteuses d’espérance, d’autres lignes de fuite pour reprendre un langage plus philosophique. Dans ce qui devrait déboucher sur un article plutôt universitaire, je reconstruis différentes figures à partir desquelles on peut commencer à réarticuler des assemblages de propositions : par exemple ce que j’ai appelé la « sécession arcadienne » chez Ernest Callenbach, ou la « frugalité autogérée » chez Ursula Le Guin, ou encore « l’abstention technologique » chez Michel Jeury. Il s’agit de montrer qu’un imaginaire comme celui de la science-fiction peut être un appui pour décloisonner et élargir le champ des possibles.