Qui aurait envie de vivre sur une planète de moins en moins habitable ? Peu de personnes, assurément. C’est pourtant un futur de plus en plus craint et, singulièrement, le futur que semble nous promettre une large part de la science-fiction. Comme si elle extrapolait les tendances inquiétantes qui semblent en cours. De fait, en quelques millénaires, les capacités de l’espèce humaine ont considérablement augmenté, au point qu’elles semblent désormais saturer et menacer les fonctionnements écologiques de la planète. De sa planète même, pourrait-on préciser, puisque semble également émerger une forme de conscience collective de ce changement fondamental. Les êtres humains ont pendant des siècles aménagé le monde pour leurs besoins et désirs ; ils doivent maintenant réaliser que l’ensemble de leurs activités peut aller jusqu’à transformer la biosphère au plus profond de ses mécanismes régulateurs.
Un mot existe, récemment proposé, pour désigner la puissance ainsi acquise: celui d’anthropocène. Le terme, qui déborde maintenant les milieux scientifiques qui l’ont promu, est censé signaler l’entrée récente (à l’échelle temporelle de la planète) dans une ère géologique nouvelle, où l’espèce humaine est devenue une force capable d’altérer l’ensemble du système terrestre. Et, au surplus, à un rythme qui paraît sans précédent dans le déroulement des temps géologiques. Les traces visibles ne sont plus de simples égratignures sur la surface planétaire. Les données, connaissances, rapports qui s’accumulent alimentent les inquiétudes. L’unité de compte est devenue le nombre de planètes Terre qui seraient nécessaires à une humanité qui poursuivrait son développement en restant accrochée aux logiques actuellement dominantes. La modernité industrielle s’est installée comme si elle n’avait pas besoin de tenir compte des milieux dans lesquels elle puisait, de l’environnement sur lequel elle s’appuyait. Ce temps semble révolu.
Les conséquences sont importantes pour l’ensemble des activités humaines. Y compris, bien sûr, celles de l’imaginaire. Pour toutes les œuvres à venir qui prétendront représenter le devenir de l’humanité, les environnements, les milieux écologiques, les substrats biologiques ne pourront plus être un simple décor. Ce sera aussi le cas pour la science-fiction, et elle a d’ailleurs peut-être l’avantage d’avoir anticipé le mouvement. Ces enjeux écologiques, elle a déjà contribué à les mettre en scène et, très probablement, ils seront plus souvent présents comme des rappels récurrents des situations dégradées qui sont en train d’être produites. Pour le lecteur attentif, ce recueil est aussi une manière de rappeler ces enjeux, par petites touches, sans forcément d’ailleurs relever intimement de la science-fiction.

Perception diffuse d’un changement global et imprégnation de l’imaginaire
 L’accumulation des menaces sur l’environnement et la biosphère imprègne déjà les imaginaires de la fiction. Les inquiétudes sont telles que la fin de ce monde, ou au moins de la civilisation actuelle, est devenue une hypothèse non seulement envisageable, mais aussi propice à de nombreuses formes de mise en scène (sans être forcément péjoratif). Dans la littérature de science-fiction, des romans devenus classiques, comme Soleil vert (1966) d’Harry Harrison, et Tous à Zanzibar (1968) de John Brunner, décrivaient déjà les effets de la surpopulation et les conséquences de la surexploitation des écosystèmes. La production fictionnelle dans ce type de veine a largement été enrichie depuis, à mesure que les risques ont paru davantage perceptibles. La science-fiction apocalyptique est devenue un sous-genre foisonnant, dans lequel les menaces environnementales peuvent être poussées à leur paroxysme. Forcément propice à la dramatisation, la catastrophe écologique a elle aussi été soumise aux règles de la spectacularisation, et personne n’est plus vraiment surpris de la voir maintenant figurer parmi les ingrédients cinématographiques courants. Au point même que les images d’une « vraie » catastrophe nucléaire, comme celles de l’accident de Fukushima, et du type de vie collective qui lui fait suite (que la nouvelle « Shikata ga nai » de ce recueil retravaille à sa manière) peuvent donner une impression de déjà-vu.
L’accumulation des menaces sur l’environnement et la biosphère imprègne déjà les imaginaires de la fiction. Les inquiétudes sont telles que la fin de ce monde, ou au moins de la civilisation actuelle, est devenue une hypothèse non seulement envisageable, mais aussi propice à de nombreuses formes de mise en scène (sans être forcément péjoratif). Dans la littérature de science-fiction, des romans devenus classiques, comme Soleil vert (1966) d’Harry Harrison, et Tous à Zanzibar (1968) de John Brunner, décrivaient déjà les effets de la surpopulation et les conséquences de la surexploitation des écosystèmes. La production fictionnelle dans ce type de veine a largement été enrichie depuis, à mesure que les risques ont paru davantage perceptibles. La science-fiction apocalyptique est devenue un sous-genre foisonnant, dans lequel les menaces environnementales peuvent être poussées à leur paroxysme. Forcément propice à la dramatisation, la catastrophe écologique a elle aussi été soumise aux règles de la spectacularisation, et personne n’est plus vraiment surpris de la voir maintenant figurer parmi les ingrédients cinématographiques courants. Au point même que les images d’une « vraie » catastrophe nucléaire, comme celles de l’accident de Fukushima, et du type de vie collective qui lui fait suite (que la nouvelle « Shikata ga nai » de ce recueil retravaille à sa manière) peuvent donner une impression de déjà-vu.

En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que la science-fiction ne manque pas de scénarios pour imaginer comment une civilisation se délite suite à un effondrement progressif ou rapide. Ce faisant, son art est de déconstruire les fondements de sociétés supposément avancées, montrant aussi leur fragilité potentielle ou, au minimum, leur contingence. Les représentations produites et véhiculées sont importantes, parce qu’elles fournissent un cadre de perception et d’interprétation des situations et des problèmes. Habiter le monde, c’est aussi devoir concéder une certaine forme de dépendance à son égard.
La science-fiction comme manière de représenter le rapport des espèces pensantes à leur habitat
La science-fiction a saisi de multiples façons la faculté de mettre en scène les rapports des espèces pensantes à leur habitat, que ce soit l’espèce humaine ou d’autres espèces extraterrestres. À leur manière, les œuvres du genre donnent aussi à voir ce que peuvent devenir les milieux de vie, en fonction de la manière dont ils sont traités par les humains ou les êtres qui les occupent. Ces propositions imaginaires permettent de représenter ce que pourraient être les capacités d’adaptation de ces milieux. Par exemple jusqu’au point où ces milieux pourraient être intensément exploités et mis en péril.
 L’espèce humaine dans son ensemble s’est dangereusement rapprochée de ce point, et la question maintenant est peut-être même de savoir s’il s’agit d’un point de non-retour. Ainsi, en matière de climat : la « condition Vénus », l’hypothèse qui sert de repoussoir dans le roman Bleue comme une orange (1999) de Norman Spinrad, en représenterait l’aboutissement irréversible, celui d’un monde rendu difficilement vivable par un réchauffement généralisé.
L’espèce humaine dans son ensemble s’est dangereusement rapprochée de ce point, et la question maintenant est peut-être même de savoir s’il s’agit d’un point de non-retour. Ainsi, en matière de climat : la « condition Vénus », l’hypothèse qui sert de repoussoir dans le roman Bleue comme une orange (1999) de Norman Spinrad, en représenterait l’aboutissement irréversible, celui d’un monde rendu difficilement vivable par un réchauffement généralisé.
Si l’espèce humaine est capable de détruire la planète, est-elle aussi capable de la préserver ? Est-elle capable de tenir compte des mises en garde que pouvaient déjà constituer des œuvres classiques comme Soleil vert, dans lequel la pollution a annihilé les possibilités de vie végétale et animale ? Une part incompressible d’optimisme peut certes conduire à maintenir une confiance dans l’intelligence collective, mais des choix devront être faits. Si préserver la planète suppose certains abandons dans les modes de vie, que choisit-on d’abandonner ? De ce point de vue, il est intéressant de repérer et d’examiner ce que la science-fiction garde de notre monde actuel, ce qu’elle retire, rajoute (car c’est là une des marques constitutives du travail imaginaire auquel elle sert de cadre).
 Prenons un des symboles majeurs du modèle civilisationnel qui s’est développé au siècle dernier. Est-il par exemple encore possible d’imaginer un futur sans voitures, vu leur présence massive et centrale dans les systèmes de mobilité d’aujourd’hui ? Partout où elle s’est développée, l’automobile a fortement contribué à configurer l’espace, notamment urbain, à transformer les paysages, à cyborgiser les déplacements humains.
Prenons un des symboles majeurs du modèle civilisationnel qui s’est développé au siècle dernier. Est-il par exemple encore possible d’imaginer un futur sans voitures, vu leur présence massive et centrale dans les systèmes de mobilité d’aujourd’hui ? Partout où elle s’est développée, l’automobile a fortement contribué à configurer l’espace, notamment urbain, à transformer les paysages, à cyborgiser les déplacements humains.
Certains pourraient trouver un espoir en voyant démenties des projections qui furent récurrentes dans la science-fiction. Les villes européennes de ce début de XXIe siècle ne sont pas celles des voitures volantes (et donc pas celles des embouteillages aériens), mais celles du retour du tramway et de la promotion de la bicyclette.
Les conditions laissées, il va falloir de toute manière les gérer. Le futur est déjà là. Du temps, il en faudra en effet beaucoup pour pouvoir faire évoluer des structures urbaines devenues expansives et tentaculaires. Les choix urbanistiques ont des effets sur des durées longues et les routes, bâtiments, infrastructures, construits aujourd’hui resteront probablement longtemps dans les paysages.
 Les possibilités d’évolution sont compliquées par la dépendance aux énergies fossiles. La science-fiction a abondamment montré comment l’épuisement du pétrole pouvait devenir problématique et remettre en cause jusqu’aux modes d’organisation sociale (En panne sèche [2007] d’Andreas Eschbach en est un bel exemple). La description de villes surpeuplées a aussi été une manière de faire résonner les craintes sur la capacité de la planète à supporter une pression démographique croissante. Comment accueillir et faire vivre une population humaine plus nombreuse ? L’humanité décrite par Robert Silverberg dans Les Monades urbaines (1971) a réussi à gérer la surpopulation, mais au prix de sa concentration dans de gigantesques tours.
Les possibilités d’évolution sont compliquées par la dépendance aux énergies fossiles. La science-fiction a abondamment montré comment l’épuisement du pétrole pouvait devenir problématique et remettre en cause jusqu’aux modes d’organisation sociale (En panne sèche [2007] d’Andreas Eschbach en est un bel exemple). La description de villes surpeuplées a aussi été une manière de faire résonner les craintes sur la capacité de la planète à supporter une pression démographique croissante. Comment accueillir et faire vivre une population humaine plus nombreuse ? L’humanité décrite par Robert Silverberg dans Les Monades urbaines (1971) a réussi à gérer la surpopulation, mais au prix de sa concentration dans de gigantesques tours.
L’entrée dans l’anthropocène, c’est donc surtout l’entrée dans l’ère où les humains vont devoir apprendre à penser et agir en pensant systématiquement aux conséquences de ce qu’ils font. À moins d’innovations technologiques grandioses, les gaz à effet de serre envoyés dans l’atmosphère y resteront probablement longtemps présents. Idem pour les plastiques et la masse de déchets qui sont ainsi disséminés, que ce soit sur les terres ou dans les océans.
 Quel monde va être transmis ? Avec quelles contraintes ? Avec quelles concessions à faire en termes de confort ? Ce qui passe maintenant pour des commodités communes et quotidiennes (accès à l’eau, multi-équipement domestique, etc.) risque d’être sérieusement perturbé. Ce confort n’est plus garanti et les journées pourraient être rythmées par de nouvelles contraintes, plus désagréables. Il y a ce type d’anticipation dans Babylon Babies (1999) de Maurice G. Dantec, où les douches sont minutées et leur durée est limitée pour économiser l’eau (ce type de dispositif est aujourd’hui disponible sur le marché, mais pas encore obligatoire).
Quel monde va être transmis ? Avec quelles contraintes ? Avec quelles concessions à faire en termes de confort ? Ce qui passe maintenant pour des commodités communes et quotidiennes (accès à l’eau, multi-équipement domestique, etc.) risque d’être sérieusement perturbé. Ce confort n’est plus garanti et les journées pourraient être rythmées par de nouvelles contraintes, plus désagréables. Il y a ce type d’anticipation dans Babylon Babies (1999) de Maurice G. Dantec, où les douches sont minutées et leur durée est limitée pour économiser l’eau (ce type de dispositif est aujourd’hui disponible sur le marché, mais pas encore obligatoire).
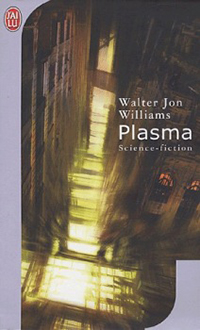 L’humanité adaptera donc peut-être son quotidien et ses modes de vie. Mais qu’est-ce qui sera perdu, et peut-être à jamais ? D’un autre côté, les humains ont une propension à rajouter quantité d’artefacts dans leur environnement. De quelles machines vont-ils continuer à s’entourer ? Et de quelle énergie vont-ils nourrir ces machines ? Plasma (1995) de Walter Jon Williams montre bien qu’accéder de manière presque magique à une énergie puissante peut se payer d’un certain prix, potentiellement élevé, qui peut accroître fortement les tendances oligarchiques et les inégalités sociales.
L’humanité adaptera donc peut-être son quotidien et ses modes de vie. Mais qu’est-ce qui sera perdu, et peut-être à jamais ? D’un autre côté, les humains ont une propension à rajouter quantité d’artefacts dans leur environnement. De quelles machines vont-ils continuer à s’entourer ? Et de quelle énergie vont-ils nourrir ces machines ? Plasma (1995) de Walter Jon Williams montre bien qu’accéder de manière presque magique à une énergie puissante peut se payer d’un certain prix, potentiellement élevé, qui peut accroître fortement les tendances oligarchiques et les inégalités sociales.
Comment l’humanité peut-elle aussi éviter de se faire déborder par les flux de matières qu’elle a elle-même produits? Dans l’imaginaire de la science-fiction, même les civilisations les plus évoluées semblent aussi devoir penser à la manière de gérer leurs déchets. Même l’Étoile noire, symbole ultime de la puissance technique et destructrice dans Star Wars, a des déchets à éliminer (et donc des broyeurs qui permettent d’ajouter quelques péripéties).
La (re)découverte de l’enjeu de l’habitabilité terrestre
Lorsqu’elle touche aux questions d’écologie, ce que redécouvre et problématise la science-fiction, c’est l’enjeu de l’habitabilité terrestre. Dit autrement, sous forme de question : comment faire pour que la planète soit encore habitable ? Cette interrogation, la science-fiction la traduit dans une esthétique, et même, poussons cette hypothèse, dans une forme d’éthique. Sous ce dernier angle, l’habitabilité dépasse alors la question de l’occupation d’un espace ; elle renvoie aussi à la préservation de conditions de vie pour des collectivités. En l’occurrence, des collectivités qui, pour leur partie humaine, sont de plus en plus obligées de réfléchir à leurs propres conduites, de revenir sur ce qu’elles font autour d’elles.
L’espèce humaine a colonisé les écosystèmes, souvent sans les ménager. Quel que soit l’espace envisagé, son habitabilité n’est pas garantie (jamais, même) : elle peut être dégradée par une exploitation trop intensive, par des pollutions et des nuisances, elles-mêmes résultant pour une large part des modes de production et de consommation dominants. L’habitabilité peut aussi dépendre d’éléments qui ne sont pas directement visibles et dont les effets ne se font sentir que par accumulation, comme la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, conséquence de plus en plus problématique d’un mode de développement énergivore et de l’enfermement dans une trajectoire « thermo-industrielle » (pour parler comme le sociologue des techniques Alain Gras).
 Comment l’humanité va-t-elle faire pour satisfaire ses besoins d’énergie croissants ? Les consommations énergétiques sont-elles condamnées à croître ou peuvent-elles être réduites? Par quelles difficultés l’épuisement des réserves pétrolières peut-il se payer ? Par une régression technologique et politique, à l’image de celle que Robert Charles Wilson utilise comme hypothèse dans Julian (2009) ? Voire par une forme de libération générale de la prédation et de la violence, comme dans la série des Mad Max ?
Comment l’humanité va-t-elle faire pour satisfaire ses besoins d’énergie croissants ? Les consommations énergétiques sont-elles condamnées à croître ou peuvent-elles être réduites? Par quelles difficultés l’épuisement des réserves pétrolières peut-il se payer ? Par une régression technologique et politique, à l’image de celle que Robert Charles Wilson utilise comme hypothèse dans Julian (2009) ? Voire par une forme de libération générale de la prédation et de la violence, comme dans la série des Mad Max ?
Cette habitabilité ne peut plus être envisagée dans un rapport simplement local, mais doit désormais être pensée à une échelle globale (ou plutôt écouménale, pour insister sur les aspects relationnels et reprendre la belle notion d’écoumène, subtilement retravaillée par le géographe Augustin Berque). La science-fiction a un temps d’avance sur ce que rendre une planète habitable veut dire. Plus précisément, elle a déjà tenté d’imaginer ce que signifie climatiser une planète. Par des formes de convergences entre les représentations mentales, la science-fiction résonne ainsi avec les ambitions montantes de la « géo-ingénierie ».
De plus en plus souvent présentée comme un recours possible, la « géo-ingénierie » n’est qu’un fantasme de transformation de la planète elle-même en machine. Elle vient comme une pièce supplémentaire dans ce qui s’apparente de plus en plus à la production d’une « technonature ». Pour éviter les effets perturbateurs des évolutions climatiques globales, l’ambition est rien moins que d’intervenir dans les processus bio-géo-physico-chimiques, par exemple en fertilisant les océans pour augmenter les capacités de photosynthèse du phytoplancton, ou en libérant des particules dans la haute atmosphère pour modifier le rayonnement solaire.
 À ce courant d’idées s’ajoute une autre tendance par laquelle la question écologique se trouve traduite dans une conception gestionnaire appliquée à tout ce qui pouvait auparavant relever du « naturel ». La biosphère et ses systèmes écologiques sont appareillés, numérisés, modélisés (ce que touche pour partie Bleue comme une orange, de Norman Spinrad, à travers l’enjeu de la modélisation du climat, mais il n’avait pas été jusqu’à imaginer que des quotas d’émissions de CO2puissent être cotés sur un marché de type boursier). Tous ces éléments « naturels » sont en train de rentrer dans une espèce de comptabilité planétaire, que les développements d’une instrumentation scientifique rendent davantage possible. Ces éléments deviennent calculables, justiciables d’un traitement rationalisé et assimilables dans des cycles de production et de consommation. Le substrat environnemental est transformé en « ressources », en « capital naturel », en « services écologiques », et peut alors devenir l’objet d’une forme de maintenance, à l’image de toute entité machinisée. Et, dans cette logique techniciste, si des problèmes subsistent, peut-être seront-ils résolus grâce à l’aide d’intelligences artificielles, dont la science-fiction a déjà aussi anticipé l’arrivée. Certains penseurs et promoteurs de la Singularité (un stade futur où les machines surpasseraient l’intelligence humaine) sont plus optimistes que la nouvelle « Lumière noire » de ce recueil, puisqu’ils font confiance aux intelligences artificielles pour trouver les solutions aux problèmes de gestion des ressources naturelles. Les puissances de calcul et les capacités de ces machines seraient censées faire mieux que les esprits d’humains potentiellement inconséquents ou insouciants.
À ce courant d’idées s’ajoute une autre tendance par laquelle la question écologique se trouve traduite dans une conception gestionnaire appliquée à tout ce qui pouvait auparavant relever du « naturel ». La biosphère et ses systèmes écologiques sont appareillés, numérisés, modélisés (ce que touche pour partie Bleue comme une orange, de Norman Spinrad, à travers l’enjeu de la modélisation du climat, mais il n’avait pas été jusqu’à imaginer que des quotas d’émissions de CO2puissent être cotés sur un marché de type boursier). Tous ces éléments « naturels » sont en train de rentrer dans une espèce de comptabilité planétaire, que les développements d’une instrumentation scientifique rendent davantage possible. Ces éléments deviennent calculables, justiciables d’un traitement rationalisé et assimilables dans des cycles de production et de consommation. Le substrat environnemental est transformé en « ressources », en « capital naturel », en « services écologiques », et peut alors devenir l’objet d’une forme de maintenance, à l’image de toute entité machinisée. Et, dans cette logique techniciste, si des problèmes subsistent, peut-être seront-ils résolus grâce à l’aide d’intelligences artificielles, dont la science-fiction a déjà aussi anticipé l’arrivée. Certains penseurs et promoteurs de la Singularité (un stade futur où les machines surpasseraient l’intelligence humaine) sont plus optimistes que la nouvelle « Lumière noire » de ce recueil, puisqu’ils font confiance aux intelligences artificielles pour trouver les solutions aux problèmes de gestion des ressources naturelles. Les puissances de calcul et les capacités de ces machines seraient censées faire mieux que les esprits d’humains potentiellement inconséquents ou insouciants.
Résonances entre imaginaires démiurgiques
Cette macro-ingénierie appliquée à la biosphère, qui semble s’ébaucher, a des aspects démiurgiques, ou au moins résonne avec des imaginaires démiurgiques. Comme s’il était possible de réparer la planète, de réparer son climat ou tout écosystème abîmé. La technologie, sous la forme d’une « géo-ingénierie », viendrait à la rescousse pour réduire les risques de changement climatique.
Cette climatisation de la planète ressemble fortement à ce que la science-fiction avait exploré avec l’idée de terraformation. Sauf que la terraformation s’appliquait plutôt à d’autres planètes que la Terre, puisqu’il s’agissait de modifier leurs milieux originels pour que puissent y vivre des colons humains. On peut faire l’hypothèse que cet imaginaire de la terraformation n’est pas étranger aux différents types d’initiatives prétendant aider à réajuster le climat terrestre. Il faudrait faire l’histoire de l’idée de terraformation, examiner ses liens et rapprochements avec celles d’ingénierie climatique.
À supposer que les solutions de la « géo-ingénierie » soient possibles techniquement, elles auraient un certain nombre d’étapes politiques à franchir. Il faudrait des accords internationaux, ne serait-ce que pour en répartir le coût et l’organisation. Planétologiste deviendra peut-être alors un nouveau type d’expertise, une fonction officielle, comme sur Arrakis, la planète aride qui sert de décor à Dune. Dans les romans de cette série commencée par Frank Herbert, certaines planètes disposent de satellites permettant de contrôler la météorologie et d’infléchir le climat. Aider à transformer les contrées désertiques en vaste jardin devient ainsi une perspective envisageable, comme dans Les Enfants de Dune (1976).
En cas d’erreurs, les initiatives de « géo-ingénierie » pourraient-elles être corrigées ? Qui serait considéré comme responsable? Un auteur inspiré pourra au moins trouver la matière pour raconter l’histoire d’une expérience de « géo-ingénierie » terrestre qui aura mal tourné.

Confirmation de la fin de la « nature »
 Dans l’anthropocène, il ne sera plus possible de parler de « nature ». Ou en tout cas plus de la même façon. L’idée ne fait plus sens. La question n’est même plus celle de la place de l’humanité dans la « nature ». La relation a changé. Si tant est qu’il soit encore possible de parler de « nature », celle-ci sera désormais une production humaine. Le vivant est devenu manipulable jusque dans son patrimoine génétique. Même les régions les plus reculées subissent de manière plus ou moins indirecte l’influence humaine. La nature « sauvage » n’a plus sa place que dans des espaces limités. Ou peut-être la croise-t-on encore fortuitement, sous forme fantomale, comme ici, dans « Éthologie du tigre », lors de la construction d’un complexe hôtelier à la lisière de la jungle cambodgienne.
Dans l’anthropocène, il ne sera plus possible de parler de « nature ». Ou en tout cas plus de la même façon. L’idée ne fait plus sens. La question n’est même plus celle de la place de l’humanité dans la « nature ». La relation a changé. Si tant est qu’il soit encore possible de parler de « nature », celle-ci sera désormais une production humaine. Le vivant est devenu manipulable jusque dans son patrimoine génétique. Même les régions les plus reculées subissent de manière plus ou moins indirecte l’influence humaine. La nature « sauvage » n’a plus sa place que dans des espaces limités. Ou peut-être la croise-t-on encore fortuitement, sous forme fantomale, comme ici, dans « Éthologie du tigre », lors de la construction d’un complexe hôtelier à la lisière de la jungle cambodgienne.
Il est devenu commun pour des milliers d’individus d’aller chercher de la « nature » sous une forme simulée, marchandisée, réaménagée dans des parcs récréatifs, tels ceux vendant leurs séjours en promettant de retrouver l’espèce d’idéal de la petite maison en forêt. Pour les espaces paraissant préservés, l’impression de beauté « naturelle » ne serait plus en fait que le résultat d’un travail assimilable à une forme de jardinage.
Pour nourrir les populations concentrées dans les villes, y verra-t-on aussi fleurir des fermes verticales, à l’instar de ces projets architecturaux rassemblant cultures végétales et élevage dans les étages d’un nouveau type de tours ? Des sortes de serres enfermées dans des bâtiments et où l’utilisation de tous les intrants, les conditions climatiques, pourraient être rationalisées et automatisées. Production locale certes, sans coûteux transports, mais marquant une étape supplémentaire dans l’artificialisation des relations avec la «nature». Les formes de culture qui se développent sur les toits des villes seront peut-être une étape permettant (par une voie indirecte) d’acclimater l’idée.

Certes, une Terre jardinée peut paraître offrir un avenir plus enviable que celui totalement artificialisé de la planète Trantor, qu’Isaac Asimov a placée comme capitale de l’Empire galactique dans ses romans de la série Fondation. L’urbanisation, tout en ayant permis de concentrer une population de quarante-cinq milliards d’habitants, a fini par couvrir l’ensemble de la planète, non seulement en surface, mais aussi loin en profondeur. Dans ces conditions, Trantor, même si elle donne l’illusion de la puissance, est condamnée à faire venir sa nourriture d’autres mondes, ce qui est presque une métaphore de ce que sont devenues les grandes métropoles d’aujourd’hui et de leur dépendance à l’égard des approvisionnements extérieurs.
 L’avenir semble donc être à la simulation de la « nature ». De fait, les modes de vie urbains ont progressivement réduit la conscience des cycles «naturels» (à commencer par la compréhension des processus permettant de produire la nourriture consommée quotidiennement). Les générations futures préféreront d’ailleurs peut-être la seconde nature des mondes virtuels, celle qui offre presque toutes les possibilités de (re)création et dont le « RêVe » de la nouvelle « Tjukurpa » serait une version possible, peuplée et aménagée au gré des fantasmes du concepteur dans une forme de retour aux origines du monde et de fidélité maintenue à la culture aborigène. Ou alors, ce sera une forme d’échappatoire à la « réalité », comme celle qui a déjà fait les beaux jours des romans cyberpunk et qui, dans une fusion de l’esprit avec les machines, permet d’occuper le temps à l’écart de la grisaille et de l’agressivité latente de cités devenues elles-mêmes cyborgs.
L’avenir semble donc être à la simulation de la « nature ». De fait, les modes de vie urbains ont progressivement réduit la conscience des cycles «naturels» (à commencer par la compréhension des processus permettant de produire la nourriture consommée quotidiennement). Les générations futures préféreront d’ailleurs peut-être la seconde nature des mondes virtuels, celle qui offre presque toutes les possibilités de (re)création et dont le « RêVe » de la nouvelle « Tjukurpa » serait une version possible, peuplée et aménagée au gré des fantasmes du concepteur dans une forme de retour aux origines du monde et de fidélité maintenue à la culture aborigène. Ou alors, ce sera une forme d’échappatoire à la « réalité », comme celle qui a déjà fait les beaux jours des romans cyberpunk et qui, dans une fusion de l’esprit avec les machines, permet d’occuper le temps à l’écart de la grisaille et de l’agressivité latente de cités devenues elles-mêmes cyborgs.
Que la «nature» devienne davantage une production humaine ne signifie pas pour autant l’entrée dans le règne de la prévisibilité et de la certitude. Beaucoup de connaissances restent encore à acquérir sur les processus écologiques et biosphériques. L’espèce humaine était dedans ; elle y sera encore plus. Autrement dit, elle en sera encore plus dépendante, au fur et à mesure qu’augmentera la conscience d’en affecter les fonctionnements. La planète est plus qu’un grand mécanisme ; elle ne sera pas une espèce de gros automate manipulable avant longtemps.
Sur la participation de la science-fiction à la construction d’une éthique du futur
S’il s’agit d’acquérir une forme renouvelée de conscience collective, la science-fiction a des avantages à proposer : elle sort l’espèce humaine du présentisme et la remet dans le temps long (ou au moins, dans un temps plus long). Sous forme imagée, elle rappelle que la puissance technologique comporte aussi des enjeux éthiques et politiques, notamment parce que le développement de cette puissance et son utilisation renvoient à des responsabilités.
 Cette éthique peut être vécue comme une affaire personnelle. Pour le héros de Zodiac (1988) de Neal Stephenson, comme pour d’autres militants écologistes, c’est un combat contre les industries polluantes et leurs pratiques douteuses. Combat, en effet, parce qu’il faut parfois en arriver à des méthodes vigoureuses. Ou sinon finissent par éclater des convictions portées à incandescence, sous forme de micro-résistances poussées à bout, comme celle de Johnny, l’Indien de la nouvelle « Sept secondes pour devenir un aigle », essayant de préserver ce qui reste d’un ancien monde. Avec le désespoir et la résolution de ceux qui n’ont plus rien à perdre. Johnny la Vérole a peut-être compris que certains acteurs économiques avaient davantage de responsabilités que d’autres. Mais il n’a éliminé qu’un protagoniste, pas changé le système.
Cette éthique peut être vécue comme une affaire personnelle. Pour le héros de Zodiac (1988) de Neal Stephenson, comme pour d’autres militants écologistes, c’est un combat contre les industries polluantes et leurs pratiques douteuses. Combat, en effet, parce qu’il faut parfois en arriver à des méthodes vigoureuses. Ou sinon finissent par éclater des convictions portées à incandescence, sous forme de micro-résistances poussées à bout, comme celle de Johnny, l’Indien de la nouvelle « Sept secondes pour devenir un aigle », essayant de préserver ce qui reste d’un ancien monde. Avec le désespoir et la résolution de ceux qui n’ont plus rien à perdre. Johnny la Vérole a peut-être compris que certains acteurs économiques avaient davantage de responsabilités que d’autres. Mais il n’a éliminé qu’un protagoniste, pas changé le système.
 Le maintien d’une habitabilité planétaire oblige aussi à penser l’être-en-commun. La raréfaction des ressources va-t-elle alors supposer des formes de sobriété collective ? Quelle serait la version future des cartes de rationnement ?
Le maintien d’une habitabilité planétaire oblige aussi à penser l’être-en-commun. La raréfaction des ressources va-t-elle alors supposer des formes de sobriété collective ? Quelle serait la version future des cartes de rationnement ?
La technologie sert souvent de refuge à ceux qui espèrent pouvoir garder les avantages de notre monde actuel. Pour partie, ce sont aussi ceux qui pensent que l’avenir de l’humanité se joue dans les laboratoires de recherche. Une bonne part des œuvres de science-fiction conserve une inclination vers les technologies lourdes. L’intensité technologique va-t-elle continuer à augmenter ? Des solutions techniques peuvent-elles remplacer des fonctions « naturelles » ?
 D’autres propositions radicales arrivent aussi dans les discussions. Va-t-on aller jusqu’à manipuler le génome humain pour faciliter l’adaptation au changement climatique ? Certains pourraient penser que ces manipulations sont moins risquées que celles de la biosphère par la « géo-ingénierie », et que de toute manière, c’est aux humains d’assumer le prix de leurs errements. L’idée a par exemple été émise de réduire la taille des humains pour qu’ils consomment moins d’énergie (sous forme de nourriture notamment), et ainsi réduisent leur empreinte écologique. Comme les capacités de manipulation de la part biologique de l’humain deviennent croissantes, d’autres idées viendront sans doute à être explorées dans ce sillage, à commencer, par exemple, par l’augmentation de la résistance à la chaleur et à la sécheresse, que certains jugeraient sans doute plus efficace que les « distilles » qui équipent les Fremen et assurent leur hydratation dans le monde désertique des romans de Frank Herbert. La solution génétique paraîtra plus rapide en tout cas que d’attendre l’adaptation de l’espèce humaine par des processus évolutifs « naturels ». Bref, si l’habitabilité de la planète paraît se réduire, il peut y avoir des tentations de proposer l’adaptation de la biologie humaine comme la solution (au bout du compte) la plus commode. Ce dilemme était aussi présent dans Ciel brûlant de minuit, un roman de Robert Silverberg publié en 1994 et mettant en scène la confrontation des options possibles face aux dérèglements écologiques accumulés.
D’autres propositions radicales arrivent aussi dans les discussions. Va-t-on aller jusqu’à manipuler le génome humain pour faciliter l’adaptation au changement climatique ? Certains pourraient penser que ces manipulations sont moins risquées que celles de la biosphère par la « géo-ingénierie », et que de toute manière, c’est aux humains d’assumer le prix de leurs errements. L’idée a par exemple été émise de réduire la taille des humains pour qu’ils consomment moins d’énergie (sous forme de nourriture notamment), et ainsi réduisent leur empreinte écologique. Comme les capacités de manipulation de la part biologique de l’humain deviennent croissantes, d’autres idées viendront sans doute à être explorées dans ce sillage, à commencer, par exemple, par l’augmentation de la résistance à la chaleur et à la sécheresse, que certains jugeraient sans doute plus efficace que les « distilles » qui équipent les Fremen et assurent leur hydratation dans le monde désertique des romans de Frank Herbert. La solution génétique paraîtra plus rapide en tout cas que d’attendre l’adaptation de l’espèce humaine par des processus évolutifs « naturels ». Bref, si l’habitabilité de la planète paraît se réduire, il peut y avoir des tentations de proposer l’adaptation de la biologie humaine comme la solution (au bout du compte) la plus commode. Ce dilemme était aussi présent dans Ciel brûlant de minuit, un roman de Robert Silverberg publié en 1994 et mettant en scène la confrontation des options possibles face aux dérèglements écologiques accumulés.
Ces solutions ne sont encore (heureusement, diraient sans doute beaucoup) que des solutions hypothétiques, et des amateurs de science-fiction prendront probablement plaisir à les travailler. Du côté de leurs avantages supposés, comme du côté de leurs inconvénients potentiels. Comment en effet être sûr que des innovations techniques présentées comme solutions n’auront pas d’effets indésirables ? Ou qu’elles ne donneront pas lieu à des usages détournés, à l’instar de ces projets militaires américains qui envisageaient de pouvoir utiliser des techniques permettant de modifier des conditions climatiques ou environnementales ?
Ou alors la solution ultime sera la fuite vers l’espace, sur d’autres planètes ou dans des satellites artificiels. Comme dans le film d’animation Wall-E (2008), pour fuir une Terre ensevelie sous les déchets…

Préalables à toute incursion imaginaire dans le futur de l’anthropocène
L’un des rares endroits où l’on peut voir vivre, agir, s’organiser les «générations futures» (et pour cause) est la science-fiction et ses constructions imaginaires. Si l’on s’y fiait uniquement, ce qui va leur arriver serait plus qu’un immense défi. L’avenir écologique de la planète y apparaît souvent imaginé dans le registre dystopique (avec différents niveaux : de la dégradation avancée à la catastrophe complète). C’est presque devenu un truisme de dire que la science-fiction est désormais majoritairement alarmiste ou pessimiste. La répétition des mêmes figures peut même finir par lasser. Il est plus rare de pouvoir trouver des imaginaires plus positifs. Les œuvres fictionnelles semblent en effet avoir plus de difficultés à imaginer une société qui serait parvenue à un état ou un niveau d’avancement plus respectueux de la « nature ». Autrement dit, il paraît plus facile d’accentuer des traits négatifs perceptibles dans les tendances actuelles et de produire des visions servant facilement de repoussoirs.
Pourquoi y en a-t-il si peu ? Cette quasi-absence pose en effet question. Pourquoi ne serait-il possible d’imaginer pour l’humanité un autre horizon que celui de la catastrophe écologique ? Pourquoi paraît-il plus difficile de construire par l’imagination un monde se situant dans un futur désirable? L’extrapolation des tendances actuelles mènerait-elle inévitablement vers un futur répulsif ?
La science-fiction peut aider à garder les esprits en éveil : face aux évidences apparentes, aux impressions de permanence et de normalité. Au vu des contraintes qui pourraient fortement peser avec l’entrée dans l’anthropocène, la science-fiction doit peut-être réinventer le futur, ouvrir une nouvelle gamme de potentialités. Son devoir, davantage encore, est peut-être de suspendre les hypothèses qui dominent le monde supposé réel et qui reconduisent les logiques du présent. C’est en effet l’un des rares espaces intellectuels où peuvent être radicalement repensées les conditions d’existence futures.
 Quelles régulations les collectivités humaines peuvent-elles réussir à mettre en place ? Habitabilité pour tous ? Pour une majorité ? Pour une minorité ? Qui pourra (encore) bénéficier d’un environnement préservé ? Dans La Vérité avant-dernière (1964), roman de Philip K. Dick, une minorité se partage la surface terrestre tandis que le reste de la population reste enfermée dans des abris antiatomiques, occupée à fabriquer des armements robotisés pour une guerre censée se dérouler en dehors.
Quelles régulations les collectivités humaines peuvent-elles réussir à mettre en place ? Habitabilité pour tous ? Pour une majorité ? Pour une minorité ? Qui pourra (encore) bénéficier d’un environnement préservé ? Dans La Vérité avant-dernière (1964), roman de Philip K. Dick, une minorité se partage la surface terrestre tandis que le reste de la population reste enfermée dans des abris antiatomiques, occupée à fabriquer des armements robotisés pour une guerre censée se dérouler en dehors.
Pourquoi une réflexion sur l’imaginaire écologique de la science-fiction pourrait-elle devenir importante ? Parce que cet imaginaire est aussi un territoire où s’affrontent différentes tentatives pour l’occuper ou l’orienter. Certaines grandes entreprises ont bien commencé à voir que, dans l’occupation de ce territoire, il y avait aussi un moyen de façonner le futur. C’est pour ce genre de raison (et guère par souci de soutenir des expressions artistiques) qu’Intel, la multinationale connue pour ses microprocesseurs, soutient par exemple un programme baptisé « The Tomorrow Project ». En gros, les explorations de science-fiction y sont vues comme des espèces de prototypes de possibles développements technologiques futurs. Sous le titre « Green Dreams », un concours de nouvelles a même été organisé sous l’égide de la branche américaine de ce « Tomorrow Project » afin de promouvoir non pas une utopie (presque un gros mot dans le contexte américain), mais un « futur soutenable » et « optimiste ».
Forcément, dans ces exercices de créativité intellectuelle, les enjeux ne sont pas que des enjeux techniques. Même si tout cela, vu de loin, ne paraît être que spéculation, les enjeux impliqués vont au-delà et contiennent une part de politique (au sens de ce qui touche les affaires collectives). Pour rester sur les questions écologiques, un imaginaire techniciste dominé par la « géo-ingénierie » et la biologie synthétique n’a évidemment pas les mêmes implications qu’un autre plus sensible à des formes de sobriété conviviale moins versées dans le high-tech. Par la construction d’hypothèses diversifiées, la science-fiction peut aussi avoir un rôle à jouer dans la façon dont la collectivité humaine va penser la manière d’habiter la planète. La seule qu’elle a. Pour l’instant au moins, car l’ailleurs planétaire reste davantage encore de la science-fiction…


 Depuis la révolution industrielle, nous voici entrés dans l’anthropocène, cette nouvelle époque géologique où l’influence de l’humanité sur la planète se fait sentir plus que jamais. Un phénomène auquel la science-fiction ne pouvait rester indifférente. Au travers de nombreux exemples tirés du corpus science-fictif,
Depuis la révolution industrielle, nous voici entrés dans l’anthropocène, cette nouvelle époque géologique où l’influence de l’humanité sur la planète se fait sentir plus que jamais. Un phénomène auquel la science-fiction ne pouvait rester indifférente. Au travers de nombreux exemples tirés du corpus science-fictif, 
 L’accumulation des menaces sur l’environnement et la biosphère imprègne déjà les imaginaires de la fiction. Les inquiétudes sont telles que la fin de ce monde, ou au moins de la civilisation actuelle, est devenue une hypothèse non seulement envisageable, mais aussi propice à de nombreuses formes de mise en scène (sans être forcément péjoratif). Dans la littérature de science-fiction, des romans devenus classiques, comme Soleil vert (1966) d’Harry Harrison, et Tous à Zanzibar (1968) de John Brunner, décrivaient déjà les effets de la surpopulation et les conséquences de la surexploitation des écosystèmes. La production fictionnelle dans ce type de veine a largement été enrichie depuis, à mesure que les risques ont paru davantage perceptibles. La science-fiction apocalyptique est devenue un sous-genre foisonnant, dans lequel les menaces environnementales peuvent être poussées à leur paroxysme. Forcément propice à la dramatisation, la catastrophe écologique a elle aussi été soumise aux règles de la spectacularisation, et personne n’est plus vraiment surpris de la voir maintenant figurer parmi les ingrédients cinématographiques courants. Au point même que les images d’une « vraie » catastrophe nucléaire, comme celles de l’accident de Fukushima, et du type de vie collective qui lui fait suite (que la nouvelle « Shikata ga nai » de ce recueil retravaille à sa manière) peuvent donner une impression de déjà-vu.
L’accumulation des menaces sur l’environnement et la biosphère imprègne déjà les imaginaires de la fiction. Les inquiétudes sont telles que la fin de ce monde, ou au moins de la civilisation actuelle, est devenue une hypothèse non seulement envisageable, mais aussi propice à de nombreuses formes de mise en scène (sans être forcément péjoratif). Dans la littérature de science-fiction, des romans devenus classiques, comme Soleil vert (1966) d’Harry Harrison, et Tous à Zanzibar (1968) de John Brunner, décrivaient déjà les effets de la surpopulation et les conséquences de la surexploitation des écosystèmes. La production fictionnelle dans ce type de veine a largement été enrichie depuis, à mesure que les risques ont paru davantage perceptibles. La science-fiction apocalyptique est devenue un sous-genre foisonnant, dans lequel les menaces environnementales peuvent être poussées à leur paroxysme. Forcément propice à la dramatisation, la catastrophe écologique a elle aussi été soumise aux règles de la spectacularisation, et personne n’est plus vraiment surpris de la voir maintenant figurer parmi les ingrédients cinématographiques courants. Au point même que les images d’une « vraie » catastrophe nucléaire, comme celles de l’accident de Fukushima, et du type de vie collective qui lui fait suite (que la nouvelle « Shikata ga nai » de ce recueil retravaille à sa manière) peuvent donner une impression de déjà-vu. En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que la science-fiction ne manque pas de scénarios pour imaginer comment une civilisation se délite suite à un effondrement progressif ou rapide. Ce faisant, son art est de déconstruire les fondements de sociétés supposément avancées, montrant aussi leur fragilité potentielle ou, au minimum, leur contingence. Les représentations produites et véhiculées sont importantes, parce qu’elles fournissent un cadre de perception et d’interprétation des situations et des problèmes. Habiter le monde, c’est aussi devoir concéder une certaine forme de dépendance à son égard.
En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que la science-fiction ne manque pas de scénarios pour imaginer comment une civilisation se délite suite à un effondrement progressif ou rapide. Ce faisant, son art est de déconstruire les fondements de sociétés supposément avancées, montrant aussi leur fragilité potentielle ou, au minimum, leur contingence. Les représentations produites et véhiculées sont importantes, parce qu’elles fournissent un cadre de perception et d’interprétation des situations et des problèmes. Habiter le monde, c’est aussi devoir concéder une certaine forme de dépendance à son égard.
 L’espèce humaine dans son ensemble s’est dangereusement rapprochée de ce point, et la question maintenant est peut-être même de savoir s’il s’agit d’un point de non-retour. Ainsi, en matière de climat : la « condition Vénus », l’hypothèse qui sert de repoussoir dans le roman Bleue comme une orange (1999) de Norman Spinrad, en représenterait l’aboutissement irréversible, celui d’un monde rendu difficilement vivable par un réchauffement généralisé.
L’espèce humaine dans son ensemble s’est dangereusement rapprochée de ce point, et la question maintenant est peut-être même de savoir s’il s’agit d’un point de non-retour. Ainsi, en matière de climat : la « condition Vénus », l’hypothèse qui sert de repoussoir dans le roman Bleue comme une orange (1999) de Norman Spinrad, en représenterait l’aboutissement irréversible, celui d’un monde rendu difficilement vivable par un réchauffement généralisé. Prenons un des symboles majeurs du modèle civilisationnel qui s’est développé au siècle dernier. Est-il par exemple encore possible d’imaginer un futur sans voitures, vu leur présence massive et centrale dans les systèmes de mobilité d’aujourd’hui ? Partout où elle s’est développée, l’automobile a fortement contribué à configurer l’espace, notamment urbain, à transformer les paysages, à cyborgiser les déplacements humains.
Prenons un des symboles majeurs du modèle civilisationnel qui s’est développé au siècle dernier. Est-il par exemple encore possible d’imaginer un futur sans voitures, vu leur présence massive et centrale dans les systèmes de mobilité d’aujourd’hui ? Partout où elle s’est développée, l’automobile a fortement contribué à configurer l’espace, notamment urbain, à transformer les paysages, à cyborgiser les déplacements humains. Les possibilités d’évolution sont compliquées par la dépendance aux énergies fossiles. La science-fiction a abondamment montré comment l’épuisement du pétrole pouvait devenir problématique et remettre en cause jusqu’aux modes d’organisation sociale (En panne sèche [2007] d’Andreas Eschbach en est un bel exemple). La description de villes surpeuplées a aussi été une manière de faire résonner les craintes sur la capacité de la planète à supporter une pression démographique croissante. Comment accueillir et faire vivre une population humaine plus nombreuse ? L’humanité décrite par Robert Silverberg dans Les Monades urbaines (1971) a réussi à gérer la surpopulation, mais au prix de sa concentration dans de gigantesques tours.
Les possibilités d’évolution sont compliquées par la dépendance aux énergies fossiles. La science-fiction a abondamment montré comment l’épuisement du pétrole pouvait devenir problématique et remettre en cause jusqu’aux modes d’organisation sociale (En panne sèche [2007] d’Andreas Eschbach en est un bel exemple). La description de villes surpeuplées a aussi été une manière de faire résonner les craintes sur la capacité de la planète à supporter une pression démographique croissante. Comment accueillir et faire vivre une population humaine plus nombreuse ? L’humanité décrite par Robert Silverberg dans Les Monades urbaines (1971) a réussi à gérer la surpopulation, mais au prix de sa concentration dans de gigantesques tours. Quel monde va être transmis ? Avec quelles contraintes ? Avec quelles concessions à faire en termes de confort ? Ce qui passe maintenant pour des commodités communes et quotidiennes (accès à l’eau, multi-équipement domestique, etc.) risque d’être sérieusement perturbé. Ce confort n’est plus garanti et les journées pourraient être rythmées par de nouvelles contraintes, plus désagréables. Il y a ce type d’anticipation dans Babylon Babies (1999) de Maurice G. Dantec, où les douches sont minutées et leur durée est limitée pour économiser l’eau (ce type de dispositif est aujourd’hui disponible sur le marché, mais pas encore obligatoire).
Quel monde va être transmis ? Avec quelles contraintes ? Avec quelles concessions à faire en termes de confort ? Ce qui passe maintenant pour des commodités communes et quotidiennes (accès à l’eau, multi-équipement domestique, etc.) risque d’être sérieusement perturbé. Ce confort n’est plus garanti et les journées pourraient être rythmées par de nouvelles contraintes, plus désagréables. Il y a ce type d’anticipation dans Babylon Babies (1999) de Maurice G. Dantec, où les douches sont minutées et leur durée est limitée pour économiser l’eau (ce type de dispositif est aujourd’hui disponible sur le marché, mais pas encore obligatoire).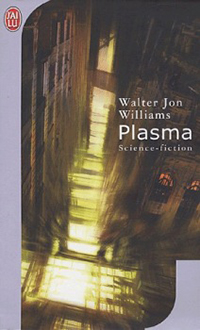 L’humanité adaptera donc peut-être son quotidien et ses modes de vie. Mais qu’est-ce qui sera perdu, et peut-être à jamais ? D’un autre côté, les humains ont une propension à rajouter quantité d’artefacts dans leur environnement. De quelles machines vont-ils continuer à s’entourer ? Et de quelle énergie vont-ils nourrir ces machines ? Plasma (1995) de Walter Jon Williams montre bien qu’accéder de manière presque magique à une énergie puissante peut se payer d’un certain prix, potentiellement élevé, qui peut accroître fortement les tendances oligarchiques et les inégalités sociales.
L’humanité adaptera donc peut-être son quotidien et ses modes de vie. Mais qu’est-ce qui sera perdu, et peut-être à jamais ? D’un autre côté, les humains ont une propension à rajouter quantité d’artefacts dans leur environnement. De quelles machines vont-ils continuer à s’entourer ? Et de quelle énergie vont-ils nourrir ces machines ? Plasma (1995) de Walter Jon Williams montre bien qu’accéder de manière presque magique à une énergie puissante peut se payer d’un certain prix, potentiellement élevé, qui peut accroître fortement les tendances oligarchiques et les inégalités sociales. Comment l’humanité va-t-elle faire pour satisfaire ses besoins d’énergie croissants ? Les consommations énergétiques sont-elles condamnées à croître ou peuvent-elles être réduites? Par quelles difficultés l’épuisement des réserves pétrolières peut-il se payer ? Par une régression technologique et politique, à l’image de celle que Robert Charles Wilson utilise comme hypothèse dans Julian (2009) ? Voire par une forme de libération générale de la prédation et de la violence, comme dans la série des Mad Max ?
Comment l’humanité va-t-elle faire pour satisfaire ses besoins d’énergie croissants ? Les consommations énergétiques sont-elles condamnées à croître ou peuvent-elles être réduites? Par quelles difficultés l’épuisement des réserves pétrolières peut-il se payer ? Par une régression technologique et politique, à l’image de celle que Robert Charles Wilson utilise comme hypothèse dans Julian (2009) ? Voire par une forme de libération générale de la prédation et de la violence, comme dans la série des Mad Max ? À ce courant d’idées s’ajoute une autre tendance par laquelle la question écologique se trouve traduite dans une conception gestionnaire appliquée à tout ce qui pouvait auparavant relever du « naturel ». La biosphère et ses systèmes écologiques sont appareillés, numérisés, modélisés (ce que touche pour partie Bleue comme une orange, de Norman Spinrad, à travers l’enjeu de la modélisation du climat, mais il n’avait pas été jusqu’à imaginer que des quotas d’émissions de CO2puissent être cotés sur un marché de type boursier). Tous ces éléments « naturels » sont en train de rentrer dans une espèce de comptabilité planétaire, que les développements d’une instrumentation scientifique rendent davantage possible. Ces éléments deviennent calculables, justiciables d’un traitement rationalisé et assimilables dans des cycles de production et de consommation. Le substrat environnemental est transformé en « ressources », en « capital naturel », en « services écologiques », et peut alors devenir l’objet d’une forme de maintenance, à l’image de toute entité machinisée. Et, dans cette logique techniciste, si des problèmes subsistent, peut-être seront-ils résolus grâce à l’aide d’intelligences artificielles, dont la science-fiction a déjà aussi anticipé l’arrivée. Certains penseurs et promoteurs de la Singularité (un stade futur où les machines surpasseraient l’intelligence humaine) sont plus optimistes que la nouvelle « Lumière noire » de ce recueil, puisqu’ils font confiance aux intelligences artificielles pour trouver les solutions aux problèmes de gestion des ressources naturelles. Les puissances de calcul et les capacités de ces machines seraient censées faire mieux que les esprits d’humains potentiellement inconséquents ou insouciants.
À ce courant d’idées s’ajoute une autre tendance par laquelle la question écologique se trouve traduite dans une conception gestionnaire appliquée à tout ce qui pouvait auparavant relever du « naturel ». La biosphère et ses systèmes écologiques sont appareillés, numérisés, modélisés (ce que touche pour partie Bleue comme une orange, de Norman Spinrad, à travers l’enjeu de la modélisation du climat, mais il n’avait pas été jusqu’à imaginer que des quotas d’émissions de CO2puissent être cotés sur un marché de type boursier). Tous ces éléments « naturels » sont en train de rentrer dans une espèce de comptabilité planétaire, que les développements d’une instrumentation scientifique rendent davantage possible. Ces éléments deviennent calculables, justiciables d’un traitement rationalisé et assimilables dans des cycles de production et de consommation. Le substrat environnemental est transformé en « ressources », en « capital naturel », en « services écologiques », et peut alors devenir l’objet d’une forme de maintenance, à l’image de toute entité machinisée. Et, dans cette logique techniciste, si des problèmes subsistent, peut-être seront-ils résolus grâce à l’aide d’intelligences artificielles, dont la science-fiction a déjà aussi anticipé l’arrivée. Certains penseurs et promoteurs de la Singularité (un stade futur où les machines surpasseraient l’intelligence humaine) sont plus optimistes que la nouvelle « Lumière noire » de ce recueil, puisqu’ils font confiance aux intelligences artificielles pour trouver les solutions aux problèmes de gestion des ressources naturelles. Les puissances de calcul et les capacités de ces machines seraient censées faire mieux que les esprits d’humains potentiellement inconséquents ou insouciants.
 Dans l’anthropocène, il ne sera plus possible de parler de « nature ». Ou en tout cas plus de la même façon. L’idée ne fait plus sens. La question n’est même plus celle de la place de l’humanité dans la « nature ». La relation a changé. Si tant est qu’il soit encore possible de parler de « nature », celle-ci sera désormais une production humaine. Le vivant est devenu manipulable jusque dans son patrimoine génétique. Même les régions les plus reculées subissent de manière plus ou moins indirecte l’influence humaine. La nature « sauvage » n’a plus sa place que dans des espaces limités. Ou peut-être la croise-t-on encore fortuitement, sous forme fantomale, comme ici, dans « Éthologie du tigre », lors de la construction d’un complexe hôtelier à la lisière de la jungle cambodgienne.
Dans l’anthropocène, il ne sera plus possible de parler de « nature ». Ou en tout cas plus de la même façon. L’idée ne fait plus sens. La question n’est même plus celle de la place de l’humanité dans la « nature ». La relation a changé. Si tant est qu’il soit encore possible de parler de « nature », celle-ci sera désormais une production humaine. Le vivant est devenu manipulable jusque dans son patrimoine génétique. Même les régions les plus reculées subissent de manière plus ou moins indirecte l’influence humaine. La nature « sauvage » n’a plus sa place que dans des espaces limités. Ou peut-être la croise-t-on encore fortuitement, sous forme fantomale, comme ici, dans « Éthologie du tigre », lors de la construction d’un complexe hôtelier à la lisière de la jungle cambodgienne.
 L’avenir semble donc être à la simulation de la « nature ». De fait, les modes de vie urbains ont progressivement réduit la conscience des cycles «naturels» (à commencer par la compréhension des processus permettant de produire la nourriture consommée quotidiennement). Les générations futures préféreront d’ailleurs peut-être la seconde nature des mondes virtuels, celle qui offre presque toutes les possibilités de (re)création et dont le « RêVe » de la nouvelle « Tjukurpa » serait une version possible, peuplée et aménagée au gré des fantasmes du concepteur dans une forme de retour aux origines du monde et de fidélité maintenue à la culture aborigène. Ou alors, ce sera une forme d’échappatoire à la « réalité », comme celle qui a déjà fait les beaux jours des romans cyberpunk et qui, dans une fusion de l’esprit avec les machines, permet d’occuper le temps à l’écart de la grisaille et de l’agressivité latente de cités devenues elles-mêmes cyborgs.
L’avenir semble donc être à la simulation de la « nature ». De fait, les modes de vie urbains ont progressivement réduit la conscience des cycles «naturels» (à commencer par la compréhension des processus permettant de produire la nourriture consommée quotidiennement). Les générations futures préféreront d’ailleurs peut-être la seconde nature des mondes virtuels, celle qui offre presque toutes les possibilités de (re)création et dont le « RêVe » de la nouvelle « Tjukurpa » serait une version possible, peuplée et aménagée au gré des fantasmes du concepteur dans une forme de retour aux origines du monde et de fidélité maintenue à la culture aborigène. Ou alors, ce sera une forme d’échappatoire à la « réalité », comme celle qui a déjà fait les beaux jours des romans cyberpunk et qui, dans une fusion de l’esprit avec les machines, permet d’occuper le temps à l’écart de la grisaille et de l’agressivité latente de cités devenues elles-mêmes cyborgs. Cette éthique peut être vécue comme une affaire personnelle. Pour le héros de Zodiac (1988) de Neal Stephenson, comme pour d’autres militants écologistes, c’est un combat contre les industries polluantes et leurs pratiques douteuses. Combat, en effet, parce qu’il faut parfois en arriver à des méthodes vigoureuses. Ou sinon finissent par éclater des convictions portées à incandescence, sous forme de micro-résistances poussées à bout, comme celle de Johnny, l’Indien de la nouvelle « Sept secondes pour devenir un aigle », essayant de préserver ce qui reste d’un ancien monde. Avec le désespoir et la résolution de ceux qui n’ont plus rien à perdre. Johnny la Vérole a peut-être compris que certains acteurs économiques avaient davantage de responsabilités que d’autres. Mais il n’a éliminé qu’un protagoniste, pas changé le système.
Cette éthique peut être vécue comme une affaire personnelle. Pour le héros de Zodiac (1988) de Neal Stephenson, comme pour d’autres militants écologistes, c’est un combat contre les industries polluantes et leurs pratiques douteuses. Combat, en effet, parce qu’il faut parfois en arriver à des méthodes vigoureuses. Ou sinon finissent par éclater des convictions portées à incandescence, sous forme de micro-résistances poussées à bout, comme celle de Johnny, l’Indien de la nouvelle « Sept secondes pour devenir un aigle », essayant de préserver ce qui reste d’un ancien monde. Avec le désespoir et la résolution de ceux qui n’ont plus rien à perdre. Johnny la Vérole a peut-être compris que certains acteurs économiques avaient davantage de responsabilités que d’autres. Mais il n’a éliminé qu’un protagoniste, pas changé le système. Le maintien d’une habitabilité planétaire oblige aussi à penser l’être-en-commun. La raréfaction des ressources va-t-elle alors supposer des formes de sobriété collective ? Quelle serait la version future des cartes de rationnement ?
Le maintien d’une habitabilité planétaire oblige aussi à penser l’être-en-commun. La raréfaction des ressources va-t-elle alors supposer des formes de sobriété collective ? Quelle serait la version future des cartes de rationnement ? D’autres propositions radicales arrivent aussi dans les discussions. Va-t-on aller jusqu’à manipuler le génome humain pour faciliter l’adaptation au changement climatique ? Certains pourraient penser que ces manipulations sont moins risquées que celles de la biosphère par la « géo-ingénierie », et que de toute manière, c’est aux humains d’assumer le prix de leurs errements. L’idée a par exemple été émise de réduire la taille des humains pour qu’ils consomment moins d’énergie (sous forme de nourriture notamment), et ainsi réduisent leur empreinte écologique. Comme les capacités de manipulation de la part biologique de l’humain deviennent croissantes, d’autres idées viendront sans doute à être explorées dans ce sillage, à commencer, par exemple, par l’augmentation de la résistance à la chaleur et à la sécheresse, que certains jugeraient sans doute plus efficace que les « distilles » qui équipent les Fremen et assurent leur hydratation dans le monde désertique des romans de Frank Herbert. La solution génétique paraîtra plus rapide en tout cas que d’attendre l’adaptation de l’espèce humaine par des processus évolutifs « naturels ». Bref, si l’habitabilité de la planète paraît se réduire, il peut y avoir des tentations de proposer l’adaptation de la biologie humaine comme la solution (au bout du compte) la plus commode. Ce dilemme était aussi présent dans Ciel brûlant de minuit, un roman de Robert Silverberg publié en 1994 et mettant en scène la confrontation des options possibles face aux dérèglements écologiques accumulés.
D’autres propositions radicales arrivent aussi dans les discussions. Va-t-on aller jusqu’à manipuler le génome humain pour faciliter l’adaptation au changement climatique ? Certains pourraient penser que ces manipulations sont moins risquées que celles de la biosphère par la « géo-ingénierie », et que de toute manière, c’est aux humains d’assumer le prix de leurs errements. L’idée a par exemple été émise de réduire la taille des humains pour qu’ils consomment moins d’énergie (sous forme de nourriture notamment), et ainsi réduisent leur empreinte écologique. Comme les capacités de manipulation de la part biologique de l’humain deviennent croissantes, d’autres idées viendront sans doute à être explorées dans ce sillage, à commencer, par exemple, par l’augmentation de la résistance à la chaleur et à la sécheresse, que certains jugeraient sans doute plus efficace que les « distilles » qui équipent les Fremen et assurent leur hydratation dans le monde désertique des romans de Frank Herbert. La solution génétique paraîtra plus rapide en tout cas que d’attendre l’adaptation de l’espèce humaine par des processus évolutifs « naturels ». Bref, si l’habitabilité de la planète paraît se réduire, il peut y avoir des tentations de proposer l’adaptation de la biologie humaine comme la solution (au bout du compte) la plus commode. Ce dilemme était aussi présent dans Ciel brûlant de minuit, un roman de Robert Silverberg publié en 1994 et mettant en scène la confrontation des options possibles face aux dérèglements écologiques accumulés.
 Quelles régulations les collectivités humaines peuvent-elles réussir à mettre en place ? Habitabilité pour tous ? Pour une majorité ? Pour une minorité ? Qui pourra (encore) bénéficier d’un environnement préservé ? Dans La Vérité avant-dernière (1964), roman de Philip K. Dick, une minorité se partage la surface terrestre tandis que le reste de la population reste enfermée dans des abris antiatomiques, occupée à fabriquer des armements robotisés pour une guerre censée se dérouler en dehors.
Quelles régulations les collectivités humaines peuvent-elles réussir à mettre en place ? Habitabilité pour tous ? Pour une majorité ? Pour une minorité ? Qui pourra (encore) bénéficier d’un environnement préservé ? Dans La Vérité avant-dernière (1964), roman de Philip K. Dick, une minorité se partage la surface terrestre tandis que le reste de la population reste enfermée dans des abris antiatomiques, occupée à fabriquer des armements robotisés pour une guerre censée se dérouler en dehors.