
Cela faisait longtemps : pour compléter le cahier critique du Bifrost 113, disponible depuis le 25 janvier en librairie, voici quelques papiers supplémentaires n’ayant trouvé place au sein de la version papier.

Cela faisait longtemps : pour compléter le cahier critique du Bifrost 113, disponible depuis le 25 janvier en librairie, voici quelques papiers supplémentaires n’ayant trouvé place au sein de la version papier.

Pour les raisons les plus bassement commerciales, la quatrième de couverture évoque les films Avatar (on supposera ici qu’il s’agit du deuxième volet) et Abyss. 20 000 lieues sous les mers aurait bien mieux convenu, voire Voyage au Fond des Mers la célèbre série TV des années 60 crée par Irvin Allen, mais c’est davantage encore à SeaQuest et surtout au Jeu et aux romans « Polaris » de Philippe Tessier que s’apparente Confluence, en bien mieux – sans qu’il y ait toutefois lieu de s’esbaudir. Chaque tome est divisé en quatre parties qui auraient constitué chacune un très honnête Fleuve Noir des années 80. On tient là de la bonne littérature populaire dans le genre aventures sous-marines et le bon sens du terme.
Tout comme dans « Polaris », l’humanité a été contrainte de se réfugier sous les flots. Le roman de Sylvie Poulain se montre moins belliqueux de « Polaris ». Avant d’écrire, elle a été militaire – et ce sont les militaires qui sont rarement les plus va-t-en guerre, car ils savent de quoi il est question. On notera que l’Atlantis de Confluence dont le rôle s’apparente à celui de l’OTAN, ici baptisé Pax, est située au même emplacement géographique que l’Hégémonie dont le nom trahit les ambitions dans l’univers développé par Philippe Tessier ; soit au large de Washington. Poulain n’est certes pas Henry James, mais de celui-ci à Tessier s’étend la totalité de la littérature ou peu s’en faut et les personnages de Confluence sont animé d’une certaine psychologie en évolution, souvent à la recherche d’une forme de rédemption et doté d’un passé trouble qui revient hanter le présent.
Tout commence par l’assaut lancé par Atlantis contre Providence, une cité ayant survécu à une catastrophe dans les abysses grâce à une symbiose avec un micro-organisme marin à l’origine d’une sorte de télépathie, la confluence. Les Atlantes voudraient s’emparer de ces techniques et considèrent Providence comme une menace à mettre au pas mais l’affaire tourne mal et les Proventins préfèrent saborder leur cité que de livrer leurs secrets. Ne survivent que Jihane et Wolf. La jeune fille est la dépositaire de toutes les mémoires des Proventins qui constitue un fardeau un peu lourd pour elle. Wolf est un sous-off atlante parti à la poursuite de Jihane guidé par Atlas, l’IA qui règne sur Atlantis, via ses implants qui régule et manipule sa chimie cérébrale. Ils sont recueillis par le Grondin, un submersible de la Hanse venu observer les événements. La Hanse est une entité chargée des échanges et du commerce entre les divers membres de l’intercommunauté. Tandis que Jihane tente de reconstituer une confluence et que Wolf change de camp en rompant ses liens ; on découvre l’équipage du Grondin où tous ont un passé chargé que l’on découvre au fil du roman. Le Grondin ne tarde pas à se voir traqué par tout ce qui navigue.
L’univers développé par Sylvie Poulain semble gynécocratique – à une exception et demi près : Veers (le bâtonnier de la Hanse) et Atlas (une IA traitée comme masculine) qui sont au nombre des méchants –, toutes les autorités étant féminines. À commencer par Carmen de Klerk, commandant du Grondi ; Suzanna Li, amiral d’Atlantis ; Imane Battouri, Archonte d’Atlantis sensée supervisée Atlas, ces deux ont la relation saphique de rigueur ; Némo, maffieuse et psychopathe sanguinaire régnant sur les Açores a un passé qui n’est pas sans évoquer celui du personnage de Jules Verne et rêve de dominer le monde qu’elle estime ne pas l’avoir traitée comme elle l’estimait juste et compte sur le symbiote proventin pour y parvenir ; Claudia Quandt commande un sous-marin de la Hanse et Lindsay, la Station Hope. Tous les autres hommes n’ont que des fonctions subalternes même s’ils sont des personnages importants du récit.
Si les deux volumes de « Confluence » sont assez volumineux, leur mise en page est relativement aérée. L’ensemble lecture sommes toutes agréable mais qui ne révolutionnera pas la littérature. En ces temps de médiocratie galopante et frénétique, c’est plutôt bon pour un livre récent qui n’est pas une réédition. Même si le roman compte des aspects scénaristiques hollywoodiens qui peuvent prêter à sourire ; l’histoire est cohérente et se tient.
Jean-Pierre Lion
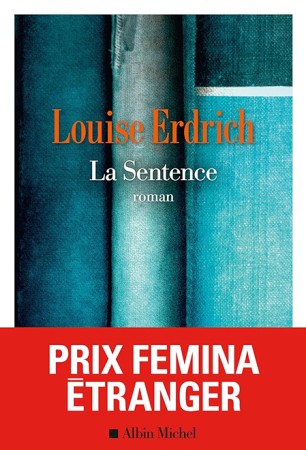
Après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle, Tookie, la quarantaine, est embauchée dans une librairie indépendante spécialisée en littérature amérindienne à Minneapolis. Le job de rêve pour cette Ojibwé dont la passion des livres est née entre les murs de la prison. Entourée de ses amis, épaulée par un mari aimant, Tookie se délecte de cette vie calme et des conseils de lecture qu’elle prodigue à ses clients, jusqu’à ce que le fantôme de l’un d’entre eux, Flora, vienne hanter la librairie…
Au rythme de chapitres courts, Louise Erdrich dresse le portrait d’une Amérique tristement célèbre pour ses violences envers les peuples racisés qui la composent. Chaque étape de la vie de Tookie semble une épreuve où la librairie apparaît comme un havre de paix, la liberté par les livres, un classique. Une paix rompue par le fantôme de Flora, une présence à la fois intrigante et effrayante pour Tookie, mais pour le lecteur… un simple figurant, un murmure, un livre qui tombe, une obsession qui semble rappeler à l’héroïne qu’elle doit encore payer sa dette. Ou bien est-ce autre chose… ? Bien entendu. Puis le vent du COVID balaye Minneapolis qui finit par s’embraser après le meurtre de George Floyd.
Si la présence de Flora rattache La Sentence aux genres qui nous intéressent en Bifrosty, le fantastique reste à la marge, un fil rouge si fin qu’on l’oublierait presque, mais qui révèle son utilité à la fin (ouf). La Sentence est avant tout un hymne aux cultures amérindiennes, un voyage intime sur la quête d’identité et les liens familiaux, un beau Prix Femina Étranger dont on peut cependant regretter le caractère fourre-tout et décousu.
Aayla Secura

Après les remarqués Galeux (cf. Bifrost 99) et Un bon indien est un indien mort (cf. Bifrost 109), Stephen Graham Jones revient dans nos contrées pour un roman d’horreur, au titre magnifique : Mon cœur est une tronçonneuse. Ce livre, couronné par le Bram Stoker Award, le Shirley Jackson Award et le Locus Award du meilleur roman d’horreur, est un hommage aux films d’horreurs, passion pleinement avouée de l’auteur.
Jade Daniels, adolescente en marge, « indienne » par son père, fan de slashers et aimant étaler ses connaissances cinématographiques est la pétillante et impertinente héroïne de ce récit. Du haut de ses 17 ans, elle passe tout au crible du cinéma de genre ; tout rentre toujours dans la grille de lecture qu’elle adopte pour voir le monde. Elle inventorie les éléments clés nécessaire ainsi que les rôles attendus – en premier lieu, celui de la final girl. Mais un jour, la réalité rattrape ses rêveries morbides et le sang commence à gicler dans son bled paumé de l’Idaho.
Par le biais de Jade, Stephen Graham Jones réalise en fil rouge un court magistral sur les slashers et gorge le récit d’anecdotes sur les tournages, les lieux, les personnages, les armes. Un véritable Hall of Fame du tueur en série. Pas besoin d’être fan de ce genre de films pour apprécier la lecture, mais il ne faut pas non plus y être hermétique – mais reconnaissons que le titre est assez explicite ! Au demeurant, une cinquantaine de notes de bas de page sont là pour aider à la compréhension, soit directement en lien avec des références horrifiques soit pour des histoires d’argot ou de culture spécifiquement US.
Les atermoiements de Jade ou son côté cabotin ralentissent par moments légèrement la narration, sans que cela soit rédhibitoire. Surtout qu’il s’agit là d’un effet de l’auteur pour nous laisser douter encore et encore. Le prisme de l’adolescente est-il le bon ? Ou bien se laisse-t-elle dépasser par son envie de jouer un vrai rôle dans le film de sa vie ?
Une plongée horrifique rondement menée. Stephen Graham Jones se régale et c’est agréable de l’accompagner, le livre dans une main. Et dans l’autre… l’arme de votre choix.
Mathieu Masson
* * *
Accelerando n’ayant pas fait l’unanimité au sein de la rédaction lors de son inclusion dans la Bibliothèque idéale IA du présent numéro 113, voici un autre avis sur le fix-up de Charles Stross.

Pour qui s’interrogerait quant à la signification du titre du « roman » qui nous intéresse ici, point n’est forcément besoin d’en faire la lecture, du moins de sa partie proprement narrative. Il suffira de consulter la première entrée du glossaire de presque cinquante pages inclus dans l’édition française d’Accelerando. Ledit article, intitulé « Accelerationista », nous apprend que l’on désigne ainsi les tenants de « l’accélération, à savoir l’acceptation par l’homme d’une transition globale de l’autre côté de la singularité* ». L’astérisque couronnant ce dernier terme invite alors à aller consulter, une quarantaine de pages plus loin, une seconde entrée. Elle explique que singularité désigne ici « un changement de paradigme social/économique/technologique qui voit s’infléchir à la verticale une courbe exponentielle d’évolution ». Notons encore que cette définition renvoie elle-même, avec force autres astérisques, à celles concernant « Hans Moravec », « Ray Kurzweill », le « Transhumanisme » ainsi que l’« Université de la Singularité ». Et ce ne sont là que quelques-uns des cent soixante-cinq articles que compile ce glossaire conclusif de la version hexagonale d’Accelerando. Car c’est à son traducteur français, Jean Bonnefoy, et non pas à Charles Stross lui-même que l’on en doit la présence, l’édition originale en étant apparemment dépourvue.
Loin d’être anecdotique, cet ajout d’un quasi-dictionnaire au « roman » qu’est Accelerando permet aussi bien de comprendre les intentions ayant guidé son auteur que les raisons de son échec littéraire. Quant aux premières, il est ainsi manifeste que l’écrivain a caressé l’ambition de décliner sous une forme fictive un considérable corpus théorique et dans lequel l’IA occupe une place centrale. Accelerando spécule en effet sur un développement futur tel de celle-ci qu’elle parvient in fine à supplanter l’humaine intelligence, réussissant même à recomposer le système solaire selon ses propres et technologiques attendus… Ce n’est cependant là que le résumé tout à fait expéditif d’un récit courant sur plus de sept cents pages et détaillant à l’envi la genèse (plus ou moins) directe de l’artificiel « cerveau Matriochka » reléguant le genre humain au rang d’espèce subalterne…
Sans doute intellectuellement impressionnant du fait de sa luxuriance référentielle (du moins d’un point de vue non scientifique, tel celui de l’auteur de cette critique…), Accelerando échoue en revanche à faire œuvre de littérature. Le lâche agrégat de neuf nouvelles qu’est en réalité ce faux roman n’accouche que d’un semblant d’histoire tout en raccords artificieux. Pesamment lassant (pour dire le moins…), Accelerando fait montre d’une écriture aussi pondéreuse, oscillant dangereusement entre humour grassement potache et name-dropping façon hard SF…
Pierre Charrel