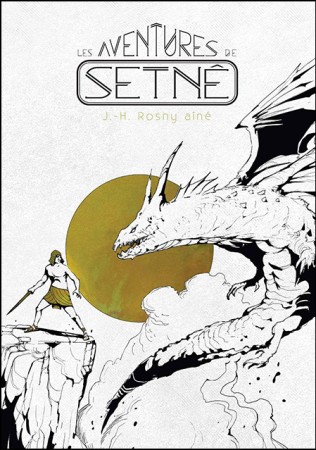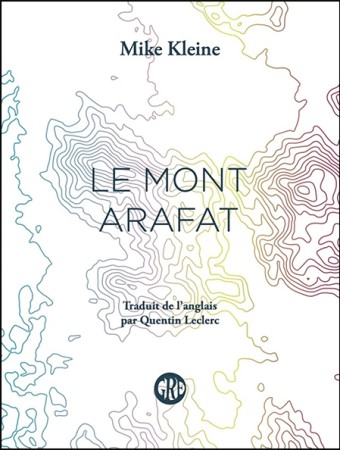La Chute de la Ville Principale
Efim Zozoulia – Le Temps des Cerises éditeurs – janvier 2021 (recueil de nouvelles en partie inédites traduites du russe par Emma Lavigne – 115 pp. GdF. 15 euros)
La publication de La Chute de la Ville Principale offre l’occasion de découvrir un pan quasi inconnu de l’Imaginaire soviétique. Les cinq nouvelles formant ce recueil étaient jusqu’alors inédites en français, mise à part « Le Conte d’Ak et l’humanité » (in anthologie de SF soviétique Les Premiers Feux, Lingva, 2015). Ces textes sont l’œuvre d’Efim Zozoulia (1891-1941), l’un des « oubliés de la littérature russophone » ainsi que l’écrit la traductrice Emma Lavigne en préface. Zozoulia, après avoir entamé à la veille de la Première Guerre mondiale une carrière d’écrivain et journaliste dans son Ukraine natale, continua celle-ci en Russie une fois passée la révolution d’Octobre. Comme nombre d’auteurs soviétiques, Zozoulia mena dès lors une carrière évoluant entre affirmation (déclinante) de sa liberté créatrice et compromission (croissante) avec le régime communiste. Après avoir écrit dans une revue satirique bientôt interdite par les Bolcheviques, Zozoulia devait ensuite participer à une « compilation des meilleurs chants à la gloire de Staline », puis prendre part en 1929 à la campagne menée en URSS contre Zamiatine, l’auteur de Nous (cf. Bifrost 87). Échappant peut-être de la sorte aux purges staliniennes, Zozoulia ne survécut en revanche pas au siège de Moscou durant la Seconde Guerre mondiale.
Tous écrits entre 1918 et 1919, les cinq récits de La Chute de la Ville Principale dessinent la trajectoire esthétique et idéologique à venir de Zozoulia… Si les quatre premiers d’entre eux manifestent son adhésion au socialisme, ils témoignent par ailleurs d’une réflexion ironique sur l’autocratie, semblant annoncer le totalitarisme soviétique. Quant aux convictions marxistes de Zozoulia, elles apparaissent clairement dans le texte-titre et « Le Mobilier humain ». Adoptant comme les autres textes la tonalité du conte, « La Chute de la Ville Principale » dénonce sur un mode dystopique l’aliénation capitaliste et la lutte des classes devant inexorablement en découler. S’imposant comme le plus réussi des textes du volume, ce récit science-fictionnel a de séduisantes allures de miniature “miévillienne”, évoquant notamment Perdido Street Station et sa topographie subversive. Relevant plutôt du conte cruel, « Le Mobilier humain » décline de manière horrifique et sarcastique le motif marxiste de la réification de l’individu. Zozoulia consacrera par la suite une étude à Swift dont on retrouve l’influence dans « L’Atelier de l’Amour de l’Humanité » et « Le Conte d’Ak et l’humanité ». Aussi brèves qu’incisives, ces deux fables spéculatives préfigurent de manière troublante la folie démiurgique ainsi que l’hyper-brutalité de l’entreprise totalitaire dont l’URSS sera bientôt le théâtre. L’acidité critique de ces textes est en revanche absente du « Gramophone des siècles ». Cette utopie située dans les années 1950 dépeint une Europe vivant sous l’heureuse emprise d’un socialisme à l’œuvre depuis des décennies. Celui-ci a atteint un degré de perfection tel que les maux sociaux comme politiques ne sont plus que de déplaisants souvenirs, fugitivement ravivés par un singulier gramophone. Étrange mélange d’inventivité science-fictionnelle et de naïveté propagandiste, ce texte conclusif du recueil peut se lire comme la triste préfiguration de la soumission de son auteur à la dictature stalinienne…
Pierre Charrel

Oublier les étoiles
X.M. Fleury – Rivière Blanche, coll. « Blanche » – mars 2021 (recueil inédit sous cette forme – 250 pp. GdF. 20 euros)
Lorsque l’on dit d’un livre qu’il est sympathique, cela sous-entend qu’il n’est pas totalement mauvais mais compte néanmoins sa part de défauts. Le présent recueil n’est pas sympathique, il est bon, voire très bon et les seize nouvelle rassemblées ici méritent toutes le détour, même les sept pour lesquelles le manque de place n’a pas permis de présenter une notule spécifique.
« Noir » est un très bon texte qui reprend le thème de l’humanité rendue aveugle par une expérience tournant mal. X.M. Fleury met en scène le péquin moyen et imagine ce qu’il pourrait bien faire si l’opportunité de rectifier de tir lui était donnée. Je ne vous en dis pas davantage…
« La Crique » est une nouvelle franchement politique sur la thématique des migrants qui, à travers une inversion de situation donne à réfléchir sur ce drame contemporain qui pourrait encore s’amplifier à l’avenir.
Dans « Le Travail Assassiné », X.M. Fleury s’empare, toujours avec la même ironie acerbe et son sens de l’humour noir, du thème très présent d’une hypothétique « fin du travail » où les IA feraient à peu près tout, ne laissant aux gens que le loisir de singer une activité professionnelle pour s’éviter de mourir d’ennui.
« L’Ami secret » a un petit côté dickien où, dans un contexte de colonisation et de terraformation, l’auteur s’interroge et nous avec lui sur les rapports que peut entretenir la religion avec l’altérité. Ici encore, l’humanité n’est pas présentée sous son jour le meilleur, – pour faire dans l’euphémisme —, et, quand par hasard un humain serait bon, ce n’est pas bon du tout pour lui.
« Jeux de guerre » revient, dans un contexte de futur proche, sur La Stratégie Ender qu’il retourne comme un gant. La guerre par l’entremise de jeux vidéo… Mais dans la guerre informationnelle l’arme est l’intelligence et peut-être est-il dangereux de croire que l’ennemi plus pauvre est plus stupide.
Dans « Pourfendre les dragons », l’auteur s’inspire desCroisées du Cosmos de Poul Anderson ou des Grognards d’Eridan de Pierre Barbet. Un chevalier qui tient sûrement davantage de Don Quichotte que de Tristan est capturé par des outremondiers elfes afin de débarrasser le monde des nains de ses dragons. Ici l’humour est un brin moins caustique…
Avec « Un cadeau presque parfait », Fleury rejoue « La Clé laxienne » de Sheckley dans un esprit s’apparentant fort à Damon Knight. L’auteur, qui maitrise fort bien l’art de la chute, est ici à son meilleur.
« Immersion » joue encore la carte du transhumanisme dans un monde dual où de riches oisifs en mal de sensations fortes se transfèrent psychiquement dans le corps d’animaux qui n’ont rien demandés. De nouveau, la bêtise humaine fait merveille.
Enfin, « Oublier les étoiles » est aussi court qu’excellent et Fleury y donne l’immense mesure de son art de la chute. L’écologisme règne et traque les derniers chercheurs à l’instar d’une nouvelle inquisition qui veut voir tout le savoir honni définitivement éradiqué et en finir avec tout rêve d’étoiles. X.M. Fleury nous laisse ici comprendre que savoir et intelligence ne vont pas nécessairement de pair ni que cette dernière n’est pas l’apanage des seuls bons.
Voici donc un bon recueil de fictions spéculatives qui donne à penser et à réfléchir, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent où la tendance lourde va à une littérature de propagande assumée sans aucun complexe où les réponses sans questions sont assénées, martelées jusqu’à la nausée sans nul répit ni relâche. Oublier les étoiles ne va pas forcément à l’encontre du prêt-à-penser contemporain mais vous laisse le soin de tirer les conclusions par vous-même. X.M. Fleury manie une ironie au scalpel, parfois cinglante, associée à un art de la chute des plus consommé. Ses textes, faciles d’accès, peuvent constituer une porte sur le genre pour qui n’a encore jamais lu de SF. Il serait vraiment très dommage de faire l’impasse.
Jean-Pierre Lion

Paradis, année zéro
Christophe Gros-Dubois – Les Moutons électriques, coll. « Courant alternatif » – avril 2021 (roman inédit – 496 pp. GdF. 21 euros)
Courant alternatif est un nouveau label des Moutons Électriques, présenté comme « engagé et enragé » faisant la part belle aux « fictions politiques, écologiques et sociales, mais également [aux] dystopies et d’utopies » comme l’indique leur site. Quatre titres sont disponibles au catalogue au moment de rédiger ces lignes, dont Paradis, année zéro de Christophe Gros-Dubois – deuxième roman de cet auteur venant du cinéma.
Une catastrophe inédite et inexpliquée, littéralement, vient frapper les USA. Les belles baraques s’écroulent tandis que les taudis restent droits — même si parfois de guingois. D’autres conséquences adviendront au fil du récit, comme autant de prétextes à promouvoir la narration de l’auteur. Parallèlement, une invention va redistribuer les cartes entre les différents protagonistes.
Au milieu de ce Washington en perdition, de nombreux personnages se rencontrent, s’évitent et s’affrontent, dont de nombreuses femmes africaine-américaines. Une mère et sa fille, militantes de deux générations distinctes, ou encore une cascadeuse meurtrie par la mort de son frère. On croise aussi un ersatz de Mike Tyson et un homme ayant été touché par la crise des subprimes. Dans le camp d’en face, le policier qui a abattu le frère évoqué précédemment, un videur-biker tendance néo-nazie et un jeune redneck ayant ouvert le feu dans une église. Si cette galerie de personnages semble stéréotypée, leurs évolutions sont néanmoins intéressantes, et laissent la place à une complexité bienvenue.
Hélas, le paratexte dessert le roman. Entre la quatrième de couverture annonçant que le texte date d’avant Trump et les «violences policières récentes » (pléonasme), parle de « prophétie » et la première qui annonce comme thématique du livre : « la fin du racisme et après », on se demande jusqu’à la toute fin s’il n’y a pas erreur sur la marchandise. Que l’auteur ait eu l’idée de son livre il y de nombreuses années est une chose, mais laisser entendre que ce roman qui parle de Biden et de Covid a été « Écrit avant » donne une saveur de toc à l’ensemble. Par ailleurs, annoncer « la fin du racisme » comme thématique est assez osé, et plus encore le « après » puisqu’il ne constitue que les toutes dernières pages de cet épais roman.
On déplorera beaucoup de coquilles, parfois sur les noms propres : « Book ter T. Washington » ou le fréquent « Malcom X ». L’usage de l’italique pour les termes anglais est irrégulier, de même que la pertinence des notes de bas de page. Et si l’auteur fait montre d’une grande culture africaine-américaine, et étatsunienne en général, comment expliquer la confusion entre Washington et l’État de Washington à la toute fin ? La question est posée sans ironie.
Grosse déception que cette utopie post-apo un peu trop foutraque et inutilement lubrique, sur une thématique complexe mais d’actualité permanente. Une sorte de pétard mouillé, vu le résultat alors que Richard Wright et James Baldwin, deux auteurs africains-américains majeurs, sont évoqués, de même que Frantz Fanon, à qui l’on doitLes Damnés de la terre, livre de chevet du Black Panther Party.
Mathieu Masson

Baba Yaga a pondu un œuf
Dubravka Ugresic – Christian Bourgois – avril 2021 (roman inédit traduit du croate par Chloé Billon. 340 pp. GdF. 23 euros)
La narratrice, une universitaire, a une mère vieillissante et victime de la maladie d’Alzheimer. Elle l’accompagne au quotidien du mieux qu’elle peut, entre le tragique de la situation et son côté comique, quand un mot chasse l’autre et génère quiproquos et malentendus. Elle voudrait bien se rapprocher d’elle mais cette mère, repliée sur son quotidien, ne lui laisse guère de place. Cette dernière semble bien plus en affinités avec la jeune étudiante Aba Bagay, qui s’est entichée, elle, de la narratrice. Voilà pour la première partie. La seconde s’ouvre sur les aventures de trois vieilles femmes, Beba, Kukla et Pupa en villégiature dans un spa tchèque. L’une est petite et emportée par le poids de ses énormes seins ; l’autre est longue et sèche, montée sur de grands pieds ; la dernière, enfin, est racornie comme une chouette hors d’âge et enfoncée dans une unique botte où elle réchauffe ses vieilles jambes. Que viennent-elles chercher dans cet hôtel spa, digne d’un Wes Anderson avec sa galerie de personnages truculents ? Aspirent-elles vraiment à retrouver un peu de leur fraîcheur perdue ? D’où vient l’aura de mystère qui entoure ces femmes qui ont bien souffert de ce que le monde paternaliste leur a infligé ? Les deux premières parties du roman seront éclairées par une troisième, rédigée par la jeune Aba Bagay, et qui consiste en une sorte d’essai aux allures universitaires sur la figure mythique de Baba Yaga, la sorcière bien connue dans la culture d’Europe centrale.
La vieillesse est fantastique. Si, si. L’auteur croate Dubravka Ugresic, figure de la littérature paneuropéenne, vous en convaincra dans ce roman à la composition subtile comme un œuf de Fabergé. Jadis, on a usé de cette métaphore pour décrire le roman Feu pâle de Nabokov, dont le fil narratif repose sur un poème de plus de mille vers et sur son exégèse par un narrateur qui joue un rôle central dans le propre récit qu’il délivre. Ugresic, exilée tout comme Nabokov, marche dans les pas du maître russe, à sa façon. La composition hétéroclite du roman intrigue : quels rapports ont les narrations entre elles, sinon cette réflexion fine et drolatique sur la vieillesse ? La troisième partie intrigue assurément : livrant les sources de nombreuses scènes et caractéristiques des personnages, elle explique la présence de motifs récurrents en exposant leur origine et leur fortune au fil des siècles. Mais, alors que cette partie devrait avoir un peu la platitude du discours explicatif (dont l’exactitude est toute scientifique) et dégonfler la magie de ce qu’on a lu précédemment, elle renforce au contraire l’impression d’étrangeté de l’ensemble.
Le Bifrostien n’y trouvera guère de paranormal ou de fantastique sinon celui de l’étrangeté inhérente à chacune de nos existences et que rien ne saurait mieux rendre que la vieille figure d’une sorcière, Baba Yaga, qui a traversé les civilisations d’Europe centrale. Dubravka Ugresic use avec bonheur des puissances de l’écriture fantastique sans jamais s’y abandonner complètement, et s’en sert comme d’une loupe penchée sur notre vieillesse et le sort que nos sociétés ont fait aux femmes.
Arnaud Laimé

La Citadelle de la peur
Gertrude Barrows Bennett (aka Francis Stevens) – Marie Barbier Éditions – mai 2021 (roman traduit de l’américain par Michel Pagel – 400 pp. GdF. 17 euros)
La Citadelle de la peur est un roman dont la propre histoire est originale. Publié à l’origine en feuilleton dans la revue pulp The Argosy entre le 14 septembre et le 26 octobre 1918, le texte ne connaîtra d’édition définitive sous une couverture unique qu’en 1942. Autre particularité plus notable, il est l’œuvre de Gertrude Barrows Bennett, une sténographe qui commença à écrire des nouvelles à l’âge de 17 ans – son premier texte, «The Curious Experience of Thomas Dunbar », fut accepté parArgosy et publié en 1904. Beaucoup d’autres suivront, dont The Citadel of Fear traduit ici pour la première fois en français et souvent considéré comme son meilleur roman. On notera que Bennett, après avoir publié sous son nom au début de sa carrière, publia la plus grande part de ses textes, à sa demande, sous pseudo, Francis Stevens en l’occurrence. Sous un nom ou l’autre, Bennett, première américaine à trouver un large public pour ses textes de fantasy et de SF, est, dit-on, « la femme qui inventa la dark fantasy ».
La Citadelle de la peur se divise en deux parties consécutives. D’abord, le désert du Mexique, parcouru par deux aventuriers en quête de fortune, Colin O’Hara et Archer Kennedy. Les deux hommes y tombent par hasard sur une plantation non répertoriée occupée par d’étranges habitants. De fil en aiguille, ils se trouvent emprisonnés dans la cité cachée de Tlapallan, un lieu de terreur et de beauté aussi dans laquelle « vivent » les dieux anciens, gardés et adorés par d’antiques guildes concurrentes. De combats en péripéties, O’Hara parviendra à fuir alors que Kennedy connaîtra un destin funeste. Seconde partie, quinze ans plus tard, en Nouvelle-Angleterre : O’Hara, qui a largement enfoui cette histoire au fond de sa mémoire, est rattrapé par elle quand Cliona, sa sœur chérie, est attaquée et traumatisée par une créature qui prend la fuite après que la jeune femme lui a vidé un chargeur dessus. Devant l’incrédulité de la police, O’Hara prend l’affaire en main et découvre, non loin, une maison coloniale qui abrite d’innommables horreurs. Propriétaire inquiétant, répugnantes créatures, et aussi une femme d’une beauté à couper le souffle dont O’Hara tombe instantanément amoureux. Sauver la femme, sauver sa sœur : il faudra à O’Hara et ses quelques alliés beaucoup de courage et de force pour vaincre une terreur venue d’Amérique du Sud.
Écrit en 1918, La Citadelle de la peur rappelle les textes de Robert E. Howard pour ses hommes. Même héros volcanique issu du Nord de l’Europe, même virilisme amusant par son excès, même mépris d’O’Hara pour « l’intellectuel » Kennedy jugé tortueux et peu courageux, même certitude qu’on peut et doit à résoudre les problèmes par la force. Elle rappelle Merritt pour ses femmes, des êtres fragiles à aimer et à protéger – sur ce point, Cliona détrompera son frère.
Du point de vue de l’archéologie littéraire, lire ce roman est intéressant ; beaucoup de l’habitus de l’époque y transparaît, et, entre Howard et Merritt, Bennett participe à un genre naissant. Néanmoins, les personnages trop monolithiques, la narration trop linéaire, la simplicité de l’intrigue, les sentiments trop naïvement exprimés et la candeur parfois confondante d’O’Hara font qu’on se situe bien en-dessous de ce qui s’écrira par la suite.
Eric Jentile

L’empire s’effondre
Sébastien Coville – Éditions Anne Carrière – mai 2021 (roman inédit – 496 pp. GdF. 22,90 euros)
Ce qui frappe avant tout avec L’Empire s’effondre, premier tome d’une trilogie éponyme, c’est la communication de son éditeur — quatrième de couverture et sites marchands notamment : on y voit passer des comparaisons avec Frank Herbert, Isaac Asimov, Jean-Philippe Jaworski, Eugène Sue et Alexandre Dumas. Excusez du peu ! Outre le fait que pour un premier roman, ce genre de parallèles a bien peu de chances de se révéler fondé (et, évacuons tout suspense, ils ne le sont pas), ils ont aussi le grand tort d’établir des attentes qui, si elles ne sont pas remplies, génèreront à coup sûr de la frustration. Sans parler du fait que la comparaison avec Herbert est fort limitée (la religion en tant qu’outil de contrôle) et paraît assez opportuniste (disons que c’est de bonne guerre) à l’approche de la sortie du film Dune…
Dans un empire où la technologie (centrée sur la vapeur pour l’essentiel) cohabite avec un système de castes professionnelles hyper rigide car établi par des dieux tutélaires conférant un pouvoir absolu aux Princes qui les dirigent, un attentat menace de faire s’effondrer tout l’édifice. En effet, les violentes émeutes qu’il provoque servent elles-mêmes à justifier une révolution de palais dans laquelle trois princes prennent le pouvoir au détriment des autres, tandis qu’un quatrième entre en guerre pour rétablir le régime théocratique. On sent clairement, à tous les niveaux, le potentiel de l’auteur, mais à chaque fois, quelque chose cloche : son écriture est souvent fluide et agréable, mais ne fait pas l’impasse sur des effets de manche stylistiques dont il aurait pu se passer (tout comme des quatre scènes de viol en cent pages !), sans parler de passages d’une emphase excessive et très clairement, de longueurs (l’ouvrage ne se serait pas plus mal porté dégraissé d’un bon quart) ; les personnages sont intéressants, mais le nombre de points de vue (une dizaine !) est effroyablement trop élevé, d’autant plus que certaines sous-intrigues sont achevées hors-champ et réglées d’un trait de plume (le conseil basique d’écriture « Montrer plutôt que raconter » est pourtant censé être connu de tous), quand ce n’est pas le personnage lui-même dont on se débarrasse sommairement sans qu’on comprenne l’intérêt de lui avoir consacré tant de pages ; le worldbuilding est travaillé et évocateur, mais montre aussi des détails peu crédibles, comme ces armes à feu à vapeur ou ces quartiers à étages s’accrochant au flanc des collines où se trouvent les palais des puissants ; enfin, l’aspect roman social fait lever les yeux au ciel tant il est du cent fois vu en Fantasy (si tant est que ce livre en relève, certains indices incitant au doute), avec sa stratification sociale se doublant d’une stratification spatiale, sa charge anticapitaliste, anti-élites, anti-religion, anti-journalistes, sa révolte prolétarienne, etc.
L’empire s’effondre n’est en aucun cas un mauvais roman (surtout pour une première œuvre), mais il n’est certainement pas non plus à la hauteur des comparaisons auxquelles se livre son éditeur. Coville a clairement du potentiel, et avec peu d’ajustements (et une communication plus sobre), le tome suivant pourrait être une spectaculaire réussite.
Apophis
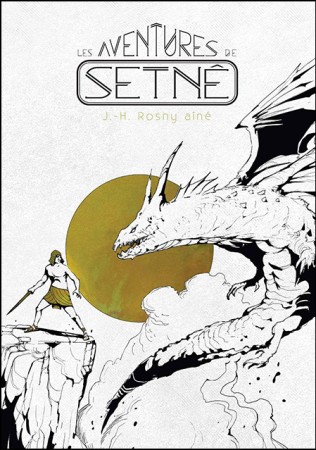
Les aventures de Setnê
J.-H. Rosny aîné – Éditions Callidor, coll. « L’âge d’or de la fantasy » – mai 2021 (réédition, 80 pp. GdF. Livre offert pour l’achat de deux titres Callidor)
Figure incontournable du Paris littéraire, Rosny aîné appartient à cette génération d’auteur qui popularisa, au tournant du XXe siècle, le roman merveilleux-scientifique. Le temps d’un court récit, et bien avant Howard et Dunsany, il s’aventura également sur les rives de ce qu’on n’appelait pas encore l’heroic fantasy.
Le personnage de Setnê apparaît dans deux contes égyptiens datés du IIIe siècle avant notre ère, sous les traits d’un scribe et magicien. Rosny en fait un chef guerrier proche de Conan, vassal de Thoutmôsis III (Thoutmès dans le roman), qui régna sur la XVIIIe dynastie, aux alentours de -1500 avant JC. Surnommé le « Napoléon de l’Égypte antique », ce pharaon mena une politique de conquête qui porta le Nouvel empire à son apogée. D’une campagne menée contre Ninive, l’auteur tire un épisode plein du bruit et de la fureur des temps antiques. Pour prendre l’ennemi à revers, Thoutmôsis envoie Setnê et ses soldats intercepter une caravane ennemie et s’emparer d’un défilé. Le plus court chemin passe par une forêt sacrée puis des contrées hautement hostiles. Ils endurent la fournaise du désert des Dragons, traversent la forêt des tigres géants mangeurs d’homme, longent les marécages des Hommes de l’Eau menés par leur reine « avec ses cheveux d’hyacinthe, sa peau bleue, ses immenses yeux de flamme fumeuse. »
Rosny dépeint l’aventure humaine autant que l’épopée de la survie, la façon dont se révèlent les tempéraments au fil des épreuves. Pourquoi certains résistent, et certains succombent ? Qu’est-ce qui peut mouvoir les corps épuisés et les esprits éperdus ? Nombre des soldats puisent leur énergie dans la bravoure de leur chef. D’une force égale au célèbre Cimmérien, Setnê s’en distingue par sa capacité de meneur. Dans le feu du combat, les fils de l’Égypte sont des frères et se doivent une fidélité réciproque et absolue.
Le récit déroule tranquillement cette fantasy prototypale, sans trop d’excès, avec un classicisme presque provocant. Rosny fait du bon boulot, la narration est efficace, servie par un style ciselé, aux envolées parfois poétiques. L’ouvrage est par ailleurs aux standards habituels des éditions Callidor : beau papier, illustrations de qualité, couverture à rabats, préface éclairante. À noter que le titre n’est pas vendu seul mais offert pour l’achat de deux ouvrages du catalogue.
Sam Lermite

Godzilla
Shigeru Kayama – Ynnis éditions – mai 2021 (romans inédits traduits par Sarah Boivineau et Yacine Youhat – 288 pp. GdF. 14,95 euros)
Tout le monde connaît Godzilla, la créature issue des fonds sous-marins, qui détruit sur son passage. Beaucoup de monde connaît Godzilla, les films, qu’il s’agisse de la version originale japonaise de 1954 (ou du remontage américain de celle-ci) et de ses innombrables suites, ou des remakes américains récents, plus ou moins réussis. Mais peu de gens connaissent le roman d’origine, signé Shigeru Kayama, et pour cause : il était resté inédit en langue française jusqu’à ce que les éditions Ynnis décident de le publier en cette année 20021. Le lectorat français se voit donc proposer un livre fondateur ; il convient toutefois de noter qu’il n’y a pas eu d’abord le roman, puis son adaptation au cinéma. Tout a commencé par une idée du producteur Tomoyuki Tanaka, qui a imaginé l’histoire du « Monstre géant venu de 20 000 lieux sous les mers » comme base d’un film pour la Toho. Il demanda alors à Shigeru Kayama de rédiger un roman, que devaient ensuite adapter Ishirô Honda, le réalisateur du film, et Takeo Murata. Livre et film sont donc intriqués, sans que le premier soit la novélisation du deuxième ou le deuxième une simple adaptation d’un matériau préexistant. De fait, les différences entre les deux sont relativement minimes, même si Kayama a davantage de place pour travailler ses personnages, et notamment Sinkichi, le « héros », qui se voit fusionné dans le film avec un protagoniste plus secondaire du roman. Autre ajout intéressant à signaler, la création par Kayama de l’organisation tokyoïte de soutien à Godzilla : le professeur Yamane, qui déjà dans le film ne souhaite pas qu’on tue le monstre pour pouvoir l’étudier et mettre à profit sa fascinante résistance à la radioactivité, va encore plus loin dans le roman, en organisant une propagande visant à retourner l’opinion publique sur le devenir de la créature. Le roman est en revanche parfaitement en phase avec le propos global du film, en s’inscrivant ouvertement contre l’utilisation de l’arme atomique sur Hiroshima et Nagasaki, et les essais nucléaires qui perdurent en 1954. Cette position anti-prolifération culmine, comme dans le film, dans la scène finale, où, après avoir tué Godzilla, le docteur Serizawa se suicide pour que son arme ultime, le Destructeur d’oxygène, ne passe pas aux mains de personnes malintentionnées.
La lecture de ce roman prolonge ainsi l’expérience du film, en l’enrichissant de diverses manières ; on la conseillera donc, tout en signalant que tout cela est parfois empreint de naïveté, à l’image des descriptions sonores, puisqu’ici les vaches font « meuh meuh », les oiseaux « cui cui », les mitraillettes « tacatac » et les voitures de pompiers « hou, hou, hou »… À noter que ce livre propose également le roman à l’origine du deuxième film de la série, Le retour de Godzilla (eh oui, il n’était pas vraiment mort), nettement plus court que le premier, presque un simple scénario, et également moins convaincant. Et si l’on veut être totalement exhaustif sur Godzilla, on pourra avec grand profit compléter par la lecture de cette bible qu’est Kaiju, envahisseurs & apocalypse. L’âge d’or de la science-fiction japonaise de Fabien Mauro (Aardvark).
Bruno Para

Dark Sky (Keiko T2)
Mike Brooks – Fleuve Éditions, coll. « Outrefleuve » – mai 2021 (roman inédit traduit de l’anglais [UK] par Hélène Collon – 368 pp. GdF. 21,90 euros)
Il y a deux ans, Fleuve sortait en français le premier tome de la série narrant les aventures du vaisseau spatial Keiko et de son équipage haut en couleur, mené par Ichabod Crane, personnage hâbleur au passé bien peu glorieux. Alors que le premier tome est désormais disponible en format poche, l’éditeur sort enfin le deuxième volume. Soyez avertis : si Dark Run plongeait la tête du lecteur ou de la lectrice dans les étoiles pour lui permettre de s’échapper de la réalité le temps de quelques pages, Dark Sky est, à l’image de notre époque, confiné. Ici, hormis le chapitre introductif et quelques pages en conclusion, tout se passe en vase clos, et plus exactement dans les entrailles de la planète minière Ourragham. Alors qu’ils ne doivent y faire qu’une simple mission de collecte d’information, les membres d’équipage du Keiko se retrouvent coincés dans la capitale par un ouragan de surface qui dure plusieurs jours et empêche toute sortie et toute entrée dans l’espace. Alors que la révolte gronde dans la population, ses différents équipiers vont être séparés de force et devront apprendre à composer avec des alliés surprenants…
Si Dark Run était un roman choral où la jeune Jenna, hackeuse ayant fui une existence privilégiée, servait de porte d’entrée pour découvrir le Keiko et surtout le passé de son capitaine, Dark Sky est beaucoup plus éclaté. L’équipage étant très vite divisé par paires, la narration saute de l’un à l’autre pour faire avancer l’action, sans qu’il y ait de réels liens entre eux, sauf à la toute fin. Ici sont mis en avant la seconde du vaisseau, Tamara – et son passé de « black ops » aussi des services d’espionnages américains (toute ressemblance avec le comportement de la CIA auprès de certaines agitations politiques dans des pays tiers, notamment en Amérique latine et notamment dans les années 70 et 80 étant parfaitement voulue) – ainsi qu’Apirana (qui s’adoucit un peu trop au prétexte d’apporter de la profondeur au personnage). Mike Brooks évite ainsi le piège de nombres de tomes 2, en ne faisant pas une redite dans son second livre de ce qui fit le succès du premier. En revanche, il risque de dérouter celles et ceux de son lectorat venus y chercher un space opera de plus. L’ambiance louche plus sur un mélange entre le roman d’espionnage anglo-saxon à la Tom Clancy et une certaine critique politico-sociale qui n’est pas sans rappeler George Orwell (et pas uniquement son 1984). Dark Sky se lit toutefois très bien et n’oublie pas d’être avant tout ce qu’on attend de lui : un gros pavé de lecture détente pour oublier la reprise et la fin de l’été. Mission accomplie !
Stéphanie Chaptal
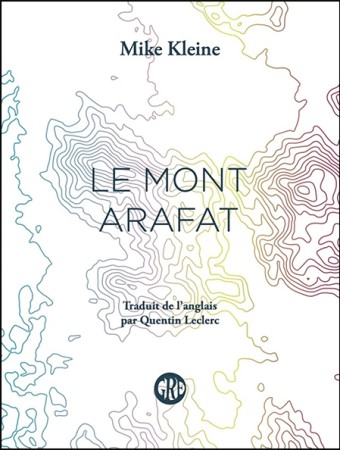
Le Mont Arafat
Mike Kleine – Éditions de L’Ogre – mai 2021 (roman inédit traduit de l’américain par Quentin Leclerc – 168 pp. Semi-poche. 18 euros)
Initialement paru en 2014, Le Mont Arafat entre tout à fait dans la catégorie des OLNI (Objet Littéraire Non-Identifié) en prenant l’apparence d’un petit roman déroutant, composé comme un collage psychédélique, protéiforme, où le sens semble nous échapper tout en étant manifestement omniprésent.
Œuvre de fin du monde, aux morts innombrables, aux destins tragiques, aux références nombreuses (et lovecraftiennes à n’en pas douter) et à l’humour noir indéniable, c’est un livre qui se picore avec un mélange d’enthousiasme et de surprise frôlant parfois l’incompréhension. C’est aussi une œuvre qui flirte avec une poésie de l’effondrement.
Si l’on tente de rationnaliser, bien sûr, des chapitres se répondent, des protagonistes se retrouvent ici ou là, un film se tourne, un serial killer trouve refuge non loin, et la chronologie bien qu’éclatée semble se constituer entre plusieurs événements, et les dieux, déesse et autres divinités (toujours inscrites sous cette forme barrée) étendent sans nul doute leur ombre furieuse et folle sur plusieurs chapitres et personnages… et le Mont Arafat agit là comme un aimant, qui agrège cette somme d’histoires, de fins du monde plus ou moins importantes, de discours, de rencontres et de cultes, dans une composition hallucinée, captivante, et certainement efficace.
Dire que j’aurais compris Mont Arafat serait mentir ; j’ai néanmoins apprécié cette lecture, dans laquelle il n’est pas obligatoire de comprendre chaque référence. En soi, se laisser ici porter par l’expérience active ou contemplative de lecture et de langue vaut déjà le détour. Aussi, merci à Mike Kleine, son traducteur et aux éditions de l’Ogre d’avoir osé nous proposer ce voyage vers le Mont Arafat, aussi recommandable qu’indescriptible.
Éva Sinanian

L’Ami imaginaire
Stephen Chbosky – Le Livre de Poche, mai 2021 (réédition d’un roman traduit de l’anglais [USA] par Jean Esch – 980 p. Poche. 10,90 euros)
Les USA sont une nation de migrants : qu’elle soit intérieure ou extérieure, la migration appartient donc à l’imaginaire de ce pays. Ce n’est donc pas une surprise si L’Ami imaginaire commence par une migration, celle d’une mère et de son jeune fils. Celle-ci tient de la fuite, même s’il s’agit en réalité de trouver un nouveau départ pour s’épargner la misère et le déclassement. Les USA sont aussi une nation marquée par les inégalités sociales : Kate et Christopher appartiennent à l’une des classes les plus basses – celles qui sont piégées dans les hôtels miteux, les écoles de seconde zone et autre gig economy. Christopher possède par ailleurs le handicap d’une dyslexie non corrigée, qui le rend presque inapte aux études et le condamne donc à être un paria dans une civilisation d’écrit.
Un « ami imaginaire », c’est une construction mentale esquissée par un enfant déçu par la réalité : l’ami imaginaire aide, sait et ne juge pas… Le fantastique, dans ce tableau imaginé par un auteur à qui Steinbeck semble tenir lieu de surmoi, ne se greffe ni ne s’infiltre au réel : le postulat de L’Ami imaginaire est qu’il existe une réalité alternative où vivent des entités inquiétantes, certaines cherchant à faire venir à elles les habitants du monde réel. Coopérer avec elles, comme Christopher le découvre, est une garantie de changement : attiré dans leur monde par une bizarrerie météorologique, libéré par un être que les adultes autour de lui interprètent comme un ami imaginaire, il en sortira guéri de sa dyslexie et deviendra un vecteur de chance. Dans un univers tout aussi stratifié que la société des USA, on n’a toutefois rien sans rien… et l’ami imaginaire de Christopher lutte contre une entité antagoniste.
L’être humain a-t-il sa place dans un univers où coexistent et s’interpénètrent différentes réalités ? Dans Les Enfants du maïs, Stephen King montrait que parfois l’être humain s’incline devant la puissance d’ordre supérieur ; dans Ça, il racontait au contraire l’histoire d’une rébellion réussie. On retrouve dans L’Ami imaginaire un peu de ce choix contradictoire – entre l’adoration ou la révolte – imposé aux protagonistes humains. On regrette le côté brouillon et convenu de la cosmogonie esquissée ici. Le conflit dans le monde imaginaire s’exporte vers le monde réel, pour le malheur de l’humanité, sans que la nature des entités impliquées soit explicitée. Une des phrases de ce roman – sans nul doute provocatrice pour certains – en constitue l’une des clés, le prénom du protagoniste en étant une autre : l’un des personnages pense que le Christ aurait pu avoir été crucifié… « pour complicité » ! En fin de compte, L’ami imaginaire s’avère être un roman bien trop long pour son propre argument : les coups de théâtre lassent le lecteur, l’usage désordonné des majuscules l’agace, la conclusion l’achève.
Migration, strates sociales, années 10 du XXIe siècle et entités inquiétantes : il y avait sans nul doute beaucoup à faire avec ces postulats. Le principal défaut du roman d’horreur qu’en a tiré Stephen Chbosky est toutefois de ne pas faire peur.
Arnaud Brunet

Mars
Asja Bakić – Agullo, coll. « Agullo Court » – mai 2021 (recueil de nouvelles inédit traduit du croate par Olivier Lannuzel – 160 pp. Semi-poche. 12,90 euros)
Encore largement inconnue des lecteurs français Asja Bakić est une poétesse bosniaque, aujourd’hui installée en Croatie. L’heureuse initiative des éditions Agullo de traduire son premier recueil de nouvelles, Mars, initialement paru en 2015, nous donne à entendre une voix originale de la jeune SF européenne, autant qu’un écho inattendu du dernier conflit qui a ravagé les Balkans voici à peine trente ans, lorsque l’auteur était enfant. Sans surprise, la plupart des dix nouvelles qui composent le recueil s’avèrent dystopiques, souvent à la lisière de l’absurde. On pense parfois aux textes les plus sombres d’un Dino Buzzati.
Trois nouvelles s’assument de pure SF : « Le Monde en bas » , seule fiction martienne du recueil, nous présente une colonie pénitentiaire où la Terre a exilé tous ses écrivains, et l’inquiétante puissance d’un petit livre – Mars, bien sûr. « Asja 5.0 » – Asja ? tiens donc ? – évoque le clonage d’un écrivain qui doit réinventer la pornographie dans un monde qui a oublié la sexualité. Enfin, « Abby », d’inspiration plus dickienne, variation sur le thème du robot qui ne se sait pas robot. Un quatrième, « L’Hôte », hésite entre SF et fantastique, à moins que ce ne soit une métaphore de la puissance du don littéraire… Deux autres poursuivent la mise en abyme pour traiter aussi de livres, d’écriture et de plagiat : « Excursion dans le Durmitor », décrit une sorte de Purgatoire littéraire, également sur un mode fantastique ; et « Passions » un pur cauchemar d’écrivain.
« Le Trésor enterré » , « Les Thalles de madame Lichen » et « Carnivore » sont des contes cruels, au décor presque réaliste mais à l’ambiance pesante, là encore à la limite du fantastique. Plus réaliste et plus dur encore, le texte le plus fort du recueil est peut-être « La Route vers l’ouest », qui nous raconte à hauteur d’enfant les rationnements et l’attente de l’exil dans une ville européenne fantôme, dévastée par la guerre…
Au total, un recueil transfictionnel (pour emprunter le terme à Francis Berthelot) très homogène – trop, même, peut-être, avec une tonalité assez uniforme entre des nouvelles très différentes (mais seul un lecteur du croate pourrait nous dire si la responsabilité en incombe à l’auteur ou à son traducteur) – et la rencontre d’un imaginaire puissant qui réussit paradoxalement à faire émerger comme un espoir de rédemption (par les femmes, protagonistes de toutes les nouvelles ?) d’une accumulation d’horreurs. À découvrir.
Éric Picholle

Numérique
Marina & Sergueï Diatchenko – L’Atalante coll. « La dentelle du cygne » – mai 2021 (roman inédit traduit du russe par Denis E. Savine – 411 pp. GdF. 23,90 euros)
Passer ses journées devant son ordinateur à tester de nouveaux jeux vidéo, le rêve pour beaucoup d’adolescent(e)s. Et même pour beaucoup d’adultes. Et c’est exactement ce que Maxime, un riche patron d’entreprise au look pour le moins étrange, propose à Arsène, jeune garçon plein d’aisance dans les jeux mêlant stratégie et manipulation. Après l’avoir tiré des griffes de pirates informatiques sans scrupule, il le met en compétition pour un poste idéal. Mais la concurrence est rude : pas d’autres ados sans expérience de la vie comme lui, mais des adultes méprisants au passé autrement plus riche. Pour les départager, des épreuves étranges et déstabilisantes. À travers elles, Arsène va voir son regard sur lui-même et, surtout, sur le monde qui l’entoure, se modifier de façon radicale.
Deuxième roman situé dans le cycle des « Métamorphoses », inspiré d’Ovide, Numérique laisse de côté la magie du premier opus pour l’univers, a priori plus terre à terre, des bits et des octets. Et par ce changement de sujet, il perd en mystère ce qui faisait le charme puissant de Vita Nostra. Paru en 2009 en VO, Numérique n’est pas trop daté, pour ce qui est des références aux ordinateurs : les jeux imaginés, les passages dans le réseau tiennent encore la route si on n’est pas trop difficile. Une prouesse quand on voit la vitesse de transformation de ce secteur. Mais les petits tours de passe-passe des auteurs sont moins efficaces dans ce deuxième opus. On les voit venir de plus loin et les ficelles sont plus grossières.
Rien de rédhibitoire pour autant. Numérique est un roman très agréable à lire et propose des rebondissements qui maintiennent l’intérêt du lecteur de bout en bout, à part quelques temps brefs morts. De plus, il interroge sur le libre-arbitre et sur notre relation au pouvoir. Arsène se voit offrir toujours davantage de possibilités d’influer sur les autres, sur la réalité. D’ailleurs, il s’interroge ouvertement sur ce marché aux allures de pacte faustien auprès de son possible futur patron, Maxime. Qui réfute absolument cette idée. Mais doit-on le croire ? Finalement, au fur et à mesure de l’accroissement de ses pouvoirs, Arsène en vient à se demander ce qui compte vraiment dans l’existence. Il se pose des questions sur l’envie ou son absence devant le manque de difficultés à obtenir l’objet des désirs, devant l’abondance. Comme les riches qui, pouvant tout se permettre, perdent toute volonté de se battre et, à long terme, de vivre.
Ce questionnement, disons-le franchement, n’est pas d’une grande originalité. Mais son traitement, lui, n’en manque pas dans certaines fulgurances. Les auteurs savent encore surprendre leur lecteur et l’emmener plus loin qu’il n’imaginait. Et certains personnages secondaires se montrent plaisants à suivre ou à détester. Malgré tout, Numérique reste en-deçà de Vita Nostra. Pas suffisamment, cependant, pour ne pas attendre avec intérêt la prochaine parution du dernier tome de cette trilogie au goût d’étrange, portée par un vent froid venu de l’est.
Raphaël Gaudin

Capitaine Futur 6 : La Course aux étoiles
Edmond Hamilton – Le Bélial’, coll. « Pulps » – juin 2021 (roman traduit de l’américain par Pierre-Paul Durastanti – 216 pp. GdF. 15,90 euros)
Sixième opus des aventures du Capitaine Futur, La Course aux étoiles apparaît comme l’incarnation de cet esprit pulp dont Pierre-Paul Durastanti se veut le héraut et traducteur au Bélial’. La recette est désormais connue. Prenez un héros aux qualités surhumaines, résolu à combattre la malveillance d’où qu’elle provienne. Associez-le à une équipe de compagnons dévoués, à la fois mentors et faire-valoir. Confrontez-les à une menace, un mystère à élucider ou à un adversaire retors. Puis, laissez se dérouler l’aventure, de préférence à un rythme trépidant, d’un cliffhanger à un coup de théâtre, sans trop réfléchir, en optant pour une forme de récit juvénile et vitaliste plutôt que pour l’introspection. Capitaine Futur est tout cela et bien davantage. Un morceau d’histoire de la Science-fiction américaine, lorgnant vers les ressorts du comics. Un space opera suranné, un tantinet routinier dans son développement, mais ne renonçant jamais au bigger than life. Un récit d’aventures jalonné de gimmicks, d’humour, de désinvolture et de décontraction, gouailleur et imperturbable face à l’adversité, confortable comme une paire de chaussons que l’on se plaît à enfiler après une journée au chagrin.
Alors, qu’importe la menace. Les astronefs peuvent disparaître mystérieusement, semant la panique et le doute jusque dans le cœur des fuséologues téméraires. Le système solaire peut se dérouler comme un tapis de jeu pour sales gosses. Les extraterrestres inquiétants et autres monstres affamés ou créatures mécaniques bornées par une programmation funeste peuvent redoubler d’effort et de malice pour nuire à la civilisation. Les cyclotrons surchauffés peuvent cracher les radiations jusqu’à la fusion ultime de leur gravium et les tuyères exploser en chapelets colorés, histoire d’égayer l’espace. Grag et Otho peuvent continuer à se chamailler, Simon Wright goûter à l’indépendance d’une mobilité retrouvée et Joan Randall flirter avec le beau capitaine imperméable à ses tentatives de séduction. Seul compte un émerveillement, certes daté, mais sans cesse renouvelé par les découvertes. Seul importe l’envie de se frotter à l’étoffe des héros, de goûter au plaisir régressif des aventures du colosse à la chevelure flamboyante, ce sorcier de la science, cet homme de demain voué à sauver la Terre et toutes les créatures intelligentes du système solaire. Ad astra et au-delà !
Laurent Leleu