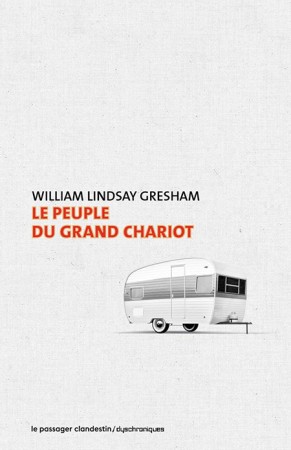Histoire du futur
Robert A. Heinlein – Mnémos « Intégrale » – septembre 2020 (romans et nouvelles traduits de l’américain par Pierre Billon, Jean-Claude Dumoulin, Franck Straschitz et Eric Picholle, revus et complétés par Pierre-Paul Durastanti et Thibaud Eliroff – 832 pages – GdF – 35 euros)
Cette nouvelle intégrale de l’Histoire du futur diffère grandement de celle de 2016. Les deux spécialistes français de Heinlein, Ugo Bellagamba et Éric Picholle proposent une chronologie et un nouveau découpage des sections (Les Années folles, La Fausse Aube, Période d’exploitation impériale, Hiatus et Première civilisation humaine), agrémentés d’un paratexte permettant de mieux apprécier l’ampleur de ce chef-d’œuvre de la science-fiction.
Il ne s’agissait pourtant que des débuts de l’auteur, la rédaction s’échelonnant, pour l’essentiel de 1939 à 1950. Comme le précisait déjà R. A. Heinlein dans sa préface de l’époque, supprimée ici selon ses vœux, il ne s’agit pas de prophétie mais d’une histoire du futur entre d’infinité d’autres ; la réalité s’est d’ailleurs très vite chargée de faire mentir certaines projections, parfois naïves, aussi bien dans les sciences que la marche du monde, mais l’actualité a parfois redonné à certains récits une pertinence inattendue. Ainsi, « L’Homme qui vendit la Lune », formidable épopée du visionnaire D. D. Harriman, aux méthodes parfois douteuses mais à l’énergie et à la foi inébranlables pour promouvoir le voyage spatial, redevient plausible depuis que Jeff Bezos et Elon Musk, un fan de Heinlein, ont remis les entreprises privées au goût du jour.
Il n’est pas vraiment utile de détailler l’histoire du futur imaginée ici, ni même les étapes, qui comprennent pourtant une énergie solaire promue (en 1940 !), un coup d’arrêt de la conquête spatiale (durant une période d’obscurantisme religieux) et le premier vaisseau-génération à la population frappée d’amnésie, sinon pour apprécier l’habileté avec laquelle Robert Heinlein intègre aux innovations scientifiques l’ensemble des sciences humaines, du politique au social, sans oublier les impacts psychologiques.
Ce qui frappe est l’attention accordée à tous les maillons de la chaîne, du simple employé au chef d’entreprise et aux modifications de comportement ou aux expressions langagières accompagnant une nouvelle technologie, le tout au service d’une critique sociale, affichant parfois un pragmatisme rugueux mais plein de bon sens. Rien que dans « La Logique de l’Empire » (1941), autour de l’esclavage colonial, il est question de contrats d’exploitation volontaire anticipant l’ubérisation du travail, d’analyse du système économique qui induit cette exploitation, d’avantage dû à la bêtise qu’à la perversité, de dénonciation du journalisme à sensation et de la capacité des sociétés à éliminer leurs défauts : « Avant de s’améliorer, il faudra que la situation empire encore pas mal. » C’est aussi pour cette raison que des visions fausses comme « Les routes doivent rouler » ont gardé leur intérêt : le récit de la contestation sociale prend le pas sur la pertinence du moyen de transport.
On peut parfois trouver Heinlein expéditif et lui reprocher une certaine intransigeance. Exécution ! Tout doit aller vite. Il est vrai qu’il n’accorde que peu d’intérêt aux incapables et met en exergue le courage, la persévérance et l’esprit d’entreprise au service du bien commun. Son héros est un pragmatique pressé et un moraliste convaincu. Il n’a pas de mots assez durs à l’égard des religions ou de tout ce qui entend limiter ou confisquer le savoir. Bien des passages attestent de ses hauteurs de vue comme de son féminisme progressiste, qui met en scène une scientifique (motif de refus d’une nouvelle par Campbell) ou envoie la première femme dans l’espace.
Les récits ne s’embarrassent pas non plus de fioritures. Ils se cantonnent aux scènes essentielles, concluent sans s’attarder une fois le but atteint. Cette sécheresse très efficace sur le plan de l’action cède parfois la place à des envolées lyriques et des récits poétiques. L’émotion l’emporte à la lecture des « Vertes collines de la Terre », de « Requiem » ou de « Oiseau de passage », qui campe avec justesse et sensibilité une adolescente jalouse qui apprend à une supposée rivale à voler sur la Lune.
L’excellente préface de Ugo Bellagamba, en historien du droit et des idées politiques, rappelle la portée de Heinlein dans sa dimension mythique, tandis que Éric Picholle, qui introduit aussi chaque récit, revient en postface sur les aspects plus techniques et historiques de cet ensemble. C’est dire si, avec cette édition patrimoniale, on frôle la perfection.
Claude Ecken

L’Héritage de l’Empire (Les Dieux Sauvages T4)
Lionel Davoust – Critic, collection « Fantasy » – novembre 2020 (roman inédit – 980 pages. GdF. 25 euros)
Si vous n’avez pas lu les trois précédents tomes de la série, vous parcourez ces lignes à vos risques et périls. Quatrième volume des « Dieux Sauvages », L’Héritage de l’Empire poursuit la fresque épique revisitant l’histoire de Jeanne d’Arc dans l’univers d’Évanégyre.
La forteresse de Loered a résisté. Isolé, presque entièrement détruit, le verrou du fleuve a permis de protéger la Rhovelle. Mériane, sanglée dans Invincible, une armure volée à l’ennemi et convertie au service de Wer, a tenu sa promesse. Ganner, le Prophète d’Aska, décide de marcher vers Ker Vasthrion, la capitale perchée sur une falaise. Il sait pouvoir y trouver, dans les entrailles oubliées de tous, le moyen de vaincre définitivement Wer. Erwel de Rhovelle, nouveau Roi, tente toujours d’unir les provinces pour lutter contre l’armée d’Aska tout en déjouant un clergé bien décidé, entre deux intrigues pour conserver la mainmise sur le trône, à se débarrasser de Mériane, Héraut bien trop encombrant car née femme. Le calvaire de cette dernière ne cesse d’empirer. L’usage d’Invincible, qui se nourrit de sa force, conjugué à une guerre interminable dont l’issue semble plus que douteuse l’épuise physiquement et mentalement. Mériane dispose de bien peu d’alliés, d’autant que Wer lui demande une foi absolue tout en se jouant d’elle. Au fil du roman elle perd certains de ses plus fidèles amis parfois par la grâce d’un dieu traître. Les dialogues entre Wer et Aska se font à nouveau plus présents dans le roman. Frères ennemis pour lesquels l’humanité n’est rien, leur nature se dévoile peu à peu. De même Lionel Davoust dévoile un peu plus la technologie à l’œuvre, héritage de l’empire d’Asrethia, perçue comme de la magie, et à quel point les factions en présence ont perdu la capacité de la comprendre et de l’utiliser.
L’Héritage de l’Empire apporte son lot de révélations, pour certaines inattendues, pour d’autres prévisibles. Lionel Davoust parsème son récit d’indices à destination des lecteurs dont certains débouchent sur de fausses pistes – bien joué ! Ce quatrième tome est placé sous le signe de la cohérence tant dans le développement de l’histoire que dans l’évolution et les motivations des personnages. La maîtrise de la narration à multiples points de vue répond aussi à la logique interne de l’univers qui n’est jamais prise en défaut. Même si dans le premier tiers du roman il peut paraître indolent, le rythme évolue crescendo vers un final épique à souhait, effets spéciaux compris. Les scènes de bataille sont toujours aussi détaillées et précises.
« Les Dieux Sauvages », saga de fantasy francophone des plus ambitieuses, trouvera sa résolution dans La Succession des Âges dont la parution est prévue au printemps 2022. Il reste à espérer que ce tome conclusif soit à la hauteur des précédents et qu’il termine en beauté une série qui jusqu’ici n’a pas déçu.
Karine Gobled

La Sirène d’Isé
Hubert Haddad - Zulma - janvier 2021 (roman inédit - 192 pp. GdF. 17,50 euros)
C’est l’histoire d’une vaste demeure, la fondation des Descenderies, ancien sanatorium transformé en asile, au bout des landes, à la pointe sud de la baie d’Umwelt. Le professeur Rimwald dirige cet institut où les jeunes phtisiques ont été remplacées par les folies les plus diverses. Pour les traiter, le professeur a élaboré une thérapie par le choc, mise en œuvre au sein d’un dédale végétale et angoissant, et dont le rythme secret repose sur le « Petit Labyrinthe harmonique » de Jean-Sébastien Bach (BWV 591). La nature qui environne cet asile est également inquiétante : la falaise sur laquelle se trouvent les Descenderies est grignotée peu à peu par la mer. Régulièrement, l’une des pensionnaires disparaît dans les flots. L’une d’elles, tout particulièrement, a retenu l’attention du docteur : la belle Leeloo, au babil d’oiseau, qui a mystérieusement donné naissance à un enfant sourd, Malgorne. Après la disparition de sa mère, l’enfant qui grandit au sein de l’asile deviendra le jardinier du labyrinthe. Au pied de la falaise, devant un cadavre de rhytine qui rappelle à tous la légende des sirènes, il va croiser la belle Peirdre et son intrigante amie. De là, par cercles de plus en plus larges, les destinées vont se croiser, jusqu’à se catalyser dans un orage magnifique dont la foudre percera les tympans.
Que le Bifrostien ne s’y trompe pas : c’est du fantastique le plus ténu, tellement qu’on pourrait se dire qu’il n’y en a pas. Car le fantastique, c’est une connivence devant une question qui ne se résout pas : il se partage, au moins avec le lecteur qui sert de point d’ancrage dans le réel. Pour ainsi dire, rien de tel ici : chaque personnage est un monde propre à lui seul, un Umwelt (environnement, en allemand), et incarne le mystère de ce qu’un autre peut percevoir du réel qu’on partage avec lui. La surdité de Malgorne en est le meilleur exemple : que reste-t-il de la lumière quand elle baigne un monde totalement silencieux ? Comment saisit-on les rythmes et leurs secrètes concordances avec notre psyché quand la musique se tait ? Que peut être le temps quand l’horloge reste mutique ? Plutôt que d’insister sur l’étrangeté fantastique de la perception d’autrui, le roman nous invite à la comprendre, tant et si bien qu’à la fin, une femme échouée sur les récifs, le bas du corps pris dans les algues ne nous apparaît plus vraiment comme la sirène tant espérée dont la rhytine était la préfiguration.
La langue, très française par son usage des abstraits, y est belle, ciselée et un peu âpre, et pour cette raison trouve l’harmonie juste pour ces personnages pris dans leur handicap ou leur folie, douce ou moins douce. Une certaine distance demeure, recherchée sans aucun doute, qui atténue la tentation du romantisme ou de la sensualité que Hubert Haddad sait manier ailleurs avec talent. Poussez donc la grille des Descenderies et venez y faire résonner votre Umwelt au cœur du labyrinthe : vous y (re)trouverez bien quelque chose ou quelqu’un.
Arnaud Laimé
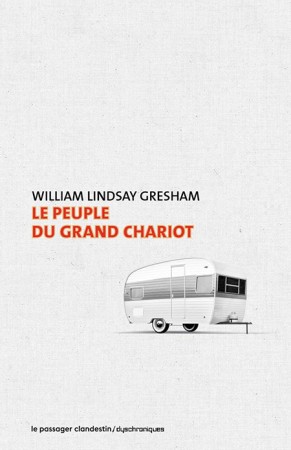
Le Peuple du Grand Chariot
William Lindsay Gresham – Le Passager Clandestin, coll. « Dyschroniques » – février 2021 (traducteur de l’américain inconnu –réédition. 58 p. Poche. 5 euros)
Cette nouvelle publiée en 1953 dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction nous conte l’histoire d’un jeune demi-gitan qui quitte la Grande Vie (la vie errante) par amour, réitérant de la sorte celle de ses parents. Il y reviendra après la destruction de son village d’élection par une tornade. Ceci dans un contexte post-apocalyptique, après la guerre atomique.
La nouvelle se veut un plaidoyer en faveur des gens du voyage qui ont souvent été persécutés au cours de l’histoire, leur sort étant plus ou moins comparable à celui des Juifs. Dans cette histoire, les Roms restent détenteurs d’un savoir low tech mais pratique, qu’ils livrent avec parcimonie au Gadjé – les Gadjé sont aux Gitans ce que les Gentils sont aux Juifs – ceux qui ne sont pas du Peuple.
Hélas, le texte ne tient ensuite plus la route. Ainsi, on y voit les Gitans donner des conseils en matière agricole : s’il y a bien une chose que les Gitans ne sauraient être, c’est agriculteurs ; l’agriculture étant la cause première de la sédentarité. Mais c’est plus encore l’attitude des Gadjé qui est ridicule de stupidité. On voit tout un village tirer un tracteur à chenille lui-même attelé à la charrue. Quand une chenille vient à se rompre, le village se laisse mourir de désespoir et de dépression. À un autre moment, on voit la mère du personnage s’échiner à monter des seaux d’eau au grenier pour y remplir des réservoirs afin d’avoir de l’eau au robinet pour entretenir l’illusion que la vie continue comme si la civilisation ne s’était pas effondrée. Quand la nouvelle est publiée, en 1953, l’eau courante n’est certes plus rare, surtout en milieu urbain, mais en campagne, c’est autre chose… La guerre atomique date suffisamment pour que Boston soit presque oublié mais des vélos sont encore préservés : or, les pneus de vélos se détériorent au bout de dix ans. Après qu’une faucheuse ait été détruite par une tornade, le roi des Roms donne aux villageois la faux ou la faucille pour moissonner…
À la fin du texte, on découvre une explication hétéroclite comme quoi les Roms serait un peuple venu des étoiles, qui aurait progressivement tout appris aux Gadjé qui, dès qu’ils en surent assez, bousillèrent leur civilisation – le cycle se répétant ainsi sans fin. Ce qui est impossible. Les ressources accessibles en minerais, charbon ou pétrole avec des moyens low tech n’existent plus pour un éventuel recommencement ; nous les avons utilisés. Si la civilisation tombe, il n’y aura pas de seconde chance.
Sympathique, cette nouvelle se laisse lire mais n’est guère crédible.
Jean-Pierre Lion

Léonid doit mourir
Dmitri Lipskerov – Agullo Fiction – janvier 2021 (roman traduit du russe par Raphaëlle Pache, 435 pp. GdF. 22 euros)
Né des œuvres d’un père criminel, exécuté dans les caves de la Loubianka, et d’une mère morte en couches, Léonid débute dans la vie sous des auspices funestes. Interné parmi les enfants attardés, oublié de tous en dépit de ses cris de soiffard, il a heureusement de la ressource à revendre, de l’intelligence à dispenser et une énergie vitale surnaturelle acquise aux tréfonds de la matrice de sa génitrice alors qu’il n’était qu’un embryon accroché à la paroi utérine. Il a aussi la haine pour cette comédie humaine dont il perçoit les effusions pathétiques par le truchement de sa mère. Bref, Léonid est un phénomène.
À sa manière, Angelina Lébédiéva est aussi un phénomène. L’ancienne femme de guerre, ex-sniper de l’Armée rouge et héroïne de la Grande Guerre patriotique jouit d’une santé de fer dans le corps décati d’une octogénaire. Tout le contraire des hommes auxquels elle s’attache et dont elle pressent la mort prématurée avant qu’elle ne survienne. Refusant les outrages de la vieillesse, elle n’aspire qu’à un élixir de jouvence afin de retrouver la peau de pèche de sa jeunesse.
Un peu passé sous les radars de la critique de genre, Dmitri Lipskerov est l’auteur de trois romans parus en France. D’abord publié aux éditions du Revif, les droits de son œuvre ont été cédés ensuite à Agullo pour sa collection « Fiction », lui conférant une plus grande audience. Écrivain remarqué de la Russie contemporaine, le bonhomme n’hésite pas en effet à flirter avec le fantastique comme le firent en leur temps Gogol et Boulgakov. Léonid doit mourir relève de cette tradition, permettant à Lipskerov de brosser un tableau caustique de sa terre natale. Entre URSS et Russie post-soviétique, il ausculte ainsi d’un œil goguenard, voire sarcastique, ses contemporains et la société russe. Un pays en proie aux spectres du KGB, à la pénurie, la pauvreté, la débrouille, la corruption et l’absurdité de l’existence. Rien de neuf sous le soleil de l’Est. Entre quête métaphysique et érotique, l’auteur dresse une série de portraits saisissants de drôlerie, ricanant de la médiocrité des rêves de grandeur des uns comme des autres. En dépit de la désillusion imprégnant les vies de Léonid et Angelina, Dmitri Lipskerov ne peut s’empêcher de montrer un peu de tendresse pour ces existences incomplètes, ployant sous le joug du destin, de l’Histoire et de la fatalité, laissant percer quelques fulgurances d’une cruelle lucidité.
Léonid doit mourir est donc une fable truculente, un récit picaresque dont la beauté baroque et la drôlerie tragique nous submergent sans coup férir. Assurément, voici une œuvre à découvrir.
Laurent Leleu

L’Athée du Grenier
Samuel R. Delany – Editions Goater, coll. « Rechute » – avril 2021 (recueil inédit traduit de l’américain par Marie Koullen. 170 p. GdF. 14 euros)
Samuel R. Delany qui appartenait à la Nouvelle Vague américaine, fut publié en France entre 1971 et 1984, puis disparut. Son énorme roman, Dhalgren (1975) ne trouva sous nos latitudes personne pour se risquer à le publier, ni Robert Louit, ni Gérard Klein, ni les éditions OPTA qui, tous, l’avait accueilli auparavant. Delany est un excellent styliste, ses livres sont complexes, voire carrément difficiles pour les plus récents. Delany est de « gauche » mais n’a rien à voir avec la gauche prolétarienne ni avec ce que les écrivains soviétiques non dissidents pouvaient bien alors écrire. Sa gauche était en avance de deux générations : bobo, politiquement correcte, féministe, pro-gay, artiste, anti-raciste, et aurait pu être végane ou écologiste. Après la publication de « La Fosse aux étoiles » chez Denoël dans la collection « Étoile Double », il n’y eut plus rien jusqu’en 2006 et la publication deHogg, roman hors genre proche de Vice Versa, chez Laurence Viallet. En 2008, Bragelonne sortit un gros omnibus : Les Chants des étoiles, rassemblant les space opera de Delany… En somme, 36 ans depuis le dernier inédit SF.
Et voici, en 2020, L’athée du Grenier. Eh bien, la disette va durer : ce n’est ni de la science-fiction ni même de l’imaginaire. C’est de la littérature mimétique. La novella est constitué d’une partie d’un journal apocryphe du génial philosophe et mathématicien allemand du XVIIe siècle, Wilhelm Gottfried Leibnitz, qui inventa la première machine à calculer et le calcul binaire. Ce journal raconte le séjour que Leibnitz fit pour affaires en Amsterdam en 1676 et le court voyage qu’il fit à La Haye durant ce temps pour rendre visite au philosophe juif Baruch Spinoza.
Les cinq premiers chapitres font état de son arrivée à Amsterdam et des préparatifs de son voyage à La Haye. Le chapitre 6 constitue le morceau de bravoure, racontant la rencontre avec Spinoza. Les derniers chapitres sont consacrés à son retour à Amsterdam et aux réflexions que lui ont inspirées la rencontre.
Contrairement aux assertions en quatrième de couverture, nulle tension ni suspense dans ce texte et la rencontre, si elle est discrète, n’est nullement secrète car il semble qu’en ces temps Spinoza n’ait guère été en odeur de sainteté et ses écrits pour le moins sujet à controverses, voire sulfureux. Les deux hommes évoquent leur monde et le « Rampjaar », cette année 1672 calamiteuse pour les Provinces Unies en guerre qui virent des cas de cannibalisme dans les campagnes ainsi que des questions plus triviales de la vie quotidienne.
Sur le chemin du retour, Leibnitz poursuit sa réflexion sur les selles, les latrines, le lavage des sous-vêtements, la domesticité et l’homosexualité, tout cela lié dans l’intimité. La question du lavage des dessous peut nous sembler pour le moins étrange mais au XVIIe siècle, ceux qui en portaient les faisaient laver par autrui, engendrant un rapport social des plus intimes qui mérite que l’on s’y interroge.
Dans ce journal apocryphe, Delany pastiche Leibnitz sans que je sache dire à quel point il y parvient. L’écriture recourt à des formes et tournures archaïques qui n’en rendent pas la lecture aisée. Écriture d’époque que Delany connait, mais jusqu’à quel point celle W. G. Leibnitz ? Il faudrait un expert du philosophe, ce que je ne suis nullement, pour le dire. De même, dans quelle mesure les questions évoquées ici auraient pu être celle de Leibnitz et Spinoza ou sont-elles celles de Delany, prêtées à ces personnages afin de leur conférer un relief particulier ?
L’article « Racisme & Science-Fiction » nous apprend que la science-fiction est un milieu raciste et accessoirement sexiste, où il y a bien trop de blancs et de mâles ; qu’il faudrait que ça change jusqu’à ce que les Afro-américains y représentent un taux d’environ 20% qui verra le déclenchement d’un conflit communautariste, celui-ci aboutissant à ce que les Afro-américains en viennent à avoir leurs propres congrès et conventions SF. Depuis la publication de l’article en 1998 aux USA, la SF a connu l’affaire des Sad Puppies (2013/2016), un groupe plutôt conservateur et non politiquement correct, en général décrit comme d’extrême droite, de suprémacistes blancs, militaristes et sexistes, qui firent campagne pour des listes de textes plus à leur goût. Delany insiste bien dans son article sur le fait que le racisme n’est pas ce que les Blancs veulent croire : ce ne sont pas que des violences, du mépris, des insultes, de la discrimination (ça l’est aussi). C’est que même les blancs qui prétendent ne pas vouloir être raciste le sont. Ainsi, placer à une table de dédicaces, Delany et Octavia Butler (écrivaine également noire), c’est du racisme, même si l’organisateur pensait bien faire. Si un blanc est amené à prendre toute décision administrative, organisationnelle, managériale ou autre concernant des personnes de couleur, il ne peut être que raciste. De même, si un blanc vote pour attribuer un prix à une œuvre de qualité d’un auteur afro-américain afin de donner de la visibilité au fait que la couleur de la peau n’est nullement un obstacle à la qualité, c’est encore du racisme…
Quant à l’interview, elle présente peu d’intérêt.
La novella ne concerne pas notre club ni les lecteurs de l’imaginaire. Elle présentera de l’intérêt à qui se passionne pour le XVIIe siècle, sa littérature, à sa pensée et à ses penseurs.
Jean-Pierre Lion