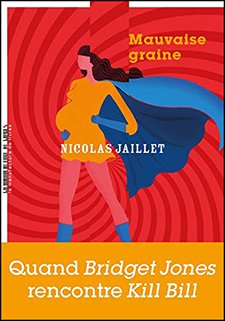Dimension Russie impériale
Anthologie proposée par Patrice et Viktoriya Lajoye - Black Coat Press, coll. « Rivière blanche » - mars 2020 (nouvelles pour l’essentiel inédites traduites du russe par Patrice et Viktoriya Lajoye - 274 pp. GdF. 20 €)
Après Dimension URSS (2009) et Dimension Russie (2010), Patrice et Viktoriya Lajoye terminent leur tour d’horizon de la SF russophone en nous proposant une sélection de nouvelles relevant cette fois du merveilleux scientifique. Passage en revue.
Le recueil s’ouvre avec la novella « Histoire extraordinaire d’un Pompéien ressuscité » de Vassili Avenarius, qui nous fait suivre les pas d’une momie ramenée à la vie par un scientifique italien. Le trope du choc des cultures se teinte ici d’amertume, alors que Marcus Junius Flaminius découvre la société industrielle. La satire se poursuit plus loin avec « Les lettres de Mars » de Vladimir Bariatinski, texte bref ressemblant surtout à une introduction à une déclinaison martienne des Lettres persanes. Côté proto-hard science, « Sur la lune » de Konstantin Tsiolkovsky consiste en une rêverie lunaire aussi platement écrite que fascinante au niveau des idées : le père de l’astronautique russe avait visé globalement juste, et le texte est d’autant plus étonnant qu’il remonte à 1887 (voir le sélénite Bifrost 95 pour une recension plus complète). Sous le patronage de Jules Verne, « Le Brig “Le Terreur” » de Ferdynand Ossendowski nous emmène dans les mers glacées du grand nord, sur les traces d’un navire porteur d’une virulente moisissure capable de tout détruire. Savants fous et amours contrariées sont au programme de cette ample novelette, inventive mais peut-être un brin trop convolutée. Pas tout à fait un voyage au centre de la Terre, « Les Ancêtres » de Sergueï Solomine est un journal de voyage dans un monde souterrain peuplé de batraciens géants et intelligents. Un texte prometteur mais qui pèche par sa brièveté. Le recueil comporte deux nouvelles de Valentin Frantchitch, « Les rayons de la mort » et « Le Char du diable », au sujet d’inventions dévoyées ou susceptibles de l’être. De fait, utopies et dystopies ne sont jamais très loin. « Le Parc royal » d’Alexandre Kouprine relève des premières, et met en scène des souverains dans une époque future qui conserve ses têtes couronnées à fin d’éducation. Il s’agit là d’un conte doux-amer réussi. « L’amour dans les brumes du futur » d’Andreï Marsov, sous-titrée « Histoire d’une romance en 4560 », appartient aux secondes. Unique texte (auto)publié de son auteur, paru aux tout débuts de l’ère soviétique, il nous présente deux amants désireux d’être proches au possible dans un monde où des rayons d’un genre particulier rendent impossible de garder pour soi toute pensée. Pas tout à fait convaincant dans sa narration, le texte préfigure toutefois des aspects de Nous autres de Zamiatine mais aussi de « Plus près de toi » de Greg Egan.
Au bout du compte, les dix nouvelles au sommaire du recueil présentent un panorama varié et inventif du merveilleux scientifique pré-Révolution russe. De quoi satisfaire les amateurs de curiosités.
Erwann Perchoc

Sirènes
Laura Pugno - Inculte, coll. « Noir » - mai 2020 (roman inédit traduit de l’italien par Marine Aubry-Morici - 172 pp. GdF. 16,90 €)
Premier roman traduit en France de la poétesse et autrice Laura Pugno, Sirènes nous immerge d’emblée dans un récit noir, oscillant entre métaphore et univers post-apocalyptique. L’argument prospectiviste se réduit en effet très rapidement à un prétexte, un décor laissant libre cours à un propos de nature plus éthique autour de la condition animale et des rapports de domination entre l’homme, la femme et la nature.
Découvertes très récemment dans les profondeurs océaniques, les sirènes de Laura Pugni ne ressemblent en rien aux représentations romantiques colportées par Walt Disney et consorts. Elles n’empruntent pas davantage leurs traits aux créatures de l’odyssée d’Ulysse. S’il faut rechercher une origine à l’inspiration de l’autrice italienne, elle se trouve plutôt du côté du légendaire médiéval et scandinave. Les sirènes sont ainsi des animaux sauvages soumis à leurs instincts, mais non dépourvus de sensibilité, même si le sujet n’est pas ici central. Dans un monde en proie au rayonnement mortel du soleil noir et à l’agonie du derme blanc, où la part privilégiée de l’humanité, issue de la fusion du libéralisme et de la criminalité à la mode asiatique, s’est réfugiée à Underwater, les créatures aquatiques sont élevées pour leur viande et l’attrait sexuel qu’elles représentent pour les yakuzas. Mais tout cela reste de l’ordre du décor. Un paysage propice à l’histoire d’amour entre Samuel, un killer déchu devenu soignant dans un élevage de sirènes, et la progéniture hybride née de sa relation avec une sirène. Une idylle sacrément tordue, inavouable dans un monde violent et sans autre moralité que le droit du plus fort, et dont on anticipe rapidement l’échec patent.
Sirènes fait aussi la part belle au côté sombre de l’humain, malmenant l’idéalisme des uns tout en confortant le cynisme des autres. On assiste ainsi au viol de la nature, dont les ressources sont pillées sans vergogne pour la satisfaction des vices. Cette profanation du vivant par la technique n’est pas sans évoquer certaines vidéos publiées sur Internet afin de dénoncer la condition animale dans les élevages et abattoirs. Sirènes nous renvoie aussi aux violences faites aux femmes, ravalées ici au rang d’objets sexuels ou de trophées échangeables comme des vignettes Panini.
Dans un style imagé, fait de résonances funestes et lancinantes, Laura Pugni distille le malaise, nous renvoyant une image pessimiste de l’humanité, ce cancer mortel pour la Terre dont l’agonie ne marquera pas la fin du monde, bien au contraire. Avis aux amateurs, vous voilà prévenus.
Laurent Leleu
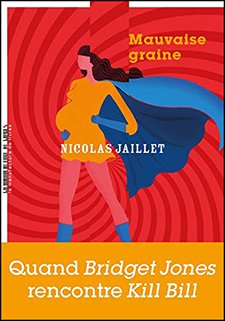
Mauvaise graine
Nicolas Jaillet - La Manufacture de Livres - juin 2020 (roman inédit - 344 pp. GdF. 18,90 €)
On avait déjà croisé Nicolas Jaillet dans les genres qui nous intéressent en 2010 avec Nous, les maîtres du monde (Après la lune), roman sympathique bien qu’un peu foutraque, mélange de super-héros et d’invasion extraterrestre. Après avoir publié d’autres bouquins (western, roman historique…), il nous revient avec ce Mauvaise graine, qui fait une nouvelle fois la part belle à la fusion des genres. Dans un mélange plutôt détonnant, puisque le bandeau proclame « Quand Bridget Jones rencontre Kill Bill ». Julie, jeune institutrice, célibataire malgré les tentatives de ses amis pour la caser, sent sa vie basculer lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte : elle n’a en effet pas eu de relations sexuelles depuis pas mal de temps ! Or les tests sont formels, et tous cohérents : un fœtus se développe en elle. Passé le premier instant de stupeur, puis la phase d’interrogation (le garder ou pas ?) vient le questionnement : n’a-t-elle vraiment pas couché avec quelqu’un ces derniers mois ? Par exemple lors d’une de ces soirées arrosées où elle s’est pris une cuite mémorable ? Aussi mène-t-elle l’enquête auprès de ses amis, pères potentiels de son futur rejeton (car oui, elle a décidé de le garder). Ce faisant, elle se découvre une forme éblouissante, et à vrai dire inédite chez elle. Mais quand elle réalise qu’elle a également développé une force surhumaine, et que certaines barbouzes paramilitaires sont à sa recherche, la peur gagne : que lui arrive-t-il exactement ?
Ça commence comme Bridget Jones, en effet, avec les interrogations pleines de drôlerie de cette femme qui ne comprend pas ce qui se passe. On est en pleine comédie sentimentale de situation, avec des dialogues savoureux, un rythme enlevé. Puis, peu à peu, la comédie cède la place au thriller ; l’humour ne disparaît jamais, loin de là, c’est même le leitmotiv de cet ouvrage, et parler de Kill Bill pour cette deuxième partie n’est pas totalement infondé. Le quotidien pépère de notre héroïne va se retrouver bousculé, jusqu’à basculer dans l’angoisse quand elle comprend qu’elle est recherchée, que certains de ses amis ne sont pas nécessairement ceux qu’elle croit, et qu’il lui faut quitter ce qu’elle a connu sans retour possible. On alterne ainsi les passages stressants et les éclats de rire, à un rythme soutenu jusqu’à la dernière page. Tout cela n’est pas d’une originalité folle, à vrai dire c’est même plutôt prévisible (la raison de sa grossesse) et parfois téléphoné (la cabane dans les bois), mais le plaisir manifeste de Nicolas Jaillet a la rédaction de son histoire abracadabrantesque s’avère communicatif. Dès lors, parler de page turner n’est pas usurpé, mais pas de la famille de ceux qui vous maintiennent en situation de stress permanent, plutôt de ceux qui vous font partager une tranche de vie avec un personnage central attachant. Sympatoche, une fois de plus.
Bruno Para

Les Formiciens
Raymond de Rienzi - Terre de Brume, coll. « Terra Incognita » - juin 2020 (réédition - 200 pp. GdF. 20 €)
À moins d’avoir vécu terré au fond d’une grotte ces trente dernières années, difficile d’avoir échappé aux « Fourmis » de Bernard Werber. Mais saviez-vous que cette trilogie entomologique a un ancêtre ? En 1932, l’écrivain français Raymond de Rienzi publia Les Formiciens, épopée miniature exhumée toutes les une ou deux décennies, et cette fois-ci par les éditions Terre de Brume.
Nous voici il y a cent vingt millions d’années, « vers la fin de l’ère secondaire », en un temps où « les tyrannosaures broutaient les arbres »… Passons. C’est aussi une époque où les fourmis n’existaient pas encore, mais cela, la science l’ignorait probablement à l’époque de publication du roman. Celui-ci, après un prologue ampoulé présentant les formiciens, les précurseurs des fourmis, nous introduit Hind. Héros de l’histoire, Hind appartient au peuple des Nomades mais vit dans une fourmilière des Halfs. Après une attaque par les Têtes-Rouges où il s’est distingué par sa bravoure, Hind se retrouve en porte-à-faux avec les Mères : les formiciens vivent en ce moment un changement de paradigme, avec l’apparition des individus neutres et la prise du pouvoir par les femelles. Mais Hind ne l’entend pas de cette oreille antenne et fuit avec son meilleur ami. S’ensuit alors une longue et périlleuse odyssée. Au cours de celle-ci, les deux amis sont d’abord faits prisonniers par des formiciens esclavagistes ; au sein Hind trouve toutefois l’amour auprès de Mâh, une autre Nomade. Mus par la nécessité, les deux fondent un nouveau couvain pour redonner vie et grandeur au peuple Nomade. Cette fourmilière passera par hauts et bas, les menaces pouvant être tout aussi intérieures qu’extérieures… comme en la figure de ces « Montagnes-vivantes » que sont les dinosaures.
Dinosaurien, Les Formiciens l’est aussi à sa manière. Se basant sur une documentation abondante listée en fin d’ouvrage, Rienzi préfigure bon nombre d’aspects que l’on retrouvera dans Les Fourmis de Werber, avec un souffle lyrique gentiment désuet. Néanmoins, le roman achoppe sur le caractère exagérément héroïque de son protagoniste et sur le machisme intrinsèque du récit, vaguement camouflé derrière l’apparition du système de détermination sexuelle des fourmis : ici, les femelles sont méchantes et traîtresses ou bien tout juste bonnes à enfanter. Dommage. Il en reste un roman d’aventure à l’intérêt surtout archéologique, exemple parmi d’autres de la fascination exercée par les fourmis et autres insectes eusociaux…
Erwann Perchoc

L’espace entre les guerres
Laurent Genefort - Critic, coll. « Science-Fiction » - septembre 2020 (réédition de Dans la gueule du dragon et d’Une porte sur l’éther - 420 pp. GdF. 22 €)
L’espace entre les guerres est un recueil réunissant deux romans respectivement parus en 1998 et 2000, Dans la gueule du dragon et Une porte sur l’éther. S’inscrivant dans l’univers des Portes de Vangk commun à d’autres textes de l’auteur, ils mettent en scène son seul héros récurrent, Jarid Moray, qui refera une apparition dans Lum’en. Il correspond au trope du médiateur, mi-diplomate, mi-enquêteur, envoyé par le gouvernement (ici diverses corporations interstellaires) quand la situation locale devient explosive (on retrouve le même type de protagoniste chez Serge Lehman ou Adam Troy-Castro, par exemple). Il est la dernière étape avant une intervention militaire : la conciliation coûte moins cher que la guerre !
Dans la gueule du dragon se passe sur une protoplanète qui n’est qu’un océan de lave radioactive où seul un îlot rocheux, le Berg, forme une graine de continent, que la technologie humaine empêche d’être dissous. Jarid y est expédié par la Semeru, la multimondiale titulaire de la concession (qui ne sert que de vitrine technologique pour les actionnaires et les concurrents, son utilité économique étant nulle), afin d’enquêter sur le meurtre des deux précédents gouverneurs, alors que le nouveau entame une violente répression, cherche à imposer des lois d’exception et à exacerber les tensions, tandis que les factions politiques locales (des utopistes aux non-violents en passant par les radicaux meurtriers) se déchirent. Une porte sur l’éther met en scène un cadre encore plus extraordinaire, deux planètes partageant la même orbite, reliées par un Big Dumb Object, l’Axis, d’origine extraterrestre et formé de diamant, ayant pour but de permettre le complexe cycle de vie d’une céréale au potentiel nutritif hors-norme et au goût inimitable. L’une des planètes, aux mains d’une junte militaire nationaliste et intolérante, responsable d’un génocide ayant contraint certains groupes à l’exode dans l’Axis, fait entendre des bruits de bottes pour effacer ses crimes passés en conquérant ce dernier et renégocier à la dure le partage des profits, encaissés en premier lieu par le monde jumeau. Les habitants de la structure, divisés entre des groupes aussi divers que des primitivistes, des posthumains et des fanatiques religieux, vont se retrouver pris au piège. La mission de Moray, pour le compte d’une autre multiplanétaire, la DemeTer, sera de désamorcer la crise.
Genefort est un des rares auteurs français de hard SF, et un maître du planet opera. Dès lors, on ne sera pas étonné s’il brille dans ces deux domaines, les environnements décrits dans les deux romans étant à la fois scientifiquement crédibles, générateurs de tonnes de sense of wonder et peut-être surtout ne se contentant pas d’être des décors, si fascinants soient-ils, mais de solides germes pour les intrigues des romans concernés. On émettra cependant un léger bémol sur des difficultés à visualiser les structures internes de l’Axis, sur un protagoniste en grande partie passif et sur des fins abruptes. On remarquera cependant que mêler une solide hard SF et un fond thématique soft SF faisant la part belle aux problèmes de société, à l’idéologie et aux factions politiques (sans compter l’aspect ethno-SF d’Une porte sur l’éther), traités sans prosélytisme ni lourdeur, n’est pas donné à tout le monde. L’auteur dénonce la répression gouvernementale des mouvements sociaux, le militarisme, les juntes, les génocides et les tentatives d’en effacer les traces de l’histoire, les exodes forcés, le fanatisme religieux, et dans les deux cas, met en avant l’aspiration du peuple à s’appartenir à soi-même.
L’espace entre les guerres est un recueil totalement recommandable pour qui cherche un planet opera hard SF haut de gamme n’oubliant jamais l’humain dans son équation.
Apophis

Tupinilândia
Samir Machado de Machado - Métailié - septembre 2020 (roman inédit traduit du brésilien par Hubert Tézenas - 518 pp. GdF. 23,60 €)
Saviez-vous que le Brésil a eu, lui aussi, un parc d’attraction égal au Dysneyland américain ? Tupinilândia : un gigantesque complexe niché au fin fond de la forêt amazonienne, un lieu de loisir pensé et conçu sur le modèle de son voisin, mais en mieux, bien sûr, et surtout totalement brésilien – les personnages fétiches, les boissons, le matériel. Tout, ou presque, est brésilien. C’est là une ode à la gloire d’un pays, voulue par un homme, le riche et puissant João Amadeus Flynguer. Fils d’un entrepreneur, il a la chance, à dix-huit ans, de rencontrer le grand Walt Disney et son équipe. D’où l’idée du parc – fondé en 1984. Mais lors de la visite préouverture, les choses dégénèrent : une troupe d’hommes armés, déguisés en journalistes, prend possession des lieux, semant le chaos dans cet univers idéalisé.
Tupinilândia pourrait être une dystopie grinçante. D’ailleurs, Orwell est cité plusieurs fois (y compris sur le bandeau de couverture), mais il n’est finalement présent dans ces pages qu’en filigrane. Certes, la société brésilienne décrite, par moments, y ressemble, avec cette dictature surveillant tout et tout le monde. Certes, la société créée dans Tupinilândia peut y faire penser, avec ses règles ubuesques, son langage formaté. Mais tout cela est un arrière-plan. Davantage un décor qu’un élément essentiel. On est plus près du roman d’action, lorgnant vers les films à grand spectacle. D’ailleurs, l’esprit de Michael Crichton et de Steven Spielberg font de rapides apparition à travers les clins d’œil légers à Jurassic Park : quelques dinosaures animés tiennent un petit rôle.
L’ambiance, légère malgré le propos grinçant, est soutenue par des personnages en décalage avec la réalité, à des degrés divers. Simple difficulté à accepter l’âge adulte et le vieillissement pour Artur, le professeur d’archéologie attiré par le mythe de Tupinilândia, rappel de sa jeunesse passée (comme les héros des romans de Fabrice Caro, pleins d’autodérision et d’une certaine mélancolie pour un temps qui s’écoule sans qu’ils s’en aperçoivent vraiment). Volonté de revivre un âge d’or, pour d’autres, nostalgiques d’une dictature plus forte, plus affirmée.
Le ton est volontiers au burlesque. Les scènes de violence sont émaillées de traits d’humour tarantinesque, à base de coups de feu involontaires. Les méchants de l’histoire, sombres abrutis appartenant à un parti nationaliste brésilien, font penser aux nazis des livres et films de série B, légèrement caricaturaux, mais merveilleusement détestables. Dans les scènes d’action, il est difficile de vraiment s’inquiéter pour les personnages tant l’auteur ne semble pas prendre réellement au sérieux cette dimension. Il est là pour distraire son lecteur, pas pour l’effrayer. Et cela fonctionne au mieux.
« Petit » pavé de cinq cents pages, Tupinilândia est un roman érudit où l’on apprend énormément sur le Brésil et son histoire, et où l’auteur se fait un immense plaisir à dézinguer les tenants d’une certaine façon de penser, pleine d’uniformes et d’interdits, encore bien présente dans son pays. Mais c’est avant tout un roman qu’on lit avec délectation et jubilation. Quand bien même, au début, on se demande où nous entraîne l’auteur, on est vite pris dans le tourbillon. Et on se surprend, à la fin, à regarder une carte pour repérer la localisation des ruines de ce parc – des fois qu’il en reste un petit quelque chose…
Raphaël Gaudin