
Suite du cahier critique supplémentaire du Bifrost 96 spécial William Gibson… Depuis les mailles du réseau, on file vers la Lune sous la plume de David Pedreira ou Poul Anderson, on retourne sur Évanégyre et Westeros…

Suite du cahier critique supplémentaire du Bifrost 96 spécial William Gibson… Depuis les mailles du réseau, on file vers la Lune sous la plume de David Pedreira ou Poul Anderson, on retourne sur Évanégyre et Westeros…

Le quatrième de couverture de Gunpowder Moon le recommande « pour tous ceux qui ont aimé Seul sur Mars. » Raté, la comparaison est mauvaise. Vous avez adoréÀ la poursuite d’Octobre rouge ou La Somme de toutes les peurs de Tom Clancy ? Vous allez vous régaler avec Gunpowder Moon. Certes, le livre de David Pedreira est de la science-fiction pure et dure : on parle de mines d’hélium-3 sur la Lune dans un monde où la Terre se relève difficilement d’une catastrophe climatique d’envergure. Mais c’est avant tout une intrigue policière mâtinée d’espionnage politico-commercial comme savaient si bien les écrire Tom Clancy ou John Le Carré.
Sur la Lune, dans une station minière américaine au milieu de la mer de la Sérénité, l’impensable se produit : un homme est assassiné. Tout semble pointer vers les rivaux commerciaux des États-Unis : la Chine et leur base de Nouveau-Beijing 2, mais Caden Dechert, ancien marine qui, lassé par les combats, s’est reconverti dans les activités minières, ne partage pas cet avis. La course contre la montre est lancée pour résoudre ce crime et éviter une nouvelle guerre entre les deux grandes puissances, sur le sol lunaire comme sur Terre.
Écrit par un ancien journaliste, dont il s’agit ici du premier roman, Gunpowder Moon garde les traces d’un style coupé au cordeau, allant à l’essentiel et sachant gérer ses effets pour garder l’attention du lecteur toujours en éveil. En revanche, l’action tarde à se mettre en place : il faut attendre une cinquantaine de pages pour arriver au meurtre proprement dit. Et le narrateur, Caden Dechert, perdu dans ses souvenirs de combattant dans la plaine de la Beeka met un temps fou à se rendre compte de l’évidence : le crime est une affaire interne à la base. Toutefois, même en prenant le temps d’expliquer quelques détails importants dus à l’environnement spatial choisi (le régolithe et les particularités de la poussière lunaire, les points de Lagrange, etc.), David Pedreira ne tombe pas dans le piège fréquent en hard SD et ne noie pas son public sous un monceau de détails. Il signe avec Gunpowder Moon un livre que les amateurs du genre ne lâcheront pas de sitôt. Petit bémol, la lectrice que je suis a trouvé ce roman très testostéroné, même si le poste de responsable de la sécurité échoit à une femme, dotée d’un rôle prééminent. Peut-être parce que l’auteur l’a écrit comme un homme, sauf les rares fois où il insiste assez pataudement sur son genre ? Une maladresse qui ne gâche pas le plaisir pris à parcourir ces pages.
Stéphanie Chaptal
*

« Les Dieux sauvages », série prévue initialement en trois tomes, se transforme, au fil des parutions, en pentalogie. Cinq opus seront donc nécessaires pour dénouer tous les fils d’intrigues et offrir un dénouement satisfaisant aux multiples arcs narratifs ouverts dans les premiers tomes. Wer a détruit le monde parce qu’il ne lui convenait pas, jetant l’opprobre sur une femme et par-delà, sur toutes les femmes. Le clergé, puissant, a instauré des normes patriarcales sévères créant une société dans laquelle les femmes n’ont guère de droits. Mériane avait choisi de vivre en paria, dans les zones instables, contaminées par la magie et dangereuses, pour éviter de se plier aux lois des hommes. Devenue malgré elle Héraut d’un dieu auquel elle ne croit pas, qu’elle n’apprécie pas, elle s’efforce de sauver un monde qui ne mérite peut-être pas de l’être. Elle tente donc d’arrêter la marche sur la Rhovelle de l’implacable Ganner, Prophète d’Aska, entité rivale de Wer, et défend la ville de Loered, protégée par huit murailles concentriques. Quatre sont déjà tombées dans le tome précédent (Le Verrou du Fleuve). Le siège se poursuit, et la situation des assiégés empire. Les réserves de nourriture, touchées par la pourriture, promettent une famine et le morbus, maladie mortelle, fait son apparition. Grâce au savoir de Néhyr, survivante de l’empire d’Asrethia à la longévité mystérieuse, Mériane s’approprie une armure issue des troupes ennemies. Ainsi harnachée, elle insuffle aux défenseurs de la ville l’énergie de se défendre, jour après jour, alors même qu’ils ne peuvent vaincre. L’Église, incapable de soutenir Mériane (une femme ne peut être choisie par Dieu pour incarner sa Parole), s’est prudemment mise en retrait. Seul Maragal, chronète attaché à Loered, l’accompagne de bonne grâce, bien décidé à écrire sa légende. En parallèle, le prince Erwel tente d’obtenir de précieux renforts des provinces voisines réticentes pendant que les jeux d’alliances politiques pour la conquête du trône se poursuivent loin du champ de bataille.
Comme dans les tomes précédents, Lionel Davoust multiplie les points de vue. Le lecteur peut ainsi appréhender sous des angles différents les évènements marquants, anticiper les révélations et comprendre, bien avant les personnages, que les dieux n’en sont pas et que la magie n’est en réalité qu’une technologie ancienne et oubliée, que même les enfants d’Aska peinent à maîtriser. La fureur se retrouve des deux côtés de la ligne de front. Mériane se transforme peu à peu en machine de guerre. Elle lutte pour sauver un peuple tout en tentant de ne pas perdre son humanité sous l’emprise d’une armure aspirant son énergie vitale. Idéaliste, elle se refuse pourtant à sacrifier les plus faibles comme Wer le lui conseille. A contrario, Ganner, dénué de ces préventions, se révèle prêt à tout pour atteindre ses objectifs. La maîtrise narrative de Lionel Davoust impressionne et invite à revenir arpenter le monde d’Évanégyre aux côtés de Mériane.
*

Angleterre, première moitié du XXe siècle. Un homme reprend conscience dans une forêt, sans savoir où il se trouve, ignorant qui il est. Il rejoint le manoir de Blackheath, demeure géorgienne jadis belle mais aujourd’hui délabrée, tout comme l’est la famille qui occupe, marquée par la tragédie. En effet, dix-neuf ans plus tôt, le jeune Thomas a été assassiné par le gardien du domaine, lequel a été pendu. Evelyn, sœur aînée de la victime et tenue pour responsable, s’est exilée à Paris. Afin de marquer son retour, ses parents ont organisé un bal masqué dont les invités sont ceux qui était présents la nuit du crime. Tout cela, le personnage en prend conscience au fil de ses incarnations. Car chaque jour, ou plutôt au fil des répétitions de la même journée, il endosse le corps et la personnalité d’un nouvel hôte, tout en gardant mémoire des informations collectées. Aiden Bishop, son identité d’origine, semble avoir provoqué cette situation. Il lui revient d’élucider la mort d’Evelyn qui, chaque soir, à onze heures, se tire une balle dans le ventre. Mais il s’agit bien d’un assassinat. Aiden dispose de huit vies pour résoudre l’énigme, sinon tout recommencera. Deux autres convives sont aussi piégés, des rivaux car un seul pourra s’échapper du manoir. Qu’en est-il du « médecin de la peste », masqué et vêtu de noir, qui apparaît régulièrement pour informer Aiden ? Et qui est Anna, consciente des incarnations mais qui ne vit qu’une seule journée ?
Le propre du récit policier classique, particulièrement du roman à énigme, est de suivre l’ordre linéaire du temps. La durée extérieure apparaît selon une relation d’ordre irréversible. Les événements sont liés à des moments qui se succèdent, l’un chassant l’autre et sans possibilité d’inverser la série. Le temps ne peut être renversé. Les Sept morts d’Evelyn Hardcastle bouleverse cette succession linéaire, et donc l’ordre causal qui y est attaché. Partant, l’enchaînement des faits dont dépend l’enquête classique s’en trouve affecté. Sans compter que les événements de la journée se répètent dans le désordre. De plus, en soumettant son personnage principal à un véritable carrousel d’incarnations, Stuart Turton remet en cause la fiabilité du narrateur, pourtant indissociable du roman policier classique, à quelques exceptions notables près, telle Le Meurtre de Roger Ackroyd d’Agatha Christie. Ainsi Aiden doit-il faire avec les capacités physiques et mentales de ses différents hôtes, comme lord Cecil Ravencourt, dont l’esprit aiguisé est contrarié par son corps obèse qui l’empêche d’agir…
L’auteur parvient à faire d’une évidence : « Nous ne pouvons pas élucider le meurtre de quelqu’un qui n’est pas mort » (p. 199), l’enjeu véritablement inédit d’un tour de force littéraire. Un roman magistral basé sur le principe de rétroception, d’ordinaire plutôt utilisé en science-fiction (Replay de Ken Grimwood, ou Les Quinze premières vies d’Harry August, de Claire North, par exemple).
Une lecture indispensable, une passerelle entre les genres.
*

Voici déjà le quatrième volet des aventures du Capitaine Futur, le héros des quadras et quinquas, fans de l’anime du studio japonais Toei Animation. Une nouvelle fois traduit par Pierre-Paul Durastanti dans la collection « Pulps » dont il est par ailleurs l’initiateur et l’animateur infatigable, l’ouvrage ne décevra pas les amateurs de rétro-fiction. Rien de neuf en effet sous le soleil des neuf planètes, une fois de plus menacées par un péril insidieux et implacable. Ne lésinons pas sur les superlatifs car ils composent l’ordinaire du sorcier de la science, ce géant roux dont la carrure athlétique n’a d’égale que l’esprit vif et alerte. Meneur né des Futuristes, cette association de héros extraordinaires, à laquelle le gouvernement planétaire fait appel lorsque le désordre se répand parmi les peuples du Système solaire, Curt Newton ne semble animé que par la passion de la connaissance et un sens de la justice surhumain. Cette fois-ci confronté au seigneur de la vie, un mystérieux criminel promettant la jeunesse éternelle aux plus chenus des citoyens, via un élixir aux effets secondaires mortels, il doit prêter une nouvelle fois main forte à la police des planètes, incapable de déjouer la redoutable accoutumance qui se répand dans les neufs mondes. La routine, en somme, dans le plus pur registre du pulp et du comics dont Edmond Hamilton applique les recettes avec cette série née dans les années 1940. L’amateur retrouvera donc la démesure d’une intrigue ne s’embarrassant guère de vraisemblance, lui préférant la patine d’une histoire recyclant des motifs plus anciens, comme ici celui de la fontaine de jouvence. Inutile en effet d’attendre autre chose que le dépaysement suranné d’un space opera trépidant, où une péripétie en chasse une autre, sur fond de ranch saturnien, de forêt de champignons aux spores mortels et de brumes impénétrables hantées par des hommes oiseaux. L’aventure à un saut d’astronef ou de voiture fusée, jalonnée par les saillies d’un humour potache, certes un tantinet répétitif, avec une foi dans le progrès scientifique chevillée au corps. Toute une époque et un état d’esprit différent, celui qui prévalait durant l’âge d’or américain, mais avec une légère touche de nostalgie dont on goûte un aperçu dans la salle des trophées du Capitaine Futur.
Bref, Le Triomphe, quatrième aventure du Capitaine Futur, reste un texte d’une exubérance juvénile, à peine entaché par quelques tournures familières, qui ne cède rien en matière de distraction sans conséquence. Et, ce n’est pas un fan de Starwars qui lui jettera la première pierre.
*
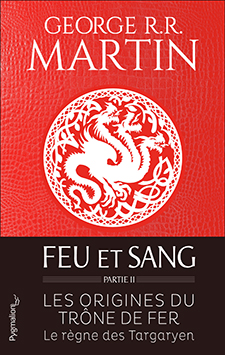
Six mois après la première partie (parce que Pygmalion), nous avons enfin droit à la seconde partie… du premier tome de Feu et sang, soit la chronique des trois siècles durant lesquels la dynastie Targaryen a régné sur Westeros. Rassurez-vous cependant, ou désespérez, le tome 2 ne sortira pas de sitôt, George R.R. Martin ayant affirmé qu’il voulait conclure la saga principale du « Trône de Fer » avant de revenir sur cette « préquelle ». On a donc de la marge.
Reste que cette « seconde partie », même publiée indépendamment, n’est jamais que la deuxième moitié d’un livre unique. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que les mêmes qualités et les mêmes défauts valent pour les deux volumes. Au premier chef, cette seconde partie est, comme la première, le cul entre deux chaises : ni vraiment roman, ni vraiment chronique, une tentative de solution intermédiaire qui ne convainc jamais totalement, les qualités des deux registres étant souvent absorbées par leurs inconvénients respectifs. Formellement, Martin ne s’applique guère, de toute façon, et on ne lira pas Feu et sang pour la joliesse de l’expression.
Mais qu’importe : l’histoire qui nous est narrée est toujours aussi prenante, et le récit est plus dense et plus vif que dans les romans du « Trône de Fer », et tout spécialement les derniers (le rendu des dialogues y est pour beaucoup). Pourtant, elle n’a probablement pas grand-chose d’original, puisant à tour de bras dans l’histoire notamment européenne, avec toujours, de manière très marquée, ce côté « Les Rois Maudits », associant haute et basse politiques, guerre et crime.
Si le premier volume s’était achevé au crépuscule d’un règne long, prospère et (relativement) paisible, la crise est au cœur de celui-ci : une inévitable querelle successorale, où le machisme a sans surprise sa part, précipite les Sept Couronnes dans la guerre civile. Les alliances se font et se défont au gré des caprices et des intérêts particuliers, les monarques éphémères se succèdent à toute vitesse sur le Trône de Fer, et cette « Danse des Dragons », comme on l’appelle, bien ironiquement, marque surtout l’avènement d’une ère maudite, où les glorieuses en même temps que terribles créatures si intimement associées aux Targaryen brillent désormais par leur absence. Au plan symbolique ou très prosaïquement, tout cela donne la conviction d’un lamentable gâchis – comme il se doit. Et quand bien même à l’occasion tel noble seigneur exceptionnellement intègre, tel amiral intrépide multipliant les odyssées maritimes, cherchent à nous rappeler que, dans cet univers sordide, il existe bel et bien des héros. Rassurez-vous, les crapules brutales et cruelles sont bien plus nombreuses…
Un bon point pour cette seconde partie : même sans parvenir tout à fait à donner véritablement le sentiment que l’on lit une chronique, George R.R. Martin use d’un expédient pertinent, et plus marqué que dans le premier tome, qui est la confrontation de sources contradictoires. Car il est bien des manières de conter les événements de la « Danse des Dragons » ; avouons que les récits obscènes du truculent Champignon, fou et sage, auront sans doute la préférence du lecteur… comme du mestre narrateur qui prétend s’en offusquer.
La très brusque « conclusion » du récit laisse cependant un goût amer en bouche – l’histoire, de toute évidence, se poursuit au-delà, jusqu’au Roi Fou et à la révolte de Robert Baratheon… Ce sera pour un autre volume, et clairement pas tout de suite.
Même bilan, en somme, que pour la première partie : un livre formellement perfectible, un projet plus ou moins assuré, mais une histoire qui passionne et enthousiasme, en éclairant par ses thèmes la saga principale. On n’en demandait au fond pas beaucoup plus.
*

Depuis 2010, l’association Imajn’ère met à l’honneur la littérature de genre dans un appel à textes courts et la publication d’une anthologie. Frontières est celle de l’édition 2019. Elle regroupe vingt-cinq textes, chacun accompagné d’une gravure imaginée par un illustrateur. Thématique imposée : les frontières, qu’elles soient physiques ou psychologiques. Libre aux auteurs d’en faire toute une histoire. Voilà pour l’intention. Le résultat est une anthologie très inégale. On y trouve de la fantasy, du polar, de la science-fiction et du fantastique, des auteurs confirmés ou novices. Ce qu’on peine à y trouver, c’est un texte véritablement enthousiasmant. On se concentrera donc sur les plus notables.
Trois autrices ont été distinguées par le jury du concours. Dans « La Légende de Lémuthopia », Samantha Chauderon joue la carte de l’Imaginaire dans la construction de l’enfance en réaction au monde adulte. La guerre menace, un frère et une sœur s’inventent un village utopique peuplé de figurines ; il sera un miroir du réel. Un texte à l’approche assez classique, qui ne recèle malheureusement ni surprise ni grande émotion. Dans « La Passeuse d’âme », Myrtille Bastard imagine un monde où la mort a disparu ; les individus sont condamnés à décrépir sans fin. Taxés de terrorisme par les autorités, certains tentent d’alléger les souffrances en offrant un passage vers l’autre monde. Le résultat s’avère anecdotique, et l’autrice passe à côté de l’énormité de sa proposition. Avec « La Tenancière », Audrey Pleynet nous offre enfin un moment savoureux. On ne saura rien de ce bar où convergent les candidats au départ, à la recherche d’une frontière qui évoque plus une idée qu’une réalité, pas plus que de sa tenancière dont les attraits et le discours changent avec l’interlocuteur. Ce que l’on saura, toutefois, c’est qu’il faut être prêt pour atteindre la frontière. L’autrice met en image la dimension psychologique du récit fantastique, et c’est une réussite.
Côté science-fiction, deux textes sortent du lot : « Tango bleu », de Pierre-Paul Durastanti (oui, le Pierre-Paul Durastanti de Bifrost !), et « Last Frontier » de Laurent Whale. Le second pourrait servir de préquelle au premier. « Tango bleu » est un texte de 1986. Malgré une saveur flower-power un peu surannée, il s’agit d’une vraie SF utopique qui vise un monde meilleur. Le worldbuilding y est de première classe ; la nouvelle est lumineuse. Plus sombre, « Last Frontier » décrit l’agonie de l’ancien monde, la révolte des esclaves, la fin du mensonge, et semble préparer « Tango ».
Pour finir, on lira la nouvelle « Si tous les aliens du monde… » de Jean-Laurent del Socorro. L’auteur inscrit son récit dans l’univers du roman Points chauds (Le Bélial’, 2012) de Laurent Genefort . Des portails s’ouvrent et des aliens arrivent en masse aux portes d’une France gouvernée par une certaine Océane Lacraie. Si l’allégorie politique est amenée avec la délicatesse du marteau-piqueur, le texte propose un récit bien construit avec même un peu d’espoir dedans.
*

Avant Robin Hobb, il y avait Megan Linhdolm.
Sous ce pseudonyme, la californienne va écrire un certain nombre de romans dont Le Peuple des Rennes, Le Dernier Magicien ou encore celui qui nous intéresse aujourd’hui, Le Dieu dans l’Ombre.
Publié en 1991, l’ouvrage bénéficie de l’attention des éditions ActuSFOn s’interrogera toutefois sur la pertinence de cette initiative éditorial un brin putassière, le présent bouquin étant toujours disponible au Livre de Poche, au prix de 7,70 euros… No comment. [NdRC], qui le rééditent en grand format sous une magnifique couverture signée Lucian Stanculescu.
Loin des aventures de FitzChevalerie, le récit nous emmène sur les traces d’Evelyn, une jeune femme mariée à Tom Potter dont la famille possède une entreprise agricole florissante à Tacoma, une petite ville de l’État de Washington. Avec leurs fils, Teddy, le couple décide de quitter Fairbanks pour Tacoma, justement, et Evelyn doit dès lors composer avec une belle-famille n’acceptant pas cette bête sauvage qu’a ramené leur garçon.
Pour s’évader de cet environnement toxique, Evelyn peut compter sur un vieil ami surgit des tréfonds de son enfance : Pan, un faune qu’elle semble être la seule à pouvoir approcher.
Entre l’amour sauvage et naturel de Pan et le mépris d’une famille qui veut la façonner à sa guise, Evelyn va devoir choisir sa voie.
Véritable page-turner grâce à sa langue souple et légère, Le Dieu dans l’Ombre raconte l’histoire d’une jeune fille tiraillée entre son identité profonde, plus proche de la nature sauvage et farouchement indépendante, et une vie sociale banale souvent asphyxiante. Pendant longtemps, le roman de Megan Lindholm laisse le fantastique en sourdine et concentre ses efforts sur Evelyn, narratrice et héroïne, pour brosser un portrait féminin et féministe où le passage à l’âge adulte devient une malédiction. À la fois critique d’une misogynie ordinaire mais aussi plongée dans un retour à la terre et à la nature à la Thoreau, Le Dieu dans l’Ombre offre au lecteur une histoire touchante par la fragilité et la détermination de son héroïne prise au piège du quotidien et des conventions sociales qui l’entourent. Peu à peu, les malheurs d’Evelyn se teintent de fantastique par l’apparition de plus en plus fréquente de Pan, ancien Dieu de la forêt tombé éperdument amoureuse d’elle, et le récit oppose alors deux modes de vies, le nôtre et celui des bêtes, sans donner de réels gagnants en vérité, constatant l’échec inéluctable d’Evelyn à s’intégrer dans un monde qui ne pourra jamais totalement être sien. C’est aussi l’occasion de retrouver le sous-texte sur le couple que file l’autrice depuis le début de son récit, mais en inversant les rôles, mettant en lumière le jeu pervers qui se déroule entre deux êtres de chairs, jeux de pouvoirs et de séduction qui s’effrite avec le temps. Même si Le Dieu dans l’Ombre a parfois tendance à s’épancher plus que de raison sur les drames et états d’âmes d’Evelyn, l’ouvrage touche par la finesse psychologique de son héroïne et la sincérité du récit.
Après un virage à cent quatre-vingts degrés où le fantastique domine et rencontre le nature-writing, Megan Lindholm s’interroge sur notre capacité réelle à revenir à la terre, questionnant notre résistance et nos capacités humaines. Plus rude mais aussi plus bestial, cette dernière offrande à Pan renferme une note mélancolique où le bonheur passé se fane à l’ombre du réel. Au bout du chemin, un voyage initiatique où la féminité s’affirme et où la nature reprend ses droits, dans tous les sens du terme. Un très bon roman.
*

Avec la parution du roman Le Prince-Marchand en 2016 (critique in Bifrost 84), les éditions du Bélial’ ont entamé, sous la houlette de Jean-Daniel Brèque, traducteur et maître d’ouvrage pour l’occasion, la publication intégrale des textes ressortissant à «La Ligue polesotechnique », première époque de « La Civilisation Technique », l’un des cycles majeurs de Poul Anderson. Le temps passant très vite, le quatrième tome est désormais disponible. L’amateur y trouvera une traduction très révisée du roman Le Monde de Satan, et un inédit sous la forme d’une novelette intitulée « L’Étoile-Guide ». Pour qui serait passé au travers des trois précédents volumes, peut-être n’est-il pas inutile de procéder à un bref rappel. Dans le futur, le Commonwealth englobe une multitude de planètes et de colonies habitées par des humains et des extraterrestres, rebaptisés sophontes. Mais la véritable puissance reste l’association des libres marchands, la fameuse Hanse galactique, dont les affaires s’autorégulent dans le respect des principes de l’intérêt bien compris, de la concurrence libre et non faussée, contribuant ainsi à la stabilité de la civilisation technique. Si Le Prince-Marchand avait été l’occasion de découvrir Nicholas van Rijn, le fondateur de la Compagnie Solaire des Épices & Liqueurs, personnage fantasque, jouisseur et roublard au langage fleuri, les tomes suivants nous ont permis, au fil d’aventures périlleuses et un tantinet répétitives, de lier connaissance avec d’autres collaborateurs de la compagnie, en particulier le trio de pionniers marchands formés par David Falkayn, Chee Lan et Adzel. Un aristocrate beau gosse et intelligent, parfait cliché pour belle-mère, une Cynthienne menue et d’apparence faussement adorable, à la langue bien affûtée et au caractère caustique, et enfin un Wodenite, sophonte à l’impressionnante envergure de centaure mâtiné de saurien ne laissant pas deviner sa nature débonnaire et non-violente. Bref, trois mousquetaires au service d’un quatrième tenant plus de Falstaff que de d’Artagnan. Si Le Monde de Satan permet de renouer avec cette complicité, voire cette amitié indéfectible, forgée au fil des missions accomplies pour le compte de van Rijn, le présent roman relève surtout d’un changement dans la continuité. Aucune allusion politique malvenue dans cette assertion, même si le regard de Poul Anderson sur la Ligue polesotechnique se fait progressivement plus désabusé, surtout dans le texte « L’Étoile-Guide ». Certes, les péripéties vécues par van Rijn et consorts ne brillent toujours pas par leur originalité. On reste dans une veine populaire, où l’humour, le rythme soutenu et les stéréotypes confèrent au récit un caractère divertissant indéniable, sans pour autant renoncer complètement à la science, notamment dans des passages flirtant avec une hard SF au didactisme un tantinet agaçant. Quant au changement mentionné plus haut, d’abord sous-jacent, il perce de plus en plus au travers d’Adzel, sans doute le plus sensible à l’égoïsme bien compris de la Ligue polesotechnique, puis de Coya, la petite-fille de van Rijn, au point de briser la belle entente qui prévalait entre les associés dans Le Monde de Satan. Si le roman s’achève en effet sur une note joyeuse, celle-ci est sévèrement tempérée à la lecture de « L’Étoile-Guide ». Le cabotinage du prince-marchand et l’esprit d’entreprise cèdent alors la place à l’amertume et au dégoût.
Mésestimé lors de sa première parution en France, comme en témoigne la critique assassine de Jean-Pierre Andrevon dans Fiction, Le Monde de Satan apparaît pourtant comme l’apogée des aventures de van Rijn, Falkayn, Chee Lan et Adzel. Mais, l’apogée comme l’orgueil précèdent toujours la chute, déjà annoncée par la novelette «L’Étoile-Guide ». En cela, le quatrième tome de « La Hanse galactique » apparaît comme un ouvrage de transition, entre optimisme et fatalisme, bouffonnerie et drame, John W. Campbell et Paul Valéry. Le laissez-affairisme et la ploutocratie étant désormais au cœur du Commonwealth, les temps sont dorénavant ouverts pour Le Crépuscule de la Hanse, ultime tome du cycle. Ne cachons pas notre impatience.