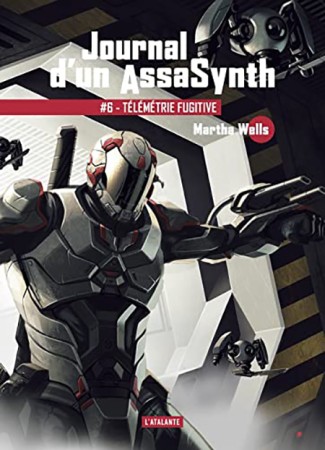Bienvenue au Paradis
Alexis Legayet – Æthelidès, coll. « Freaks » - septembre 2020 (roman inédit, 192 pp. Poche. 18 euros)
On pourra penser que 18 euros pour un livre aux dimensions et à la pagination d’un ancien Fleuve Noir, période « Fusées », est un prix élevé mais il y a bien longtemps que je n’ai pas trouvé mon argent aussi bien placé.
Publié par les soins du petit éditeur lyonnais Æthelidès, Bienvenue Au Paradis semble être passé sous la plupart des radars et Alexis Legayet, philosophe de profession – un vrai, un bon, pas une caricature à la BHL – gagnerait à être bien mieux connu. J’ai découvert l’ouvrage par un pur hasard, en cherchant ce qui pouvait bien s’écrire sur la mode végane.
En 2145, le monde a bien changé. Le véganisme a partout triomphé. Non seulement plus aucun animal n’est mangé, ni tué, ni maltraité, mais encore sont-ils considérés comme des individus à part entière. Il n’y a plus aucune différence de jure entre animaux et humains. Mieux, les animaux carnassiers ont été génétiquement modifiés afin qu’ils n’en dévorent plus d’autres. Ainsi, le lion et l’agneau dorment-ils ensembles comme il en aurait été au Jardin d’Eden avant la chute. Dans ce monde pacifié, sans plus ni guerre ni crime, la jeunesse s’ennuie et s’est donc découvert une nouvelle cause à défendre : les végétaux. Ils seraient des créatures tout aussi sensibles et vivantes que les animaux et devraient donc avoir les mêmes droits… L’humanité, fidèle à elle-même, en serait toujours à se livrer à sa passion pour le génocide. Et le cri d’agonie des carottes assassinées retentirait à la face du monde dans un silence assourdissant…
Dans ce monde, Dan Basquet est tombé amoureux fou du fessier d’Alice Roux, activiste du Flower Power auquel il adhère à dessein de la séduire, ce qui le conduira bien au-delà de tout ce qu’il aurait pu imaginer. Car, à extrémiste, extrémiste et demi. En dépit de la photosynthèse, le struggle for life n’est nullement étranger au règne végétal. Certains ont donc une vision plus radicale encore pour en finir avec l’hétérotrophie et s’ouvrir enfin à une vie affranchie de toute mort. Le Flower Power, lui, n’autorise plus pour se nourrir que les fruits tombés – vus comme morts, ce qui serait vrai des feuilles ne l’est pas des fruits qui sont en quelque sorte les « fœtus » des plantes, des processus métaboliques en cours. Les consommer serait donc une forme d’avortement. Legayet fait l’impasse sur cette idée mais ça ne nuit en rien à son propos.
Le roman d’Alexis Legayet propose deux niveaux de lecture. Au premier, c’est un roman de science-fiction, sous-tendu d’un humour jamais gratuit, assez simple tant dans son intrigue que ses péripéties qui le rendent accessible à tous. Au second, c’est un conte philosophique voltairien qui, là aussi, est à la portée de tous. Il pousse, à travers un raisonnement par l’absurde dont Swift s’était fait une spécialité, la morale dans ses plus ultimes retranchements. Legayet éclaire d’une façon différente la collusion qui s’établit entre le transhumanisme et la branche végane de la nébuleuse politiquement correcte tout comme Jocelyne Porcher l’a fait à propos de la viande cellulaire (nota)« Viande cellulaire : le choix du pire ». In Front Populaire N° 5 été 2021. Tous les êtres vivants sont des structures dissipatives chères au Nobel de chimie Ilya Prigogine, c’est-à-dire des structures qui se maintiennent loin de l’équilibre en consommant une énergie extrinsèque dont l’hétérotrophie est une forme, la photosynthèse une autre et Nature 2.0 une troisième. Bienvenue au Paradis, sans avoir l’âpreté technique de Greg Egan ou Ted Chiang s’apparente à ces auteurs et ouvre sur une thématique qu’ils ont abordé. Il s’agit de pousser jusqu’au bout le posthumanisme, comme dans Diaspora. Les xénobiologistes envisagent que soit possible des formes de vie basées sur le silicium mais, et c’est ici le cas, n’est-il pas envisageable que la vie silicée soit issue, produite, par la vie carbonée, comme une saltation vers un niveau de moindre accroissement de l’entropie. Enfin, dans l’épilogue, Alexis Legayet résout d’une façon fort élégante le paradoxe de Fermi formulé à partir de l’équation de Drake.
Bienvenue au Paradis est le livre le plus intéressant qu’il m’ait été donné à lire depuis Corpus Delicti : Un Procès de l’Allemande Juli Zeh (Actes Sud). S’il est d’une rare profondeur, il offre en outre l’avantage d’une très grande facilité d’accès et ne manque pas d’une certaine drôlerie. Il est à la portée de tout un chacun et permet à tous de nourrir ses réflexions. Éminemment spéculatif, il place, sans élitisme aucun, la littérature à son maximum. A moins que vous ne recherchiez qu’un pur divertissement, si vous ne deviez lire qu’un seul livre contemporain, celui-ci est au tout premier rang des choix possibles.
Jean-Pierre Lion

Le Silence selon Manon
Benjamin Fogel - Rivages, coll. « Noir » - avril 2021 (roman inédit - 280 pp. GdF. 20 euros)
À la croisée du roman noir et de l’anticipation, Le Silence selon Manon extrapole sur des problématiques sociétales du présent pour en tirer une mise en garde salutaire sur certaines déviances déjà solidement inscrites dans notre paysage numérique. Pouvant se lire comme un prequel de son précédent roman (La Transparence selon Irina in Bifrost n° 96), Le Silence selon Manon nous interpelle dans nos certitudes, nous sortant de notre zone de confort afin de nous pousser à la réflexion sur la pratique du cyber-harcèlement et sur les limites nécessaires à la liberté d’expression. Mais, où placer le curseur ? Qui doit en décider ? Au nom de quoi ? À toute ces questions, les lecteurs de La Transparence selon Irina fourbissent leurs arguments. Benjamin Fogel n’apporte pas ici de réponse définitive, préférant adopter les points de vue irréconciliables des uns et des autres. Il oppose paroles et actes des militants incels, enferrés dans la certitude d’être victimes d’un grand complot féministe les poussant au célibat forcé ou à la veuve poignet, à ceux des activistes neo straight-edge, prônant de leur côté des valeurs humanistes et l’inclusion à tous les niveaux. Des combats bien de notre temps que Benjamin Fogel décale légèrement dans l’avenir, en 2025-2027. L’anticipation reste donc superficielle, l’aspect techno-scientifique et philosophique se cantonnant au second plan d’une intrigue plus intéressée par les effets toxiques des réseaux sociaux, mais aussi par leur détournement au nom d’une volonté totale de transparence, jugée plus conforme à un vivre-ensemble sous contrôle. Le présent roman est aussi plus abordable pour un néophyte du Web 2.0, gagnant en tension dramatique ce qu’il perd en didactisme. On ne s’en plaindra pas, bien au contraire, Le Silence selon Manon apparaît même moins maladroit sur ce point, éludant à la fois l’écueil d’un militantisme réducteur et la pesanteur du formalisme documentaire. Au travers du chassé-croisé des personnages, on sent bien que l’intérêt de Benjamin Fogel se porte sur l’être humain et sur sa faculté à se nourrir d’illusions. Il se focalise également sur son incapacité à tirer parti du meilleur de la technologie, usant de ses angles morts pour laisser se déchaîner la haine de l’autre. Les personnages ne sont pas ainsi de simples épures, au service d’un message pamphlétaire. Bien au contraire, ils sont pourvus d’une psychologie travaillée, loin du monolithisme stéréotypé d’un discours politique. En proie au dilemme et à la fragilité de leurs convictions ; esclaves de leurs pulsions et biais cognitifs, ils se cherchent des raisons pour se convaincre qu’ils sont les détenteurs d’une vérité unique et intangible, nous faisant saisir par la même occasion toute la complexité et la noirceur de l’esprit humain.
Avec Le Silence de Manon, Benjamin Fogel confirme donc toutes les promesses esquissées dans son précédent roman, proposant même une anticipation sociale rusée et une investigation implacable sur nos faiblesses humaines. Il redonne enfin ses lettres de noblesse à un genre mal aimé, le roman engagé.
Laurent Leleu

Souvenirs de Marnie
Joan G. Robinson - Monsieur Toussaint Louverture, coll. « Monsieur Toussaint Laventure » - avril 2021 - (roman inédit traduit de l’anglais par Patricia Barbe-Girault - 256 pp. Semi-poche. 16,50 euros)
La jeune Anna a eu un début de vie difficile : orpheline de père et de mère, elle perd également sa grand-mère et se retrouve adoptée par les Preston, famille honnête et sincèrement attachée à cette jeune fille « au visage de marbre » et dont elle ne sait pas trop comment se faire aimer. Alors, pour la faire changer d’air et l’aider à grandir un peu, on l’envoie chez les Pegg et leur cottage, sur la côte. Les Pegg s’en occupent avec attention tout en lui laissant une liberté tranquille dans ce petit village du littoral. Anna peine à se faire des amis de son âge mais au cours d’une de ses promenades solitaires, son attention est attirée par une villa en bord de mer, qui semble lui faire signe. Et de fait, un jour, elle aperçoit fugacement une jeune fille à l’une des fenêtres. Celle-ci réapparaîtra plus tard, devant Anna, et dira s’appeler Marnie. Mais Marnie est mystérieuse et a un réel talent pour apparaître et disparaître sans crier gare. Les jeunes filles s’attachent l’une à l’autre et Anna, au gré des rencontres nocturnes, pénètre le monde familier et doucement suranné de son amie…
Voici pour la première fois traduit en français, par Patricia Barbe-Girault, le fameux roman de Joan G. Robinson, When Marnie was there, paru en 1967. Si on connaît cette œuvre par la délicate adaptation en anime du maître japonais Hiromasa Yonebayashi en 2014, on ne peut que se réjouir d’avoir enfin dans les mains, grâce au subtil travail d’édition de Monsieur Toussaint Louverture, ce standard de ce qu’on appelle un peu vite littérature jeunesse. Littérature jeunesse pour son sujet bien sûr, puisqu’il s’agit du monde de l’enfance, de ses secrets, de ses amitiés et de leur exclusivité, de ses difficultés dans les relations aux autres, pairs et adultes, pour sa tonalité doucement fantastique – peu originale certes mais lumineuse –, mais aussi pour sa simplicité de lecture, car ce roman qui avance l’air de rien se lit avec aisance et se dénoue en rassasiant le lecteur du sens qui se cachait dans la trame du texte depuis le début.
Bien évidemment, ce qu’on adore, c’est qu’on nous parle avec cette délicieuse simplicité de sujets graves. L’attachement à l’autre, la solitude de la fin de l’enfance, ce passage qui s’ouvre devant soi vers l’adolescence et qu’on doit franchir seul, comme on naît et comme on meurt (certaines langues ont une voix moyenne, entre l’actif et le passif, spécialement pour ces actions-là), une perte de soi mais aussi de celui qui est proche. Mais en consolation, ce qu’on trouve dans ces pages, c’est la beauté des rencontres, le temps qu’elles prennent à nous entrelacer au monde par des fils insoupçonnés qu’elles tissent à travers l’espace et le temps, et la figure de nous-mêmes qu’elles dessinent et qu’on découvrira un jour, car le roman nous le garantit : cette vérité de soi, nous la connaîtrons, et cette certitude est sans aucun doute le plus sûr baume dont nous avons besoin, à tout âge.
Arnaud Laimé

Les Dents de lait
Helene Bukowski – éditions Gallmeister - août 2021 (roman inédit traduit de l‘allemand par Sarah Raquillet et Elisa Crabeil - 272 pp. GdF. 22,40 euros)
Skalde et sa mère Edith vivent dans une maison un peu à l’écart du village, à l’orée de la forêt, sur une île coupée du monde. Les habitants ont décidé, plusieurs décennies auparavant, de briser le pont qui les reliait au continent pour se protéger du chaos du monde, et en premier lieu de celui de la nature : entre brume et sécheresse perpétuelle, il est difficile de survivre. Les légumes poussent mal et les biens de première nécessité comme l’essence sont rares. Un troc s’est mis en place. Skalde et sa mère font du purin d’orties et élèvent quelques lapins, pour leur viande et leur fourrure, Edith en fait des manteaux.
La vie précaire des deux femmes est bousculée le jour où Skalde rencontre dans la clairière, non loin de chez elle, une jeune fille aux cheveux rouges, signe de radicale altérité dans cette île où personne n’en a de telle couleur. Elle décide de la ramener chez elle, même si elle sait que les iliens vont la prendre pour un changelin et vouloir s’en débarrasser par tous les moyens. L’équilibre fragile de la relation mère-fille est également sujet à tensions. Jusqu’où les emmènera ce choix d’accueillir une étrangère ?
Helene Bukowski nous livre un récit qui oscille entre la nouvelle et la fable, et mâtiné de prose poétique. On sort du récit comme on y est entré et comme on y demeure : sans trop savoir les raisons de ce qui s’y passe, on suit le fil d’une narration ténue et bien menée, mais sans véritable dénouement explicatif, ce qui nous laisse à songer sur tout le reste : la peur de l’autre, l’angoisse mystérieuse, la maternité, un monde qui se défait… Dans une ligne assez similaire à Au Nord du monde, de Marcel Theroux, la dystopie d’Helene Bukowski met en scène l’oppression qui s’exerce sur les plus fragiles, femmes, enfants, étrangers et pose la question du repli sur soi et de la pertinence d’une solution à l’échelle locale dans un monde qui s’écroule. Quand Theroux fait le choix d’un roman mêlant le récit d’initiation à l’enquête sociologique, l’autrice préfère la forme brève de chapitres courts, l’insertion, sous forme de fragments en prose poétique, du flux de conscience de Skalde. L’effet est réussi : on se cherche, dans l’urgence, et même si on ne voit rien de l’autre côté du mur de brouillard, du fleuve ou des conventions sociales, un acte unique de bravoure nous le fait traverser. C’est, en littérature, le moyen de poser chacun de nous devant les choix à faire prochainement.
Arnaud Laimé

Klara et le soleil
Kazuo Ishiguro - Gallimard, coll. « Du monde entier » - août 2021 (roman inédit, traduit de l’anglais par Anne Rabinovich - 385 pp. GdF. 22 euros)
Attendu en français depuis sa parution en anglais au printemps dernier, le nouveau roman du Nobel de Littérature, à qui nous devons déjà Auprès de moi toujours (cf. Bifrost 44), nous propose une nouvelle incursion science-fictionnelle. Nous faisons ici connaissance de Klara, « Amie Artificielle », androïde à taille d’enfant, dont les différentes générations (logicielles et matérielles) sont conçues afin de tenir compagnie aux plus jeunes, et plus fortunés.
Klara, dont nous entrons directement dans les pensées les plus fines, les émotions, inquiétudes et incompréhensions, dépend d’une part de sa place dans la boutique où elle est mise en vente – si possible au soleil pour être pleinement chargée – et de l’hypothétique enfant qui souhaitera la prendre comme compagne de vie.
Dès l’entrée en matière, la grande sensibilité, la poétique et la justesse de l’écriture marquent et donnent envie de poursuivre. Du monde où évolue Klara, nous n’avons que sa connaissance limitée et ses observations qui lui permettent de s’améliorer, de devenir une « meilleure AA » pour l’enfant attendu… qui finira par la trouver : Josie. Dès l’achat – l’adoption –, le comportement de la mère de Josie mettra la puce à l’oreille aux lectrices et lecteurs de SF aguerris. Et les indices puis révélations sur la famille de Josie, ses lourds secrets et l’importance que Klara pourrait avoir dans leur système, ne cesseront de se multiplier dans un flou entretenu par une astuce simple : la narration passe par ce que voit et comprend Klara, avec les capacités liées à son intelligence, celle-ci devenant rapidement obsolète – source d’inquiétude pour l’androïde. Par ailleurs, Klara, organisme complexe dépendant de l’énergie solaire, se réfèrera au Soleil en des termes spirituels, superstitieux ou en de touchants actes de foi… étoffant un peu plus son individualité, au fur et à mesure qu’elle la questionne.
À chaque instant, la plume de Kazuo Ishiguro fait mouche, toute en clarté, émotion et précision… mais le roman semblera s’essouffler si l’on attend de lui plus de précision sur le monde où il prend place, ou sur les personnages qui entourent Klara et Josie. Cette douce mélancolie nimbe ce récit lumineux jusqu’au bout ; la lecture en reste agréable, même si l’on manque souvent de s’y ennuyer – cela dépendra sans nul doute de chaque lectrice ou lecteur.
De nombreux concepts lié aux questions de l’IA sont abordés, sans surprendre ni décevoir, mais servis par une écriture d’une grande qualité. Il serait dommage de se priver de cette expérience. On peut recommander ce roman, pour redécouvrir ou faire découvrir ce qu’une SF légèrement décalée dans ses mécanismes a à nous offrir.
Éva Sinanian

Notre part de nuit
Mariana Enriquez - Éditions du sous-sol – septembre 2021 (roman inédit traduit de l’espagnol (Argentine) par Anna Plantagenet - 768 pp. GdF. 25 euros)
Cela commence comme un road movie argentin : le père, Juan, emmène son très jeune fils Gaspar sur la route, ils fuient, mais quoi ? Ils ont une idée d’où s’abriter mais y arriveront-ils ? La mère, Rosario, est morte en de violentes conditions. Juan est malade du cœur depuis sa plus jeune enfance et son état de santé se détériore. Son fils commence à voir des morts. Il tient son don de son père, medium d’une mystérieuse organisation qui voue un culte à l’Obscurité, puissance maléfique et cruelle, avide de chair humaine. Juan est épuisé par l’exercice de ses talents de medium, et il veut soustraire son fils au destin que lui réserve le don qu’il lui a transmis. Mais comment s’y prendre ? Gaspar grandit, son père décline, et il faudra bien des excursus et des retours en arrière, au XIXe siècle pour comprendre comment ces deux personnages se sont trouvés dans cette situation, avant que le jeune homme ne scelle son sort.
Bien que le volume soit très épais, difficile d’en dire plus sur l’intrigue sans la déflorer, mais l’ambition littéraire est grande pour Marian Enriquez, après un recueil de nouvelles très remarqué, Ce que nous avons perdu dans le feu (traduit en français par les éditions du Sous-Sol et réédité en format poche cette année aux éditions Points). Notre part de nuit est un livre somme, où Histoire et fiction se mêlent au sein d’un dispositif narratif soigné qui fait voyager le lecteur à travers les XIXe et XXe siècles, et certains de leurs épisodes historiques les plus cruels, que ce soit en Argentine, lors de sa dictature et de ses révolutions, dans le Londres des années 70 ou encore au Nigeria de l'époque coloniale, tout en multipliant les points de vue. Ce sont non seulement les horreurs de la guerre mais aussi l’histoire des luttes contre les oppressions sociales qui sont convoquées : lutte des femmes contre le patriarcat, des enfants contre leurs agresseurs, des gays contre une société qui les maltraite. C’est, pour ainsi dire, une sorte d’étiologie du mal dans notre monde à laquelle se livre Mariana Enriquez, et les déchaînements présentés dans les scènes fantastiques résonnent familièrement avec les excès de rage des temps modernes. L’imagination est vive, la précision souvent chirurgicale, mais sans complaisance qui alourdirait le propos, et c’est ce qui peut faire la différence avec L’Échiquier du mal de Dan Simmons, par exemple. Par le talent, on pense bien sûr à Stephen King, H. P. Lovecraft, Richard Matheson, mais aussi à Borges, ou encore à Saer. Le substrat ethnologique sur la sorcellerie et la magie noire en Amérique latine mais aussi en Europe contribue à donner au livre son exactitude romanesque. Le malaise qui hante les personnages sans relâche rappelle bien évidemment les grands romans noirs, et il se mâtine d’une relation père-fils profonde et subtilement composée, tissée de malentendus, d’intentions indicibles, d’un véritable amour partagé. Notre part de nuit veut embrasser exactement la complexité de la vie et plus particulièrement de l’histoire récente de notre monde, sans renoncer aux puissances de la fiction fantastique. Et on finit par palper du réel sous l’étoffe effrayante : c’est l’essence de l’horreur que nous distille là Mariana Enriquez.
Arnaud Laimé
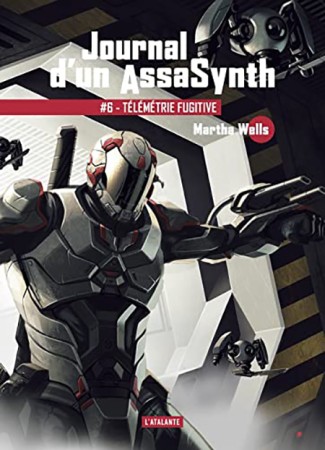
Télémétrie Fugitive (Journal d’un AssaSynth T.6)
Martha Wells - L’Atalante, coll. « La Dentelle du Cygne » - août 2021 (court roman inédit traduit de l’anglais [US] par Mathilde Montier - 140 pp. semi-poche – 12,90 euros)
Faut-il encore le présenter ? SecUnit de renommée intergalactique, sériephile averti et râleur de premier ordre, notre AssaSynth nous revient pour un sixième tome qui retourne aux sources de la série imaginée par Martha Wells.
Oublié le format roman qui lui faisait traîner la patte ; retour ici sur la distance novella, avec une aventure trépidante où se mêlent enquête, action et remarques acerbes de la part de notre androïde préféré.
Dans Télémétrie fugitive, AssaSynth tente de trouver sa place sur la station Préservation qui l’accueille depuis sa dernière mission. Devenu le protecteur du Dr Mensah, le SecUnit doit composer avec l’hostilité larvée de la sécurité et des autres citoyens qui ne voient souvent en lui qu’un danger ambulant prêt à les massacrer sur un coup de tête. Comme quoi, les clichés véhiculés par les séries ont la peau dure ! Alors que l’on négocie sec pour trouver un statut et établir des règles autour de ce qu’AssaSynth a le droit le faire ou pas, un cadavre est retrouvé sur Preservation. Et autant le dire franchement, Preservation n’a pas l’habitude des meurtres. Ce qui n’est pas le cas d’AssaSynth, qui passe le plus clair de son existence à regarder les humains s’entretuer pour un oui ou pour un non, voire parfois juste parce qu’ils en ont l’opportunité. Devant la complexité du cas et la possibilité d’une infiltration des réseaux de sécurité, on accepte l’aide de la SecUnit convaincue que GrayCrisis n’en finira décidément jamais de le pourchasser.
Télémétrie fugitive retrouve vite les marques de la série, pose ses easter eggs pour les fans avec moult références aux opus passés et développe une intrigue en huit-clos spatial où l’action recule au profit de l’enquête. Cette fois, AssaSynth se fait plus détective que combattant, mais conserve l’entièreté de son humour ravageur et de son cynisme envers les humains (et les bots stupides). Martha Wells en profite pour développer encore davantage le background de son univers, mettant en reliefs les sales petits secrets de certains exploitant extra-corporatistes tout en questionnant la nouvelle place occupée par AssaSynth dans une société qui semble terrifier par le concept qui l’anime. En sous-main, il est ici question d’intégration et de tolérance, de passer outre les clichés et de parvenir – enfin – à se faire confiance.
En délaissant les longueurs du précédent volume et en revenant à l’aspect feuilletonesque qui faisait tout le charme des précédents volets, Télémétrie fugitive redevient fun, captivant et attachant, ajoutant une nouvelle pierre à l’édifice légendaire de l’un des androïdes les plus drôles et les plus sympathiques de la SF moderne. Un vrai plaisir de lecture, qui séduira les amateurs et devraient convaincre les autres de s’y mettre enfin !
Nicolas Winter

Ursula K. Le Guin - de l’autre côté des mots
Sous la direction de David Meulemans - ActuSF - août 2021 (recueil
d’articles - 464 pp. GdF. 30 euros)
Voici l’ouvrage critique collectif tant attendu sur Ursula K. Le Guin,
celui qui permettra de découvrir l’œuvre plurielle, chatoyante, d’une des
plus grandes écrivaines de langue anglaise de ces dernières décennies.
Aussi bien l’ignorant que l’amateur sauront faire leur miel des diverses
analyses, réflexions, archives disponibles dans cet ouvrage. Saluons donc
l’initiative, qui s’imposait d’autant plus qu’aucune monographie n’aurait
pu parcourir avec autant de précisions et de riches détails la variété de
cette œuvre hors normes, et d’autant plus qu’il s’agit du fruit d’un
financement collaboratif très avisé.
Commençons tout d’abord par l’objet-livre, qui est en lui-même une réussite
: les éditions ActuSF, sous la direction de David Meulemans (bien connu des
Bifrostiens pour sa direction des éditions Aux Forges de Vulcain), nous
livrent un splendide ouvrage broché qui s’ouvre sur un portrait illustré de
l’auteur, par Zariel, qui intervient ensuite très régulièrement au sein du
volume : chaque article s’ouvre sur un portrait dessiné de son auteur et se
clôt sur un nouveau portrait de Le Guin, dont les multiples visages se
succèdent au fil des lectures qu’on en fait. C’était sans aucun doute la
meilleure façon d’incarner l’aspect protéiforme de son écriture, et cette
richesse graphique entre bien en consonance avec les multiples jaquettes de
ses ouvrages qui jalonnent la lecture. Un effort tout particulier a été
fait sur les polices de titre également qui contribuent à construire
l’originalité du livre.
À l’intérieur, 31 interventions différentes se succèdent, sobrement
numérotées les unes à la suite des autres, sans découpage en sections ou
sous-sections plus précis. Les intervenants sont de tous ordres (artistes,
écrivains, scénaristes, traducteurs, universitaires de disciplines fort
diverses) et leurs communications de longueurs très variées : cette
diversité des voix, des formations, des parcours. On trouve également
quantité de citations et d’extraits d’entretien avec Ursula K. Le Guin, et
des archives comme la préface du Livre d’or que Gérard
Klein lui a consacré. C’est peut-être une limite de l’ouvrage – si on
devait en trouver une – car les titres ne sont pas toujours suffisamment
explicites pour que le lecteur puisse y trouver rapidement de quoi nourrir
ses goûts et sa fantaisie. Néanmoins, un chapeau introductif au début de
chaque article permet d’en présenter rapidement l’enjeu. Et de grands blocs
d’études se détachent au fur et à mesure qu’on progresse linéairement,
après une biographie synthétique : l’utopie, les grands cycles de Le Guin,
la réception de l’œuvre, le féminisme et son évolution au fil des années,
la puissance poétique du langage, la poésie tout court, les enjeux de la
traduction (dans les récits, de soi et des autres et donc le rôle de
passeur non négligeable de l’écrivaine elle-même), la place des autres arts
dont la musique et le cinéma avec, les grandes sources littéraires
(antiques et contemporaines), les influences spirituelles diverses (dont le
Tao) et puis pour finir une série d’interventions plus brèves parcourant à
sauts et gambades des thèmes divers.
Pour conclure, disons tout simplement qu’il s’agit d’un très beau livre,
qui saura satisfaire le plaisir et la curiosité des lecteurs, et jeter les
bases de nombreuses études à venir.
Arnaud Laimé

La pêche au petit brochet
Juhani Karila - La Peuplade, coll. « Fictions du Nord » - septembre 2021 (roman inédit traduit du finnois par Claire Saint-Germain - 440 pp. GdF. 21 euros)
Une récente étude du World Happiness Report (oui, pareille institution existe…) révélait que la Finlande serait le pays le plus heureux du monde. Voilà qui suscitera, peut-être, des vocations d’émigration chez celles et ceux qui sont en quête d’un havre de bonheur en ce monde devenu généralement anxiogène, voire proprement désespérant. Mais avant que d’aller se réfugier en Finlande, on leur conseillera la lecture de cette formidable Pêche au petit brochet. Hormis un considérable plaisir de lecture, ce premier roman du finnois Juhani Karila leur permettra de sélectionner au mieux leur future région d’adoption…
Si l’on en croit en effet l’auteur, il est certains coins, ou plutôt recoins, de la Finlande, où le bonheur semble en rester à jamais au stade de la promesse. Il en va ainsi de « l’inepte Laponie orientale. […] Un ramassis herbeux de mottes indéterminées, comme si Dieu, après avoir réparti ailleurs ses pelouses, ses landes et ses forêts tropicales, avait plaqué le restant sur la calotte polaire. » Dans les rares bourgs comme égarés au sein de cette « alliance de […] vastitude et de […] vacuité », il n’y a décidément pas grand-chose à faire. Comme à Vuopio, principal lieu du livre, où les « distractions » les plus courantes sont l’espionnage du voisinage avec médisance en sus ou bien encore le harcèlement scolaire et les violences domestiques. Pour les plus pacifiques des habitants et habitantes de Vuopio, reste la pêche dans l’un des étangs sourdant de l’humide contrée. Parmi ces aficionados locaux des loisirs halieutiques, l’on compte Elina, l’héroïne du roman. À l’orée de celui-ci, cette native de Vuopio regagne son village, après en être partie pour étudier dans le Sud de la Finlande. Puis la voici bientôt partie pêcher (sans doute l’aura-t-on deviné) le petit brochet…
Mais loin d’être banale, et encore moins synonyme de détente, la partie de pêche s’avère bien vite aussi singulière que périlleuse. Et ce, pas uniquement parce que les moustiques pullulent à la faveur d’un été extraordinairement caniculaire, rappelant que la Laponie n’est pas épargnée par la catastrophe climatique en cours. En sus des myriades de ces envahissants et piquants insectes, Elina doit composer lors de sa pêche avec la faune pandémoniaque de Vuopio. Car sous le cercle polaire, « le vide horrifiant […] sécrète des monstres parcourant les tourbières ». Parmi ceux-ci, l’on compte « des kukkuluuraaja, farfadets narquois, des sinipiika, servantes des sous-bois » et autres teignons, grabuges et ondins. Tous témoignent à leur maligne manière de la survivance dans cette marge ultime de l’écoumène d’un surnaturel, dont participent aussi quelques-uns de ses hôtes humains. Elina possède ainsi certains talents sorciers, hérités de sa magicienne de mère. Et ces pouvoirs nécromants s’avèreront aussi utiles qu’une canne à pêche dans cette Pêche au petit brochet où la proie n’est pas celle que l’on pense, et de laquelle dépend pour Lena bien plus que le menu du jour…
Mais on arrêtera là de divulgâcher la trame de ce splendide roman, dont l’une des nombreuses et grandes qualités est un art narratif certain de la surprise. S’inscrivant dans la droite ligne de la Finnish Weird, ce surgeon subpolaire de l’Imaginaire, La Pêche au petit brochet cultive avec bonheur le réalisme fantastique teinté d’ironie. À l’instar notamment des œuvres les plus réussies de Johanna Sinisalo, Juhani Karila marie ainsi le prosaïque et l’extraordinaire de la plus convaincante des manières. Donnant souvent lieu à d’inédites et fascinantes visions, cette relecture du réel à l’aune de l’ange du bizarre n’empêche pas le surgissement de l’émotion. Car La pêche au petit brochet est aussi un roman d’amour aussi beau que touchant.
P.S. : On signalera, toujours chez La Peuplade, la parution de trois titres de la finlandaise Tove Jansson, la créatrice des Moumines. Si ces livres ne relèvent pas de l’Imaginaire, ils prolongent bellement l’univers de la mère des fameux trolls…
Pierre Charrel

Hangsaman
Shirley Jackson - Rivages, coll. Noir - octobre 2021 (roman inédit traduit de l’anglais [US] par Fabienne Duvigneau - 288 pp. GdF. 21 euros)
À la vue de la couverture de ce roman inédit en français de Shirley Jackson, difficile de ne pas penser à celle du Bifrost 99, consacré à l’autrice de La Maison hantée. L’auteur en est le même, Miles Hyman, son petit-fils, également auteur d’une version illustrée de la fameuse nouvelle « La Loterie ».
Hangsaman raconte l’histoire de Natalie Waite, dix-sept ans, sur le point de rejoindre l’université et présentée comme ayant un rapport au monde « différent. » Son père, écrivain, autoritaire et peu prolifique, lui impose d’incessants exercices d’écriture. Il y a également son frère et sa mère, constamment inquiète. Celle-ci reste au second plan la majorité du temps. Suite au départ de Natahlie de la maison, nous la suivons dans la découverte de la vie d’étudiante.
Hangsaman est une plongée, tantôt amusante, tantôt effrayante, dans la psyché d’une jeune femme habituée à inventer des mondes. La narration nous livre ses pensées, avec toutes les digressions imaginables, mais également avec tous les non-dits. Il faut s’habituer à bien différencier ce qui se dit entre guillemets ou derrière un tiret, et ce qui est intégré à la narration. Mais l’affaire n’est pas aussi simple, et rien n’est jamais sûr dans ce roman. Un événement traumatique est violemment imposé à Natalie dans le début de l’histoire. Point de départ de ses divergences ? A priori non, mais faut-il se fier à son rapport au temps ? Qu’arrive-t-il réellement à Natalie ? Qui est-elle vraiment ? Est-elle vraiment ? Le vrai : tout un programme dans l’esprit de l’étudiante. Où est le réel ? Une question pour elle, mais tout autant pour nous…
La relation fille-père, puis fille-père de substitution est au cœur du roman. Natalie, une fois à l’université fréquentent de rares autres jeunes femmes, mais la superficialité reste de mise, jusqu’au dernier tiers. Shirley Jackson croque ainsi avec mordant l’hypocrisie. Celle de la famille, celle des « amis », celle du milieu universitaire. Le malaise des faux-semblants, omniprésents dans la majorité des interactions de Natalie, est encore plus déstabilisant quand on le vit au travers d’une des protagonistes. L’enfer des autres, de leurs regards, de leurs opinions, de leurs ricanements mais aussi de leurs envies de parler, de leurs attentions, de leur simple présence.
Shirley Jackson tisse sa toile et nous laisse nous dépêtrer au sein de son labyrinthe, tout en faisant régulièrement miroiter une sortie. Pour autant, Hangsaman n’est pas franchement un roman de genre. Il y a bien des choses étranges qui peuplent ses pages, une ombre entraînante ou un arbre prenant des nouvelles, mais pas assez pour pleinement l’ancrer dans le fantastique. La lecture s’avère exigeante si l’on veut à tout prix comprendre l’enchaînement logique des faits, plaisante si l’on se détache d’aussi basses considérations que la compréhension. Car la plume de Shirley Jackson est riche et peu avare en images savoureuses et descriptions piquantes. À savourer donc, si vous aimez avancer dans le brouillard.
Mathieu Masson

Un soir, un train
Johan Daisne - L’Arbre Vengeur, coll. « Domaine du songe » - octobre 2021 (réédition d’un roman traduit du néerlandais par Maddy Buisse - 142 pp. semi-poche - 15 euros)
Depuis leurs débuts, les éditions de L’Arbre Vengeur mènent un travail salutaire, notamment en ressortant de l’oubli curiosités littéraires et autres textes inclassables. Inaugurant la collection « Domaine du songe », le court roman Un soir, un train ressort pleinement à ce travail d’exhumation. Datant de 1950, ce texte est signé par l’écrivain flamand Johan Daisne (1912-1978), auteur d’une œuvre considérable mais dont seule une petite part a été traduite en français.
Un soir comme tous les autres, le narrateur rentre en train à son domicile. S’éveillant d’un assoupissement momentané, il se rend compte que tous les autres passagers dorment d’un profond sommeil. Tous, ou presque : s’avançant à travers les wagons, il finit par rencontrer un vieux professeur, pareillement interloqué par la présente situation, et un jeune homme fougueux. Quand le train s’arrête au milieu de nulle part, tous les trois en descendent… et voilà que le convoi repart, sans eux. Que faire, sinon aller de l’avant dans la nuit et, peut-être, tenter de résoudre ces mystères ?
Il flotte sur Un soir, un train une étrange atmosphère, cela dès le « texte liminaire » de Jean-Philippe Toussaint, manière de mise en bouche tenant plus de la nouvelle fantastique que de la préface à proprement parler, sans omettre les dessins en noir et blanc de Jean-Michel Perrin, tour à tour platement illustratifs ou plus subtilement évocateurs. Au sein de ce récit, il ne s’agit pas pour autant de faire du bizarre pour du bizarre : les dernières pages du récit de Daisne voient la réalité reprendre ses droits, les explications se font jour – mais nul retour à la situation initiale, les personnages ne demeureront pas intacts après ce trajet en train interrompu. Onirique et poignante, cette pépite mérite amplement d’être redécouverte, et s’il fallait émettre un reproche, ce serait envers une mise en page un brin trop aérée.
À noter que le texte de Daisne a été porté à l’écran en 1968 par le réalisateur belge André Delvaux, avec Yves Montand et Anouk Aimée. Si les personnages et l’intrigue ont été étoffés par rapport à l’œuvre originelle, le film parvient à conserver une bonne part de son étrangeté.
Erwann Perchoc