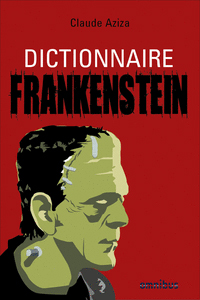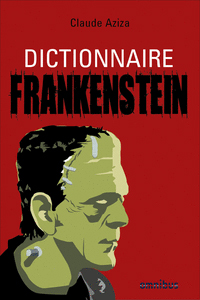
Dictionnaire Frankenstein
Claude Aziza – Omnibus, coll. « Bibliomnibus » – mars 2018 (essai inédit. 214 pp. GdF. 16 €)
Tout a déjà été dit, ou presque, sur Frankenstein et sur Mary Shelley, qui, à 19 ans seulement, écrivit un roman destiné à devenir un mythe. Le bicentenaire de sa parution méritait bien un dictionnaire permettant de revenir aussi bien sur des aspects connus ou méconnus de l’œuvre qu’explorer sa postérité, riche d’adaptations et d’avatars dans tous les domaines.
Cent dix-neuf entrées permettent de naviguer entre les thèmes et les détails biobibliographies : elles vont de la notule brève, voire ultra-brève (une ligne), à l’article courant sur plusieurs pages. Les plus fouillés et les plus intéressants concernent l’œuvre originale, les conditions de sa création et ses acteurs : outre Mary Shelley et Percy Shelley, dont on sait qu’il relut le manuscrit et rédigea la première préface, Claire et George Gordon Byron, leur fils William, le médecin de Byron, Polidori, au bord du lac de Genève, au cours de cet été pluvieux de 1816 suite à un hiver volcanique causé par l’éruption du Tambora en Indonésie. On délivre ainsi, au fil des entrées, des informations sur la portée de l’œuvre, sa résonance philosophique, le contexte social et politique, la chronologie du roman et sa réception critique, ainsi que sur la riche carrière de la créature, qui alla jusqu’à usurper le nom de son créateur. Celle-ci est essentiellement cinématographique, et on trouvera aussi bien les articles consacrés à James Whale, Boris Karloff, qu’au Rocky Horror Picture Show et même aux nanars regroupés à part. C’est moins le cas dans la littérature, si foisonnante en références et clins d’œil que seul un survol est effectué en une seule entrée, de Benoît Becker à Brian Aldiss, en passant par Tim Powers et Dean Koontz. Idem pour les adaptations, reprises et pastiches dans le théâtre, la bande dessinée et la chanson, qui recense par exemple un Frankenstein de Serge Gainsbourg.
Quelques entrées sont dispensables, consacrées aux autres monstres sacrés du fantastique et à leurs représentants. Passe pour Bela Lugosi, qui refusa le rôle de la créature, mais Fu Manchu, le Dr Moreau, King Kong et Jekyll et Hyde n’ont pas réellement leur place ici, pas plus que les entréesfantastique, science-fiction, roman populaire, gothique et historique, notules trop schématiques, discutables, voire partiellement fausses, qui ne servent qu’à gonfler le nombre d’entrées.
Claude Aziza, spécialiste des littératures populaires anciennes, mais pas réellement connaisseur de la science-fiction, récuse le qualificatif SF au roman de Mary Shelley, alors qu’il signait, en 1986, avec Jacques Goimard, une Encyclopédie de poche de la science-fiction (un Guide de lecture reprenant les fiches pédagogiques des titres publiés chez Pocket) citant le roman de Shelley parmi les principales dates de la science-fiction : l’autorité du co-auteur avait prévalu ou un revirement s’est opéré depuis. Pour Aziza, Frankenstein ne contient aucun des éléments spécifiques à la SF, le recours aux découvertes scientifiques de son temps n’étant pas utilisé ici comme facteur romanesque (c’est exactement le contraire, comme Aziza l’indique lui-même par ailleurs), ne serait-ce que parce que le roman est placé sous le signe de Prométhée, et donc du mythe. L’argument est grossier. Il amènerait à retirer nombre de titres basés sur la mythologie.
Un avis mitigé, donc, en raison de quelques faiblesses, mais un ouvrage à recommander malgré tout pour l’érudition et la facilité de consultation. Il sera beaucoup pardonné à Claude Aziza pour le bel hommage à la mère de la créature, sobrement intitulé Mary : « Je vous salue, Mary, pleine de glace. Et de feu. » À bien des égards, il s’agit là d’un dictionnaire amoureux.
Claude Ecken
*

Femmes d’argile et d’osier
Robert Darvel – Les Moutons électriques, coll. « La Bibliothèque voltaïque » – mars 2018 (roman inédit. 264 pp. GdF. 19,90 €)
Robert Darvel - Les Moutons Électriques, coll. « La Bibliothèque voltaïque » - mars 2018 (roman inédit - 264 pp. GdF. 19,90 euros)
Ce n’est pas de la science-fiction, pourtant il s’agit bien d’un voyage vers une planète inconnue : les confins de l’Amazonie au début du xx e siècle sont aussi éloignés de notre réalité que, disons, la Cité Terre du Monde inverti. Un lieu où la rationalité, les savoirs et les certitudes ne servent plus à grand-chose. Avec Femmes d’argile et d’osier, Robert Darvel délaisse Harry Dickson, dont il a prolongé les aventures dans une série de récits fidèles au modèle original (voir le dossier consacré à Jean Ray dans le n° 87 de Bifrost), pour relater un épisode de la vie d’Hiram Bingham, historien et explorateur. Alors qu’il étudiait la culture inca au Pérou, Bingham entendit parler d’une cité perdue dans les environs du Machu Picchu. La quête de ce lieu mythique devint dès lors son idée fixe, et il réussit à convaincre suffisamment de monde pour organiser une expédition.
Un explorateur obsessionnel, des ruines mystérieuses, des fleuves à remonter ou à franchir, une jungle impénétrable, des bêtes sauvages, des autochtones hauts en couleurs, de la magie vaudou ou végétale… On imagine bien quel récit d’aventures exotiques plein d’effets et de rebondissements l’auteur aurait pu tirer de cette histoire vraie. Or, il escamote très vite cet horizon d’attente en quelques séquences où se concentrent découverte du site inca et rencontre des étranges femmes du titre : désintérêt immédiat de Bingham pour les ruines, l’explorateur n’ayant de cesse, dès lors, de chercher l’introuvable, c’est-à-dire un passage magique vers le monde inversé où vivent ces belles poupées golem.
Au fond, Femmes d’argile et d’osier est moins un récit d’aventure qu’un récit sur le désir d’aventure, voire le désir tout court. Et ce désir est toujours un fantasme : une soif de conquête et de domination (le colonialisme pillard des capitaines d’industrie et, à quatre siècles de distance, des conquistadors), ou la projection de rêveries moites (les utopies, ou les appétits charnels, de Bingham). Comme il n’y a pas de désir sans frustration, la rétention du spectaculaire répond ici à l’idée que l’échec est le moteur de la vie, car c’est en n’aboutissant pas que la quête peut sans cesse être relancée.
Si le livre peut paraître bien sérieux dans son refus d’hystériser l’aventure ou de sacrifier à l’infantilisme qu’on reproche parfois à la SFF, il n’en est pas moins merveilleux et même enfantin. Il rappelle que c’est justement le sérieux qui fascine les jeunes lecteurs dans certains récits d’aventure. Chez Stevenson ou chez Verne, ce n’est pas l’enfance qu’on recherche, mais une preuve que les rêves d’exploration peuvent s’accomplir dans la vie adulte. Que tente précisément de raconter Darvel sous les oripeaux du conte sylvestre ? Peut-être que si les pères comme Bingham délaissent parfois femme et enfants, c’est qu’ils ne peuvent cesser de rester eux-mêmes des enfants, d’insatisfaits rêveurs sous leur masque savant et sévère. Le récit se prive à mon sens de développements intéressants en ne faisant qu’évoquer de manière superficielle Alfreda, la femme de Bingham, dont on devine ce qu’elle doit apprendre à accepter : l’incurable immaturité que la position sociale et l’autorité de son époux dissimulent mal, la laissant dans l’attente, entre amour et abandon, entre le foyer déserté de New Haven et les jungles et les femmes chimériques.
De même qu’Alfreda est tragiquement effacée, Bingham, malgré ses qualités de flegme, de pragmatisme et de curiosité, peut paraître terne, et c’est donc dans l’étonnante galerie de seconds rôles qu’il faudra rechercher un peu de charisme ou de grandeur. Comme ses protagonistes, le livre n’est jamais où on l’attend. Tout en retenue dans l’action – parfois, jusqu’à la vacuité –, la forme, en revanche, est d’une constante densité, par le jeu notamment d’un style emphatique, à la limite de la grandiloquence. Ces actes manqués, ces clairs-obscurs narratifs et stylistiques, conjugués à l’absence de dimension politique (alors que comme l’avait bien compris Lucius Shepard, tout est politique en Amérique du sud, y compris la magie), rendent cette histoire attachante difficile à apprivoiser.
Sam Lermite
*

Hildegarde
Léo Henry – La Volte, coll. « Littérature » – avril 2018 (roman inédit. 516 pp. GdF. 20 €)
Hildegarde par Léo Henry – La Volte, coll. « Littérature », avril 2018 (roman, 515 pp, GdF, 20 euros)
Livre-monde, roman fleuve, véritable OLNI, Hildegarde s’ordonne autour de la figure, pour ne pas dire l’icône, de Hildegarde de Bingen. Prophétesse et sainte femme, animée par de douloureuses épiphanies, savante naturaliste, fine observatrice de la nature, femme d’influence respectée par Bernard de Clairvaux et l’empereur Frédéric Barberousse, compositrice et inventrice d’une langue imaginaire, la magistra des abbayes de Disibodenberg et Rupertsberg a traversé les âges, nimbée d’une aura de mystère et de mysticisme, offrant à la postérité ses visions et une œuvre qui témoigne de la grande variété de son érudition. Pour autant, Léo Henry n’endosse pas ici le rôle du biographe, comme a pu le faire l’historienne médiéviste Régine Pernoud en cherchant à cerner la personnalité de la religieuse, via un corpus de sources historiques. Hildegarde relève davantage de la fiction, mais une fiction où le vrai et le faux accouchent d’un réel dont on se délecte des multiples facettes.
Strictement inracontable, le roman de Léo Henry se déguste comme un mille-feuilles littéraire dont chaque chapitre dévoile une histoire, souvent enchâssée dans un autre récit, révélant des nuances contrastées tout en s’inscrivant dans des registres variés, parfaitement assimilés par l’auteur. Le goût pour le picaresque se mêle ainsi au récit hagiographique, voire à la chanson de geste ou au roman courtois. L’épopée flirte avec le tragique de l’histoire humaine. Le merveilleux côtoie le prosaïsme du quotidien, y compris dans ses manifestations les plus vulgaires. Bref, il est bien difficile de classer le roman de Léo Henry dans une catégorie. Et quand bien même, on s’y risquerait, force serait de constater que cela n’est guère intéressant. Hildegarde se révèle surtout comme un roman total, mêlés d’inventions savoureuses, de souvenirs, de on-dit, de légendes et de témoignages, jalonnés de tueries, de pogroms, de batailles, mais aussi de réalisations merveilleuses conçues par les esprits éclairés de l’époque. Mille et uns récits qui font la vie et l’histoire de cette partie de l’Europe.
Car, loin de se cantonner au personnage de la sainte femme, Hildegarde se fait également le porte-parole d’un Moyen-âge lumineux, non exempt de zones d’ombre, où le monde se conçoit à l’aune de représentations empruntées à la philosophie antique, aux mythes et au christianisme. Une période créatrice où certaines intuitions s’avèrent, contribuant à la compréhension du monde. Un temps apparemment immuable, où les romans de chevalerie forgent la culture des élites. Le récit s’enracine dans la vallée du Rhin, au sein de l’Empire, le Saint-Empire germanique né du démantèlement du monde carolingien, faisant de ces lieux un creuset irrigué par de multiples récits. Naviguant au cœur des conflits entre la papauté et l’Empire, des croisades aux prémisses de la guerre de trente ans, des prophéties hallucinées de la magistra aux premiers développements de l’humanisme, Léo Henry réenchante l’Histoire en puisant dans le légendaire médiéval, n’hésitant pas à évoquer Parzival, Siegfried, le moins connu Dietrich von Bern et la légende des Niebelungen pour donner corps à une intertextualité réjouissante, rendant justice au monde germanique et à l’une des grandes thématiques morales et symboliques de l’imaginaire médiéval. De ce voyage littéraire, mené de main de maître par un auteur ayant érigé son écriture au rang des beaux art, on retire un immense plaisir, celui ressenti à la lecture des œuvres magistrales et forcément indispensables.
Laurent Leleu
*

Dernières fleurs
avant la fin du monde
Nicolas Cartelet – Mü éditions, coll. « Le Labo de Mü » – mai 2018 (roman inédit. 192 pp. GdF. 18 €)
Pour son nouveau roman publié aux petites mais dynamiques éditions Mü, le français Nicolas Cartelet transpose Albert Villeneuve, le héros de Petit Blanc, au cœur d’un monde sur le chemin de l’apocalypse. Dans un futur plus ou moins proche, les abeilles ont disparu entraînant la catastrophe écologique annoncée. Pour produire fruits et légumes, les hommes sont désormais obligés de polliniser les fleurs à la main dans d’immenses plantations où la rentabilité règne en maître absolu. Tandis qu’Albert Villeneuve dirige l’une des sections de journaliers chargée de ce travail ingrat, sa femme Manon s’épuise dans une usine de production de médicaments. Il ne semble n’y avoir aucun espoir pour le couple dans cet univers au bord du gouffre… jusqu’au jour où Albert est convoqué par le Duc, puissant propriétaire de la plantation où il travaille. Celui-ci lui fait alors une offre aussi étrange qu’inespérée : devenir le professeur de sa fille Apolline et lui apprendre à lire.
Délaissant les colonies fantasmées pour les plantations esclavagistes, Nicolas Cartelet poursuit son exploration de la misère humaine avec Dernières fleurs avant la fin du monde. Grâce à une plume qui gagne en maturité et en poésie, l’auteur français plonge le lecteur dans un monde de noir et de gris où les derniers hommes continuent à s’entredéchirer pour survivre. Au cœur de ce récit ouvrier qui expose les rouages ultracapitalistes d’une exploitation de la dernière chance, Albert Villeneuve incarne l’homme moderne dans toute sa beauté et sa lâcheté. En effet, Albert pourrait être un révolutionnaire s’il en avait encore la force. Il préfère regarder ses camarades se tromper d’ennemi et mourir pour une patate de plus que de prendre part à l’inévitable embrasement qui s’annonce. Critique à peine voilée du travail ouvrier à l’heure du grand capitalisme mais aussi charge féroce contre la haine de l’étranger venant voler l’argent des honnêtes travailleurs, Dernières fleurs avant la fin du monde a tout du roman révolutionnaire. Pourtant, son héros littéralement impuissant devient le porte-étendard d’un monde masculin qui ne bande plus, l’image acide d’une humanité incapable de se reproduire après avoir elle-même stérilisée Dame Nature. Albert va cependant trouver une dernière ombre de beauté et de poésie par l’intermédiaire d’Apolline, une autiste à la pureté presque décalée dans un monde qui n’en finit pas de crever. Il redécouvre ainsi le pouvoir des mots et de la musique, mais aussi des rires et des sourires. Dernières Fleurs avant la fin du monde devient dès lors un livre poétique qui oppose le couple fané d’Albert et Manon à la fraîcheur infinie d’Apolline. Nicolas Cartelet débusque ainsi quelques traces de lumières pour le lecteur en s’extirpant l’espace de quelques notes de son futur à la Di Rollo. La brièveté de l’histoire empêche ce récit de fin du monde de tourner à vide et préfère l’intime à la grande révolution, forcément condamnée de toute façon. Dernières fleurs avant la fin du monde finit par s'inscrire dans le registre des romans poétiques et douloureux que l'on referme avec un pincement au cœur, le temps d’une partition saccagée et d’une floraison imprévue.
Nicolas Winter
*