
Où Francis Valéry s'intéresse aux musiques extraterrestres, dans le corpus cinématographique et littéraire de la science-fiction. Des musiques extraterrestres parfois un peu trop terre-à-terre…

Où Francis Valéry s'intéresse aux musiques extraterrestres, dans le corpus cinématographique et littéraire de la science-fiction. Des musiques extraterrestres parfois un peu trop terre-à-terre…
Les rapports entre la science-fiction et la musique constituent un sujet de réflexion riche et varié, de par la multiplicité des approches possibles. Si l’on se réfère à la définition proposée par l’encyclopédiste Pierre Versins, la science-fiction serait avant tout l’expression d’un état d’esprit — et cet état d’esprit serait susceptible de s’exprimer à travers l’ensemble des activités humaines. En particulier dans la littérature, les arts graphiques, le cinéma ou les séries télévisées, mais aussi dans des domaines moins évidents comme l’architecture, la danse, les arts ménagers, l’esthétique industrielle ou… la musique.
Ainsi, lorsque Edgar Varèse compose son Poème électronique, diffusé à l’occasion de l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958, c’est bien une évocation d’un supposé Grandiose Avenir qu’il propose, sous la forme d’une pièce de musique électronique. Au cours des années 1970, des groupes comme Magma ou Tangerine Dream proposent à leur tour des œuvres nourries des motifs de la science-fiction littéraire ou cinématographique, évoquant des mondes extrasolaires et des civilisations extra-terrestres. Ces motifs vont également nourrir des textes de chansons (Boris Vian), des décors de spectacles ou des costumes de scène (Starmania), ou encore l’iconographie des pochettes de disques (Roger Dean) — et de manière moins évidente à définir, ils vont être à l’origine de certaines esthétiques purement musicales.
Il est un aspect de cette problématique rarement abordé par les écrivains et les réalisateurs de films — et encore plus rarement par les compositeurs eux-mêmes — c’est celui d’une musique qui pourrait être, elle-même, d’origine extra-terrestre. Il s’agit pourtant de l’aspect le plus fascinant de ce que l’on pourrait appeler, de manière simplificatrice, la « musique de science-fiction ». La question requiert une réflexion approfondie et complexe, puisqu’il convient d’abord de décider de ce que l’on entend par « musique », avant de tenter d’établir ce qui la détermine d’un point de vue culturel — ou plutôt exo-culturel.
Une des premières évocations d’une musique d’origine extra-terrestre — ou pour le moins interprétée par des extra-terrestres à défaut d’être explicitement décrite comme composée par des extra-terrestres — est proposée par l’illustrateur Emsh, alias Ed Emshwiller, avec la couverture du numéro daté février 1955 du magazine Galaxy Science Fiction. L’illustration ne se rapporte pas à un des textes inclus dans le sommaire mais est une œuvre à part entière, titrée Chamber Music Society of Deneb. De fait, elle dépeint un orchestre de chambre composé de six musiciens : un humain, clarinettiste de son état, vêtu d’un costume strict et portant un nœud papillon, et cinq aliens aux allures aussi improbables que les instruments dont ils jouent. Emsh se fera une spécialité de ces couvertures magnifiques et extravagantes, porteuses d’un humour décalé et pour lesquelles une certaine plausibilité scientifique n’était pas vraiment de mise — et c’est sans doute pour cela que son travail reste d’une étonnante fraicheur alors que nombre d’anticipations supposées et autres extrapolations futuristes sont tombées en désuétude.


De nombreux textes mettent en scène des musiciens confrontés à des situations relevant de la science-fiction, mais il s’agit en général de musiciens humains — ou d’origine humaine, pour ce qui concerne des œuvres situées dans un lointain futur, dans le cadre d’une Fédération ou d’un Empire. Le sujet d’une musique authentiquement alien n’y est en général même pas évoqué. En 1973, paraît toutefois Sweet Water de Laurence Yep, un roman de SF pour la jeunesse dans lequel apparaît un musicien alien. Des colons humains se sont installés sur un monde baptisé Harmony où ils s’efforcent de survivre, non sans difficultés. Un adolescent, Tyree, finit par se lier d’amitié avec Amadeus, le plus grand maître de musique de la race indigène, des créatures arachnoïdes. Amadeus fait découvrir à Tyree le pouvoir que recèle la musique. Le roman est d’une lecture agréable mais il ne propose pas de réelle réflexion sur le concept de musique extraterrestre.
Il faut attendre 1977 pour que deux propositions de musique alien soit faites, dans deux films appelés à un connaître un immense succès. Le premier est La Guerre des Etoiles de George Lucas. On se souvient de cette scène dans une taverne, dans laquelle un orchestre d’aliens assure l’ambiance musicale. Plusieurs plans — dont un bref travelling — permettent d’apercevoir des instruments plutôt classiques dans leur aspect et leur fonction (deux instruments à vent ressemblent à des clarinettes dotées d’une tuyauterie additionnelle) et d’autres plus énigmatiques. Mais la musique proposée relève du jazz le plus traditionnel qui soit — le premier morceau donne envie de danser le charleston ! Aussi compliqués qu’ils soient dans leur apparence, les instruments sonnent comme des instruments acoustiques (clarinette, saxophone, contrebasse…) des années 1930/40. Cette scène de la taverne (baptisée plus tard Mos Eisley Cantina) est très colorée, et sa faune d’extraterrestres plus ou moins bizarres a, à l’époque, marqué les esprits — ainsi que l’orchestre, désigné par la suite sous le nom Figrin D’an and the Modal Nodes. Elle a aujourd’hui terriblement vieilli sur le plan visuel, les images numériques modernes étant autrement plus crédibles que les masques en latex et les animations mécaniques. Et surtout le choix de la musique apparaît comme totalement absurde ! Plusieurs critiques firent en leur temps remarquer que Star Wars était avant tout une œuvre parodique, en forme d’hommage au space opera archaïque à la Flash Gordon. Près de quarante ans plus tard, cet aspect de l’œuvre est d’autant plus évident.
À la fin de la même année 1977 sort Rencontres du troisième type, réalisé par Steven Spielberg. Dans ce film pétri de bons sentiments et à la gloire des tubes au néon vintage, les extraterrestres ont la bonne idée d’utiliser la musique comme moyen de communication. Ils ont par contre la mauvaise idée de s’exprimer via une gamme tempérée — c’est-à-dire que les notes qu’ils utilisent n’ont rien à voir avec les harmoniques naturelles produites, par exemple, à l’aide d’un monocorde « découpé » par effleurement à des positions définies par des fractions simples (quinte, quarte, tierce majeure, sixte…) mais un système purement culturel, apparu en occident à la fin du seizième siècle, popularisé par la musique baroque. Il est tout de même étonnant que des extraterrestres utilisent ce système musical qui, en regard de la diversité des cultures humaines et de leurs productions artistiques, apparaît comme un simple épiphénomène occidental moderne. Le fameux message extraterrestre utilise quatre notes — dont une répétée à l’octave inférieur : Sib, Do, Lab, Lab (octave inférieur), Mib. À l’oreille, le Mib final s’impose en réalité comme la fondamentale : on peut parfaitement le jouer en continu (en faire un bourdon) et greffer dessus la phrase originale. On se trouve alors sur une gamme de Mib majeur avec le Sib en rapport de quinte, les notes additionnelles ayant valeur de quarte et de sixte majeure. On pourrait aussi éventuellement considérer que la phrase de quatre notes constitue un arpège sur un accord de Lab majeur (Lab / Do / Mib), le Sib ayant alors rang de seconde/neuvième. Sur le papier, cette seconde interprétation fonctionne (elle s’appuie en effet sur un accord complet), mais à l’oreille elle est plus discutable.
Quoi qu’il en soit, l’utilisation du tempérament est aussi absurde que le choix du jazz classique dans La Guerre des étoiles — et est d’ailleurs d’autant plus injustifiable que la phrase musicale relève de la musique modale (à bourdon) qui se joue sur une gamme diatonique construite avec des harmoniques naturelles, non transposable. Là encore, aucune réflexion n’a été menée par les scénaristes sur la nature même de ce que l’on appelle « musique » — et sur les conditions de son émergence dans une culture donnée.
En 1983, un nouveau groupe de musiciens aliens est présenté dans Le Retour du Jedi, troisième et ultime volet de la trilogie originale Star Wars. Il s’agit d’un trio assurant l’animation musicale pour Jabba the Hutt. On l’entend d’abord en musique d’ambiance lorsque les droïdes apportent à Jabba un message holographique de Luke Skywalker — pour un morceau à l’esthétique baroque, avec des sons évoquant une flûte et un clavecin, sur lesquelles plane une vague vocalise. Quelques minutes plus tard, à l’arrivée du mercenaire ayant capturé Chewbacca, on aperçoit enfin les musiciens : un éléphanteau à la peau bleue qui joue des claviers et une créature bouffie vaguement humanoïde qui utilise un instrument à vent, qui accompagnent une chanteuse dégingandée. La musique change : on entend désormais une flûte, un piano électrique qui plaque des accords, une basse, une batterie… pour un morceau en 4/4 déjà un peu daté en ce début des années 80 ! Plus avant dans la bande son, on entend des frappes sur des cymbales. Une fois de plus, l’inventivité réside uniquement dans le design des instruments — mais celui-ci est purement gratuit : l’aspect des instruments est largement déconnecté de leur fonction musicale, c’est-à-dire des sons qu’ils produisent. Et d’ailleurs, comment le joueur de clavier peut-il piloter une boîte à rythmes, assurer un accompagnement avec des accords plaqués et une ligne de basse sur un seul clavier et avec ses grosses pattes ? Là encore, il y a totale déconnection entre ce que l’on voit et ce que l’on entend.

Le groupe aura pourtant un franc succès dans l’univers étendu de la saga, à travers plusieurs nouvelles et des récits graphiques. Ils sont d’abord nommés : le clavier éléphantesque est un Ortolan du nom de Siiruulian Phantele, son nom de scène étant Max Rebo ; le petit bouffi s’appelle Droopy McCool et son espèce de clarinette est un kitonak woodwind ; enfin la chanteuse montée sur échasses est de race B’lowick et se prénomme Sy Snootles. Là encore, la crédibilité n’est pas à l’ordre du jour avec ces noms à la consonance anglo-saxonne, la palme revenant à Droopy McCool — rappelez-moi de quelle région de l’Écosse vient le clan McCool ? Dans l’immense documentation produite autour de la saga, les musiciens sont décrits comme étant des jizz-wailers, c’est-à-dire des pratiquants d’une musique « rapide, contemporaine, au tempo rapide » — précision fort utile car à l’écoute ce n’est guère évident. La chanson interprétée dans le film s’appelle « Lapti Nek », et est chantée dans la langue des hutts. Dans une nouvelle de John Gregory Bettancourt, « And the Band Played on: The Band’s Tale », publiée en 1995 dans l’anthologie Tales from the Jabba’s Palace, on apprend que le trio était à l’origine un quatuor du nom de Evar Orbus and His Galactic Jizz-Wailers, venu sur Tatooine à la recherche d’engagements. Le groupe joue un temps à la Mos Eisley Cantina et se trouve donc en concurrence avec le groupe attitré des lieux, les Modal Nodes. La situation devient conflictuelle et Evar Orbus est tué par Figrin D’an, le leader des Modal Nodes. Les survivants décident de continuer en trio, avec Siiruulian Phantele comme nouveau leader — l’occasion pour lui de prendre le pseudonyme de Max Rebo, peut-être plus vendable, en tout cas plus prononçable. C’est ainsi qu’ils entrent au service de Jabba. Lorsque la barge stellaire de celui-ci est détruite, les musiciens parviennent à s’échapper. Droopy part de son côté pour rejoindre des membres de sa race. Max et Sy continuent un temps en duo avant de se séparer. Sy se lance dans une carrière solo mais ne rencontre pas le succès, tandis que Max rejoint les rebelles et se sert de sa musique pour alimenter le moral des troupes. Chic planète !
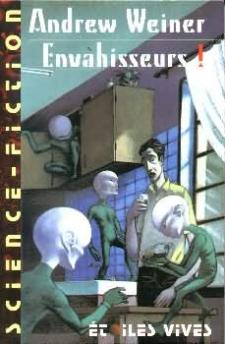
Accordons-nous un bref détour par la littérature avec une nouvelle d’Andrew Weiner : The Band from the Planet Zoom, parue en 1986, traduite en français sous le titre Le Groupe venu de la planète Zoom, dans le recueil Envahisseurs (1998). L’histoire est simple : sur la planète Zoom, on a la chance de capter les radios terriennes — et l’on devient accro au rock Made in Earth ! Un peu comme les européens (continentaux) des années soixante et soixante-dix tombèrent en pamoison devant le rock anglo-saxon. Du coup, des tas de groupes se forment et jouent du rock ! Jusqu’au jour où les habitants de la planète Zoom décident d’envoyer sur Terre leur meilleur groupe, histoire de nous faire voir ce qu’ils savent faire. Et pour tout dire, ils ne sont pas mauvais du tout ! Nous sommes ici dans le registre de l’humour — à l’occasion un peu noir… Quant à la musique que l’on jouait sur Zoom avant d’être contaminé par la gamme tempérée et les rythmes à quatre temps, on n’en saura rien. Ce qui vaut peut-être mieux, d’ailleurs.
En 1997, Le Cinquième Élément, film réalisé par le français Luc Besson, aborde incidemment le chant lyrique en version alien. Interprétée par la comédienne Maïwenn — avec la voix de la soprano albanaise Inva Mula — la diva extraterrestre Plavalaguna interprète tout d’abord un petit air d’opéra tout ce qu’il y a de plus classique — et insipide. Tout soudain, sur fond de boîte à rythmes et de synthétiseur — et avec un substantiel apport d’effets numériques — la diva se lance dans une vocalise particulièrement acrobatique. Cela fait son petit effet sur le spectateur. Et l’air de rien, cela s’inscrit dans notre problématique — de manière certes marginale. La musique n’offre rien de spécialement déconnecté de la culture occidentale. Mais c’est une caractéristique physiologique propre à la race alien à laquelle appartient Plavalaguna — un ambitus exceptionnel — qui l’autorise à chanter la mélodie. On se souvient du film Farinelli de Gérard Corbiau, sorti en 1994, dans laquelle la voix du personnage historique de Carlo Broschi, alias Farinelli, avait été fabriquée pour le cinéma en mêlant les voix naturelles d’un contre-ténor et d’une soprano, avec une bonne dose de bidouillage numérique développée par l’IRCAM. Farinelli avait la voix particulière des castrats du dix-huitième siècle. Plavalaguna a la voix des gens de sa race. Une caractéristique alien justifie donc la production d’une mélodie chantée qu’aucun humain ne saurait interpréter. Dans la démarche, il s’agit bien de proposer une véritable musique extraterrestre — et quant au résultat final, bien qu’elle s’appuie sur un accompagnement musical indigent, la vocalise reste intéressante.
Cette même année 1997, sort une nouvelle version du Retour du Jedi, dans laquelle le Max Rebo trio est remplacé par un grand orchestre d’une douzaine de musiciens et choristes. On aperçoit dans le troupeau un alien qui joue d’une sorte de basson et qui s’avère de la même race que les Modal Nodes : la vaste littérature secondaire consacrée à la saga nous apprend qu’il s’agit effectivement d’un Bith originaire de la planète Clak’dor VII. Il s’agit même du frère de Figrin D’ann, venu sur Tatooine pour rejoindre le groupe. Mais faute d’avoir pu les contacter, il s’est fait engager dans la nouvelle formation de Max Rebo. Dans cette nouvelle version, la chanson en langue Hutt, « Lapti Nek », est remplacée par le fameux « Jedi Rocks » — c’est du moins le titre sous lequel le morceau figure dans le CD de la musique du film. Sur le plan visuel, on est dans la continuité de la version originale avec des aliens plus ou moins délirants, manipulant des instruments plus ou moins dérivés d’instruments familiers — l’aspect science-fictif résidant en général dans l’ajout d’une tuyauterie décorative mais inutile, puisqu’ils sonnent exactement comme des instruments contemporains : orgue Hammond, harmonica, batterie, basse jouée en slap, etc. Cette fois, la musique relève du Rythm’ and Blues à la Tamla Motown (l’ombre de Booker T. and the MG’s plane sur l’ensemble) modernisée d’un esprit funk tout droit sorti d’une boîte new-yorkaise à la mode — je parle ici bien entendu de la mode du début des années quatre-vingt, ce qui signifie que, lors de la sortie de la nouvelle version du film en 1997, la musique est déjà incroyablement datée. La techno et la house — entre autres — sont passées par là, mais le compositeur semble ne pas s’en être rendu compte. Bref, si sur le plan visuel on peut, avec un peu de bonne volonté, trouver la scène amusante, d’un point de vue musicologique c’est une nouvelle fois profondément affligeant.
En conclusion (provisoire), force est de constater que l’on attend toujours des propositions convaincantes de ce que pourrait être une musique alien — et que l’on voudrait donc résolument non-humaine.